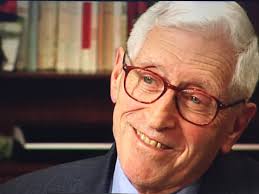L’étoile du berger. L’inflation du vocabulaire du « sens »
C’est devenu un lieu commun du vocabulaire des acteurs qui ambitionnent de réformer sans transformer les rapports sociaux : il conviendrait de « (re)donner du sens » à l’activité, singulièrement dans les domaines qui « font société ». Et l’on voit se multiplier les dispositifs d’accompagnement d’une telle donation de sens : référence à l’éthique, au bien commun, à la durabilité ; célébration des vertus de la pédagogie en politique, de la communication et du soft management dans les organisations ; cellules d’appui psychologique, etc.