Référence électronique
Sabine Kahn et Elsa Roland, « De l’enseignement mutuel à la pédagogie différenciée : la place de l’enseignement simultané », Éducation et socialisation [En ligne], 59 | 2021, mis en ligne le 31 mars 2021, consulté le 13 avril 2021. URL : http://journals.openedition.org/edso/13800 ; DOI : https://doi.org/10.4000/edso.13800
Quoi que l’on fasse, quel que soient les talents de l’enseignant (effet maître), quel que soit l’établissement (effet établissement), quels que soient les élèves, quels que soient leurs parents, quelle que soit la cantine scolaire, quels que soient les caractéristiques du bâtiment scolaire… notre enseignement produit des pathologies scolaires, des inégalités scolaires, de la violence symbolique et effective, de la solitude, de l’échec, etc. Comme s’il y avait quelque chose de vicié dans l’institution et son fonctionnement. Pourtant, on ne peut nier les efforts des enseignants, ceux de nombres de pédagogues, de didacticiens, de chercheurs, … pour débusquer les phénomènes, en proposer des clés de compréhension et des alternatives. On ne peut nier, non plus, des avancées « théoriques » vers une école plus inclusive, un arrêt de « l’indifférence aux différences », un tronc commun pour la Belgique, etc.
Ainsi l’histoire récente de l’École est semée d’élans, innovations, prescriptions, visant à la rendre plus juste, plus créative, plus bienveillante, plus intéressante, plus productive, etc. Il n’est pas certain que chacune de ces tentatives ait produit les effets escomptés. Nous nous demandons même si certaines d’entre elles n’ont pas consisté à poser « un cataplasme sur une jambe de bois », voire à maintenir un certain flou contribuant à détourner le regard de dimensions que nous nous permettons de qualifier de « viciées » dans le fonctionnement de l’École ; bref, « à calmer le jobard » (Goffman, 1987). La pédagogie différenciée ferait-elle partie de ces tentatives ? Quelles dimensions viciées de l’École viserait-elle à compenser, voire à masquer ? Peut-elle échapper à cette malédiction et effectivement contribuer à l’émancipation de tous les élèves ? Si oui, à quelles conditions le peut-elle ?
Il s’agit dans cet article d’interroger le concept de pédagogie différenciée et de le mettre en relation avec l’organisation structurelle de l’école telle que nous la connaissons aujourd’hui et les effets pervers qu’engendre cette organisation. Un détour par le passé sera nécessaire afin d’historiciser l’organisation scolaire dans laquelle s’inscrit la pédagogie différenciée en France, en Belgique et dans de nombreux pays dans le monde : l’enseignement simultané. Une organisation qui pourtant n’a pas toujours existé pour penser l’apprentissage et/ou la transmission des savoirs et qui jusqu’au début du XIXe siècle était en concurrence avec de nombreuses autres formes d’enseignement – dont l’école mutuelle, une méthode qui connut un grand succès fin du XVIIIe en France, en Belgique et en Angleterre, qui fut pourtant disqualifiée, au nom, entre autres, de sa trop grande « efficacité » selon Anne Querrien et qui sera présentée dans cet article afin de problématiser nos manières de penser la différenciation en sciences de l’éducation ces 50 dernières années. Ici, il ne s’agit pas de nier les autres modalités d’enseignement, restées cependant marginales malgré qu’elles aient percolé et influencé les organisations et pratiques pédagogiques « ordinaires » (Joigneaux, 2011 ; Talhaoui, 2017 ; Roland, 2018). Elles n’ont cependant pas acquis de véritables dimensions officielles ou légales, n’ont jamais été imposées, ou au moins fortement suggérées, par une organisation centrale et centralisatrise comme peut l’être un état (France), un pouvoir organisateur (Belgique) ou une Commission scolaire (Québec). D’ailleurs, elles n’ont pas donné lieu à controverses de même type et de même ampleur que ne l’ont été les débats enseignement mutuel vs enseignement simultané. Bien au contraire : la forme d’enseignement simultané fonctionne comme une telle évidence qu’elle résiste à la majorité des tentatives d’inflexion (voir le travail de Sylvie Jouan sur la classe à plusieurs cours, 2020).
L’enseignement simultané : une évidence à interroger
La forme d’enseignement la plus couramment partagée par les écoles officielles des pays industrialisés depuis la deuxième moitié du XIXe siècle est la forme d’enseignement scolaire simultané (voir notamment les travaux francophones et anglophones en histoire et en sociologie de l’éducation sur la forme scolaire et sur la « grammar of schooling »). Un enseignant s’adresse à un groupe d’élèves (la classe) censés être de même niveau scolaire (et de même âge) et faire les mêmes apprentissages en même temps et en même lieu. Cette forme d’enseignement s’origine dans l’organisation des collèges de Hiéronymites (ou des Frères de la vie commune) dès la fin du 15ème siècle, puisqu’y est inventée l’organisation de l’enseignement en classes successives. Auparavant, l’enseignement se donnait soit dans les écoles cathédrales (universités du Moyen-Age) en ce qui concerne la Théologie, le Droit ou la Médecine, sous formes de discussions avec un Maître qui ne suivait ni progression, ni programme, mais s’entretenait avec des étudiants de tous âges au gré de ses réflexions ; soit encore, dans les corporations auprès d’un « maître » au gré des nécessités de la production.
L’organisation des Hiéronymites a marqué une volonté de rationalisation du processus d’enseignement avec d’une certaine façon l’officialisation de la notion de classe, de répétition, dont la matrice s’était progressivement constituée dans les chambres d’étudiants des collèges du Moyen-Age (Compère, 1985) et dans les pratiques claustrales des communautés chrétiennes (voir notamment les travaux de Foucault sur les rapports entre cette nouvelle organisation de l’apprentissage et la pastoralité chrétienne). La forme d’enseignement scolaire s’est progressivement « affinée » au gré des tensions religieuses (Réforme et Contre-Réforme) et des pressions économiques pour devenir l’enseignement simultané : celui où la leçon du maître est donnée, d’une manière directe, à tous les élèves en même temps. En 1860, Jean-Baptiste de Lassalle fonde la congrégation religieuse des Frèresdes écoles chrétiennes. Il théorise et consigne le modèle de l’enseignement simultané. C’est une école du silence, de la prière, du devoir. L’apprentissage premier est celui de l’obéissance avant celui de la lecture, du calcul, de l’écriture qui ne sont que bénéfices secondaires. C’est aussi un enseignement profondément chrétien catholique, fondamentalement, les élèves ne peuvent accéder à Dieu (et au texte) sans l’intercession du Maître. Le Maître tient d’ailleurs son autorité de Dieu.
D’une façon synthétique on peut dire que la forme d’enseignement simultané est une forme récente à l’échelle de l’humanité (environ 400 ans) et pourtant dominante à l’échelle de la planète. Foucault dans son Cours au Collège de France de 1973-1974 parle à cet égard d’une véritable opération de colonisation de la jeunesse.
Elle se caractérise par :
– une progressivité des enseignements rigidifiée par les apports de la psychologie du développement et certains travaux de la didactique « ancienne »,
– une communication verticale du Maître à l’élève,
– l’autonomie des élèves comme une contre-valeur,
- l’isolement des élèves et l’importante mise en visibilité de chacun d’entre eux,
– la différence considérée comme « déviance » (Kahn, 2011).
L’enseignement mutuel : une forme d’enseignement qui aurait pu constituer la forme officielle
Au tournant du XIXe siècle, l’enseignement simultané a pourtant bien failli s’éteindre au bénéfice d’autres méthodes- telles que celle de l’enseignement mutuel (comme l’atteste par exemple les débats parlementaires sur ces questions en Belgique jusque dans les années 1850 (Roland, 2017). Dans les écoles d’enseignement mutuel, l’organisation est très différente de celle des écoles des grandes congrégations religieuses : un seul maître dirige une école - dont le nombre d’élèves dépend surtout de la capacité d’accueil du bâtiment (elle accueillait parfois jusqu’à plus de 800 élèves). Ce sont les élèves qui s’enseignent l’un l’autre selon une organisation complexe : le programme et la matière sont divisés en plusieurs sections qui sont elles-mêmes réparties dans plusieurs divisions dans les classes.
Ainsi, comme l’explique le Père Grégoire Girard, « tandis que le mode magistral ne travaille que sur la masse, pétrit ensemble de vastes programmes et ainsi réunit les élèves les plus différents, l’enseignement mutuel, au contraire, divise les deux, les programmes et les élèves. Sa devise est "gradation". Chaque section des écoliers ne reçoit qu’une petite partie de l’enseignement, et cette partie est bientôt apprise, bientôt exercée. Alors que les élèves appliqués avancent sur l’échelle vivante, les élèves lents et les élèves distraits restent au même degré jusqu’à ce qu’ils s’approprient de façon vivante l’enseignement non encore compris. L’avancement dépend uniquement du progrès accompli, non pas d’une certaine époque marquée par le calendrier, et qui n’a rien à faire avec le développement du garçon dans son école. Ainsi la classification des élèves est toujours en mouvement » (cité in Bugnard, 2016).
Mais d’où vient l’idée de cette organisation des apprentissages scolaires ?
En 1657, Comenius mentionnait le terme de « moniteur » dans Didactica magna. Il s’agit de diviser la classe « en groupe de 10 élèves, avec à leur tête, un moniteur, et à la tête de plusieurs groupes des moniteurs-chefs jusqu’aux moniteurs supérieurs » (in Bédouret, 2003, 117).
C’est un anglais, Andrew Bell, qui le mit en place dans diverses écoles anglaises après l’avoir repéré en Inde à la fin du 18ème siècle. Il publia un ouvrage (Expériences sur l’éducation faite à l’école des garçons à Madras, 1798) à Londres. Les Grammar schools ouvertes par Lancaster, contemporain de Bell, ont repris cette organisation. Le moniteur travaille de manière collective avec 10-12 élèves groupés autour de lui en leur faisant répéter la lecture, le calcul, etc. (Bédouret, 2003, 117).
En ce qui concerne la France, après que les pauvres, les homosexuels, les agités de toutes sortes, les libertins, les pères de famille dilapidant l’héritage, les chômeurs, les mendiants, mais aussi les fous, furent rassemblés dans l’Hopital Général (sous l’Ancien régime), leurs enfants ont été mis à l’école organisée d’une façon économique et rigoureuse : un maître sur une estrade pour une à plusieurs centaines d’élèves, préparant ainsi le lit de l’enseignement mutuel. Le projet de cet enseignement est alors strictement conformiste et disciplinaire (Foucault, 1972). La potentialité émancipatrice de cette forme d’enseignement, pris en charge, dans un premier temps, par les Frères de Écoles Chrétiennes, n’est alors pas perçue par les gouvernants (Querrien, 2005).
Au moment de la Révolution Française, les congrégations fuient la France, les Frères de Écoles Chrétiennes également. L’enseignement passe sous la responsabilité de l’Etat, et, le français devenant langue nationale, il faut des écoles pour propager la langue commune. Le Décret Lakanal (1794) enjoint villes et communes à ouvrir une école pour 1000 habitants. Il n’y a plus d’écoles, les lassaliens étant partis. De grands locaux sont disponibles, les biens de l’Église ayant été sécularisés. Les conditions matérielles sont en place pour que se développe l’école mutuelle « laïcisée », d’autant plus que cette méthode a été utilisée pour alphabétiser les armées de Napoléon. Les enfants y enseignaient aux Grognards de Napoléon.
Le système resté marginal et localisé se formalise en s’important d’Angleterre jusqu’à devenir un véritable succès sur l’ensemble du territoire français et un décret du 27 avril 1815 institue une première école modèle. Les écoles mutuelles se comptent alors par centaines en France (Bédouret, 2003, 117-118).
En 1832, Guizot devient ministre de l’Instruction publique. Il est protestant, défend l’enseignement mutuel et ne veut pas laisser l’école aux catholiques. Pour Guizot, il faut une école qui regroupe protestants, juifs, catholiques… Il décide donc d’ouvrir au minimum une école mutuelle par préfecture. Dès 1819, sont publiés des livres pour les maîtres qui enseignent dans les écoles mutuelles, un maître enseigne à 200 – 350 élèves, tous dans le même espace, regroupés par groupe de 10, ils reçoivent un enseignement de lecture, de maths et d’écriture, accompagné d’un enseignement moral et religieux basique pour ne pas prêter le flanc aux critiques des conservateurs.
Faillet (2017) mentionne 804 écoles mutuelles en 1831, 1334 en 1832 et 1983 en 1833. Même si ces écoles restent minoritaires (moins de 5% de la totalité des écoles), cela correspond à une expansion rapide de l’enseignement mutuel compte tenu du caractère rural de la France de la première partie du 19ème siècle. À la campagne, la faiblesse des effectifs scolaires ne permet pas toujours de recourir à cette méthode.
Cette progression est stoppée par le retour des ordres religieux auxquels les biens sont restitués, préparant ainsi une reprise en main de l’école par l’Eglise et les Frères des écoles chrétiennes lors de la guerre scolaire qui les oppose aux Libéraux et Mutualistes. L’Eglise supporte mal de ne pas contrôler une méthode d’enseignement. C’est un « protégé » de Guizot, Paul Lorain, qui manœuvrera pour « mettre à mort » l’enseignement mutuel. Il utilisera pour cela des procédés douteux, et même ce qui s’appellerait aujourd’hui, la diffusion de « Fake News » pour discréditer l’enseignement mutuel et promouvoir la méthode simultanée, notamment dans un ouvrage anonyme : « Manuel complet de l’enseignement simultané ». Ce manuel fait l’apologie d’une méthode simultanée dénuée de tout enseignement religieux. Il sera intégré et promu dans le « Manuel général » envoyé à tous les inspecteurs. Faillet évoque un complot contre l’enseignement mutuel qui va s’éteindre en douceur au nom d’une véritable défiance envers l’école et ses enseignants (Faillet, 2017). « L’instituteur qui se sent loin des yeux de ses surveillants, et qui sait que dans sa province, pas un homme peut-être ne connait le mécanisme intérieur de son enseignement, se laisse aller à une négligence qui lui est douce : il ne garde de la méthode mutuelle que son extérieur pour ainsi dire : l’école languit, les résultats sont mauvais » (Lorain, 1837, p. 104). Ainsi l’école mutuelle sera abandonnée.
La fin de l’enseignement mutuel : une forme de renoncement à la dimension émancipatrice de l’école et à son efficience
Pourtant, au tournant du XIXe siècle, dans la littérature de l’époque, les rapports sur cette méthode sont souvent très élogieux [1]. La méthode impressionne : « L’élève est constamment situé au degré dont il s’est montré actuellement capable ; de la sorte, l’avantage unique de l’enseignement individuel se trouve conservé et reproduit tout entier au sein d’une masse considérable. Chacun est aussi actif et plus actif même que s’il était seul. Il se corrige par l’exemple d’autrui, il corrige son camarade par son exemple, il est tenu incessamment en haleine pour l’action et la révision. (...) Tour à tour, élèves et répétiteurs, ils ne font que transmettre ce qu’ils ont reçu, indiquer ce qu’ils ont tenté eux-mêmes avec succès. La portion la plus difficile, la plus délicate, la plus ignorée du rôle de l’instituteur, je veux dire la bonne direction des facultés, s’accomplit en quelque sorte toute seule pour cet exercice toujours régulier, progressif, dans lequel l’attention des enfants est entretenue ; l’émulation, la sympathie imitative s’accroissent par une classification plus vraie, qui rapproche mieux les analogies et gradue mieux l’échelle à gravir » [2]. Ce rapport, signé du Ministre de l’Intérieur Français, du 13 janvier 1818, reprend ensuite les avantages non négligeables qu’a l’école mutuelle sur celle des Frères des Écoles Chrétiennes, déjà bien performante : « elle ne suppose pas que tous les élèves aillent à la même vitesse, et brise ainsi l’uniformité du groupe d’élèves (…). Si dans la méthode simultanée tous les regards doivent se tourner vers le maître-adulte, ici les moteurs du progrès pédagogique sont la sympathie imitative entre élèves, et l’émulation. Cette technologie d’apprentissage secondarise la place du maître-adulte qui devient, plutôt qu’un enseignant, un “surveillant” : économiquement, elle signifie que moins de maîtres seront nécessaires, et c’est ce que retient la Société pour l’amélioration de l’instruction élémentaire en 1817 » (Querrien, 2005, 77-79).
Querrien (2005) étudie plus particulièrement ce phénomène dont le caractère émancipateur avait échappé à Foucault. Car, au premier abord, l’enseignement mutuel apparait comme un dispositif d’assujettissement plus efficace que l’enseignement simultané : tous les apprentissages s’y font beaucoup plus rapidement. Les élèves apprennent en deux ans ce que ceux de l’enseignement des Frères apprennent en presque six ans. En outre, pour qu’un tel système fonctionne, il y a une pratique du contrôle absolu dans ces écoles : l’emploi du temps, de l’espace et du matériel est calculé de manière minutieuse et la discipline est maintenue par un système de récompenses et de sanctions. Foucault voit dans l’enseignement mutuel une forme impitoyable du pouvoir disciplinaire où tout est cloisonné, contrôlé et où chacun, en concurrence avec l’autre, surveille relayant ainsi le commandement du maître. « On peut dire qu’il s’agit là de l’image du collectif disciplinaire hégémonique (ou « normal ») : une multiplicité d’individus sous le commandement d’un maître et n’entrant en rapport les uns avec les autres que sur le mode de la compétition pour la quête de la première place » (Pallotta, 2017, p. 3). Querrien (2005), tout en documentant l’efficacité du système, y voit d’autres dimensions comme nous le verrons dans ce chapitre.
Mais qu’est-ce qui rend l’enseignement mutuel si « efficace » ? Est-ce parce qu’il implique nécessairement ce que nous appellerions aujourd’hui une pédagogie différenciée ? Puisque le groupe n’y est pas vu comme uniforme et donc pas soumis à une unique progression. « Chaque élève n’a que la place qui lui revient en fonction de ce dont il s’est montré capable, et chacun est mobilisé en permanence. Cette activité permanente des élèves se manifeste de deux manières : soit l’élève apprend et se corrige auprès d’un camarade, soit l’élève enseigne à son camarade » (Pallotta, 2017, p. 5-6). En fait, la « différenciation pédagogique » y est beaucoup plus qu’une technologie, un simple élément « d’ingénierie didactique », elle rentre dans un ensemble qui, certes, autorise l’apprentissage de tous les élèves, mais bien plus que cela encore. C’est ce que ne soupçonnait pas Foucault.
Car Foucault et Querrien ne traitent pas les mêmes sources et pas de la même façon. Pour Foucault qui analyse les écoles mutuelles au tournant du XIXe comme une séquence du processus de disciplinarisation de l’enseignement dans l’histoire longue en Occident (XIVe-XIXe) « l’antagonisme passe entre les programmes des dispositifs disciplinaires souhaités par les gouvernants ». Alors que chez Querrien qui s’attarde beaucoup plus sur les différentes archives des écoles mutuelles au tournant du XVIIIe siècle (apparemment sous les conseils de Foucault), « l’antagonisme passe au sein même des classes dirigeantes. En effet, elle montre la division des classes dominantes elles-mêmes (entre industriels du Nord et élites plus traditionnelles par exemple) à propos de l’école mutuelle, comme si la potentialité émancipatrice de cette pratique pédagogique n’avait pas été perçue : l’école mutuelle a échappé, en partie, à son but strictement conformiste et disciplinaire » (Pallotta, 2017, p. 3).
Querrien fait alors une hypothèse qu’il faudrait un jour mettre à l’épreuve du présent : dans les écoles mutuelles, plus que des apprentissages cognitifs, les élèves sont plongés dans une organisation désirante : « désir collectif, désir inquiétant par nature car on ne sait pas bien où il peut bien mener (…) le désir de savoir et le désir d’apprendre circulent intensément dans le collectif « mutuel » : l’imitation du pair qu’est le camarade engendre une mécanique désirante que rien ne semble arrêter » (Pallotta, 2017, p. 6). Un phénomène nouveau apparait : les élèves n’obéissent plus à l’autorité personnelle du maître, autorité qu’il tient lui-même de Dieu, dans un système simultané, mais à la loi (Querrien, 2005) et « la discipline mutuelle est entièrement tournée vers le seul but pédagogique de l’apprentissage, mais surtout le plus original tient à la relation entre les élèves (…). Elle postule que chacun doit, à un moment, être en mesure d’enseigner : l’élève apprend à obéir pour commander à son tour » (Pallotta, 2017, p. 6).
Instruction et éducation sont donc dispensées dans les écoles mutuelles, qui sont non seulement efficaces, mais également efficientes puisque tout le processus se déroule à moindre coût. Alors pourquoi avoir évincé l’enseignement mutuel au profit de l’enseignement simultané ?
Nous avons vu, dans le passage précédent, que l’Eglise catholique voulait continuer à contrôler l’enseignement et qu’elle a manœuvré pour la mise à mort de l’école mutuelle, mais la seule volonté d’une institution n’aurait pas suffi si elle n’avait pas rencontré des alliés (Latour, 1984) : les élites conservatrices, s’étaient plaintes auprès du Ministre Guizot. Elles voyaient dans cet enseignement « le terreau possible de constitution de militants socialistes ou communistes » (Pallotta, 2017, p. 9). Elles n’avaient pas tort puisque nombreux sont les leaders de la Commune à avoir été des élèves de l’école mutuelle (Querrien, 2005). « L’apprentissage fondamental de l’école mutuelle pour cette génération a peut-être été l’apprentissage d’une prise de confiance en son intelligence, et l’apprentissage conjoint du renforcement de son intelligence dans le cadre d’une mise en œuvre collective des capacités de chacun » (Pallotta, 2017, p. 9). La suppression de l’école mutuelle correspond au renoncement à une école de la transmission au bénéfice d’une école de la correction. Priorité accordée à l’éducation sur l’instruction, voilà le point commun que partagent les discours hostiles à l’égard de l’enseignement mutuel, que ces derniers soient portés par des ultras-royalistes ou des républicains » (Jouan, 2017, p. 104).
La pédagogie différenciée : d’une pratique intégrée à une ingénierie pédagogique
Comme vu précédemment, la forme d’enseignement mutuel intègre la nécessité de ne pas faire comme si tous les élèves devaient apprendre la même chose en même temps en suivant la même progression. Il s’agit d’une « pédagogie différenciée intégrée », puisque dans cette forme d’enseignement, la différence entre les élèves n’est pas interrogée, pas reliée à un âge, un genre ou une origine sociale, et elle est entièrement délivrée de la rigueur des classifications trop générales et trop absolues. La différenciation est pensée comme dans l’enseignement individuel dans le sens où chaque élève est toujours à sa place et apprend à son rythme. Mais elle est encore davantage que ça, car ici, l’élève est même plus actif que s’il était seul. En apprenant à l’autre, il se corrige par l’exemple d’autrui et corrige son camarade par son exemple. La différenciation n’est donc pas seulement un moment spécifique, une « pédagogie différenciée injectée », simple élément d’une ingénierie pédagogique sans souffle, qui réduit la différenciation à des périodes de remédiation au risque de laisser s’installer les inégalités hors de ces moments ou de la restreindre à des groupes de niveaux stables mettant à mal la mise en place d’un véritable tronc commun. Dans une conception mutualisée de l’enseignement, la prise en compte des différences d’apprentissage est intégrée dans l’organisation même de l’enseignement, mobilisant chaque élève en permanence de manière différenciée. Il n’est alors pas question de parler de pédagogie différenciée, mais plutôt d’une organisation de l’enseignement où chacun est considéré pour ce qu’il apprend, stimulé par la volonté d’enseigner à d’autres et où « l’évaluation » a pour visée essentielle d’organiser les apprentissages.
En ce qui concerne plus spécifiquement la ou les pédagogies différenciées, c’est seulement durant la deuxième moitié du XXe siècle, que l’expression est officialisée par Louis Legrand (1984) qui la définit comme la prise en compte de la diversité des élèves à l’aide d’une diversification méthodologique. Mais déjà au tournant du XXe siècle, de nombreux réformateurs scolaires (généralement impliqués par la suite dans le mouvement d’éducation nouvelle en Europe ou aux Etats-Unis) revendiquent la nécessité de sortir de l’enseignement simultanée et de prendre en considération la singularité de chaque élève ; une multiplicité d’expérimentations hétérogènes voient le jour pour répondre à cette nouvelle revendication. Si aujourd’hui, le mouvement d’éducation nouvelle est souvent considéré comme un mouvement homogène, il suffit de s’attarder sur les écrits et les expérimentations des réformateurs de ce mouvement, pour repérer de fortes tensions internes (politiques, épistémologiques mais aussi éthiques). Concernant cette nécessité de différencier (et/ou d’individualiser les enseignements), certains réformateurs invoquent des raisons psycho-physiologique et/ou économiques (« l’éducation doit respecter l’originalité de chaque enfant » mais souvent dans l’objectif d’insérer chaque enfant là où il sera plus utile à la société : « the right man at the right place ») ; d’autres enfin, des questions politiques ou éthiques (« adapter l’école à la société » pour les libéraux ou « transformer la société par l’école » pour les communistes, les anarchistes et les socialistes). Dans ce mouvement hétérogène, apparaissent les premiers tests d’intelligence et d’instruction (voir Decroly) mais aussi des outils d’individualisation des apprentissages (comme les divers systèmes de fiches personnalisées permettant pour chacun un plan de travail individuel). Mais si ces nouvelles théories rencontrent un franc succès en Occident, dans le milieu académique et politique, leurs mises en application restent bien souvent limitées à quelques institutions scolaires durant la première moitié du XXe siècle (Roland, 2017).
C’est un demi-siècle plus tard, vers la fin des années 1960, que Louis Legrand, inventeur du terme « pédagogie différenciée », impulsa un grand mouvement dans les collèges français (1ère et 2ème année du secondaire). Il s’agit d’expérimenter les premiers regroupements d’élèves en groupe de niveau-matière-homogènes. Pour les mathématiques, le français et la langue vivante, les élèves sont regroupés en « groupes de niveau-matières » de 24 élèves maximum qui ne doivent pas représenter plus du tiers de l’horaire des élèves. Tandis qu’en histoire, géographie, sciences naturelles, enseignements artistiques, ils appartiennent à des classes traditionnelles dans lesquelles, comme ordinairement, on rencontre des élèves de différents niveaux. « La classe, comme division stable, disparait. Un ensemble de 90 à 100 élèves est confié à un ensemble de 5 à 10 professeurs. Les professeurs, au vu des élèves qui leur sont confiés, organisent les groupes, aménagent les programmes et définissent les pédagogies qui conviennent à chaque groupe » (Legrand, 1995, p. 37). L’objectif est de montrer que les filières scolaires, alors en cours dès le début de l’école secondaire, n’ont plus lieu d’être. Cette nouvelle pédagogie doit permettre à tous les élèves d’intégrer la filière « supérieure » dans la hiérarchie scolaire. Autrement dit, cette expérimentation vise, d’abord, à montrer que des organisations et des pratiques pédagogiques particulières peuvent permettre à tous les élèves de bénéficier du même enseignement et par conséquent, rendre caduque le système de filières. Mais l’expérimentation, principalement enfermée dans la forme d’enseignement simultané, ne créera pas le désir et l’émulation repérés dans l’enseignement mutuel. La quasi-absence de mobilité des élèves de faibles niveaux, qui ne parviendront pas à rejoindre les groupes de niveaux supérieurs, amènera les militants pédagogiques à conclure à l’inefficacité pédagogique de la pratique des groupes de niveaux. Peut-on en retenir que l’expérimentation n’a pas su ou pu « amoindrir », voire anéantir les dimensions viciées de l’École ? Il reste que, pour la première fois dans l’histoire des tentatives de prises en compte des différences entre élèves, fut introduite la volonté d’amener tous les élèves aux mêmes visées d’apprentissage et que le projet politique de ces mêmes militants s’accomplira avec le collège unique mis en place en 1975 (Kahn, 2010).
Plus proche de nous (1995 en Belgique ; 1989 en France ; 2000 au Québec), les cycles d’apprentissage ont représenté une occasion inespérée d’intégrer une différenciation pédagogique dans le cours du processus d’enseignement apprentissage. Avec les cycles, il s’agit, en effet, de décloisonner la temporalité scolaire puisque le bilan sommatif des apprentissages devrait se faire à la fin d’un cycle de deux ou trois ans (selon les pays). La classe, telle que pensée dans la forme simultanée, n’existe plus au profit d’un cycle qui regroupe deux ou trois classes et deux ou trois enseignants, pour 40 à 80 élèves. Les textes programmatiques des trois pays enjoignaient alors les enseignants à pratiquer « pédagogie différenciée » et « évaluation formative » tout en veillant à la continuité des apprentissages pour la Belgique. Mais bien que décrétant les cycles, les trois pays ne sont pas parvenus à une réorganisation administrative cohérente. La scolarité a continué à être officialisée en années successives avec un enseignant responsable d’une classe de 15 à 25 élèves de même âge, des bulletins de notes (ou d’appréciations) rendus à échéances régulières entrainant ainsi la passation d’évaluations sommatives, etc. Bref, la mise en place des cycles a reposé sur les seules épaules des enseignants sans que ne soit assouplie la forme dans laquelle s’inscrivent leurs activités et sans véritable accompagnement. Avec les cycles, les concertations prennent un caractère obligatoire et sont encadrées. Des investigations menées dans les écoles de la Communauté française (Belgique), dans les écoles de l’Académie de Lyon (France) et les écoles de la Commission scolaire de la Capitale (Québec) montrent cependant qu’elles sont principalement consacrées à régler des questions pratiques et bureaucratiques dans un grand nombre d’écoles (Kahn, 2008), les équipes sont assez démunies quant aux compétences organisationnelles et le processus de controverse qu’implique l’arrivée des cycles dans les établissements scolaires (Garant, Letor & Bonami, 2010). Les enseignants restent alors convaincus que travailler ensemble nécessite de « bien s’entendre », « il faut que la chimie prenne » (Kahn, 2008). Effectivement, « la chimie n’a pas pris » et hormis quelques écoles engagées qui ont su marquer l’essai, comme c’est le cas de la Maison des trois espaces à Saint Fons dans la banlieue lyonnaise (Maison des trois espaces, 1993), les cycles n’ont jamais été véritablement mis en place et ni les enseignants, ni l’institution, ne se sont véritablement emparés du jeu autorisé par les cycles et de l’assouplissement de la forme scolaire qu’ils permettaient.
Il reste que depuis les années septantes, le nombre d’ouvrages publiés concernant la thématique de la différenciation pédagogique témoigne de la préoccupation qu’elle constitue pour les enseignants. Selon les auteurs et les époques, il y est proposé la pratique de groupes de besoins (Meirieu, 1985) en remplacement des groupes de niveau ; l’adaptation des consignes et des supports à différentes formes d’intelligences ou de profils (Gardner, 1999, de La Garanderie, 1980) ; la prise en compte des dénivelés de culture (Perrenoud, 1997) et des malentendus socio-didactique ou socio-cognitifs (Kahn, 2010), ou, du côté Nord-Américain, des activités tous azimuts (Caron, 2002, Tomlinson, 2003, Hume, 2009) qui, d’une certaine façon « poussent » les enseignants à aller toujours plus loin et plus précisément dans le contrôle : contrôle des élèves, contrôle des apprentissages, contrôle de soi. D’après certains auteurs, les caractéristiques des élèves sont quasiment infinies. Nous ne le nions pas. Mais sont-elles toutes également pertinentes quand il s’agit de leur faire apprendre des savoirs ? Mettons le focus sur Hume (2009), car son ouvrage constitue une synthèse de la grande majorité des discours existant sur la diversité et la différenciation pédagogique. Hume liste 17 axes qui différencient les personnes, cela va des émotions à la disposition à apprendre un nouveau concept (p. 70). Elle y rajoute quatre styles d’apprentissage, de l’élève autonome qui préfère choisir et expérimenter à l’élève axé sur les sentiments et l’imagination en passant par l’élève qui préfère l’utilité et la simplicité et celui qui préfère la recherche, les théories et la réflexion. Viennent ensuite les styles d’apprentissage liés aux sens (visuel, auditif, tactile, kinesthésique) ; les formes d’intelligences, au nombre de trois ou huit ou neuf selon les auteurs (Sternberg ou Gardner). Il faut y rajouter les champs d’intérêt des élèves (p. 73-86). Bref, le croisement de ces différentes variables conduit à plusieurs centaines de possibilités de différences. N’y-a-t-il pas de quoi donner le vertige ? Nous n’aborderons pas ici le fait que la théorie des intelligences multiples « ne repose sur aucune recherche empirique, n’est étayée par aucune publication scientifique, et s’apparente dès lors bien plus à une vérité révélée qu’à un modèle scientifique congruent » (Mottint, 2018).
L’ensemble de ces prescriptions, discours, publications engluent les enseignants dans une sauce doxique : comme s’ils devaient différencier coute que coute. Alors qu’observations et suivis d’enseignants montrent qu’un grand nombre d’entre eux finissent assez vite à perdre tout contrôle quand ils se lancent dans des actions de pédagogie différenciée, au détriment des élèves les moins scolairement dotés (Kahn, 2010) et de la perspective d’une véritable École démocratique et démocratisante.
C’est ce qui se passe dans ces exemples un peu caricaturaux : des séquences bi-hebdomadaires désignées comme « pédagogie différenciée » par l’enseignant. Les élèves y remplissent le nombre de fiches qu’ils veulent. Ils vont les montrer à l’enseignant qui leur en donne une nouvelle. Mais aveuglé par les demandes incessantes d’élèves rapides et efficaces, l’enseignant ne voit pas les quatre élèves qui restent durant toute l’heure sur la même fiche sans la remplir. Les fiches ne sont pas ramassées par l’enseignant et séances après séances, ce sont les mêmes élèves qui ne rentrent pas dans les activités. Dans une autre classe de 2ème année de l’école primaire, les chercheurs voient en octobre les faibles lecteurs travailler avec des documents de la classe précédente. À la fin de l’année scolaire, les mêmes élèves travaillent toujours des supports de lecture très appauvris (Rey et al., 2003). Hors de ces exemples proches de la caricature, dès que les enseignants se lancent dans des opérations de pédagogie différenciée, le risque que les élèves se trouvent face à des objets d’apprentissage différents, avec des contrats didactiques différentiels est élevé (Sensevy, 2011), au détriment des élèves les moins avancés. Autre problème, pour une grande partie des enseignants, la pédagogie différenciée, quand elle n’est pas individualisation des enseignements-apprentissages doit, dans l’idéal, s’organiser en groupes de niveau dans une conception remédiatrice de l’aide aux élèves (Kahn et Belsack, 2018). La difficulté scolaire est donc attribuée aux seuls élèves et non à la rencontre entre leur culture et la culture scolaire, entre leurs préconceptions et le nouveau savoir enseigné, dans une conception de la différenciation pédagogique comme luttant contre les « diffractions du phénomène d’enseignement-apprentissage » (Kahn, 2010). Autrement dit, nous pourrions parler d’une certaine urgence à, d’une part, ne plus attribuer la difficulté scolaire aux seuls élèves (Giambarresi, 2017), donc à penser aux spécificités des savoirs enseignés et des rapports qu’élèves et étudiants entretiennent avec l’école et ses savoirs (Baillet & Rey, 2015), ce qui veut dire aussi une certaine urgence à accompagner les futurs enseignants et les enseignants à passer d’une pensée intra-objectale à une pensée inter-objectale pour penser la difficulté et l’échec scolaires (Piaget & Garcia, 1983) et à, d’autre part, faire la hiérarchie des dimensions à considérer dans le phénomène d’enseignement-apprentissage et ne pas s’arque-bouter sur les moins pertinentes, les rapports au savoir des élèves plutôt que leurs formes d’intelligence ; les compétences, plutôt que les procédures à automatiser (Rey, 2014), par exemple. Mais, s’il paraît effectivement nécessaire que les enseignants tentent de comprendre ce qui se joue dans la rencontre de leurs élèves avec le savoir et la culture scolaire, s’il paraît effectivement intéressant qu’ils s’intéressent et s’interrogent sur les préconceptions et les obstacles qui vont troubler les apprentissages, qu’ils débusquent les « savoirs transparents » (Margolinas & Laparra, 2011) fatalement intégrés à leurs enseignements et à leurs attendus, s’il parait effectivement intéressant qu’il y ait des temps de réflexion sur les pratiques et les conceptions qui les soutiennent, si les avancées des travaux de didactiques et de socio-didactiques, des sciences cognitives peuvent éclairer des phénomènes, etc. il paraît en revanche complétement illusoire de s’imaginer que le phénomène d’enseignement-apprentissage puisse être complétement explicite et explicitable. Peut-être est-il raisonnable de lâcher du lest et ne pas prétendre tout contrôler, voire accepter de ne pas tout comprendre, de surmonter les situations d’incertitude. Peut-être est-il raisonnable de s’en remettre a minima à l’élève, à sa capacité d’apprendre, de se faire enseigner par d’autres élèves, d’enseigner à d’autres élèves, de trébucher, de rebondir ? Peut-être est-il raisonnable de développer solidarité, entraide et coopération entre élèves dans les classes et les écoles, à l’instar de ce qui pouvait exister dans l’enseignement mutuel ? C’est pourquoi nous plaidons pour des pédagogies qui libèrent temps et espaces, donnant à l’enseignant une autre posture que celle d’un simple relais du « pouvoir disciplinaire » entre contrôle et remédiation, à la pédagogie différenciée une dimension intégrée, collée à même la vie de la classe. Comme a pu peut-être le faire, en son temps, l’enseignement mutuel ; comme peuvent l’être les pédagogies qui contribuent à fonder une véritable coopération entre élèves leur assurant la sécurité indispensable à l’acte d’apprendre (Connac, 2009). Il ne s’agit pas d’inviter l’enseignant à ne plus s’occuper des apprentissages des élèves, tout au contraire, mais sa préoccupation première n’est pas de tenter de caractériser les élèves selon des profils prédéfinis, mais plutôt de caractériser les savoirs qu’il enseigne, d’anticiper les obstacles à la lumière des travaux de la didactique, d’observer (sans nécessairement intervenir) les élèves et l’élève face à un nouveau savoir et à une tâche complexe, etc. C’est ce que nous nous permettons d’appeler, pour reprendre les propos de Bourdieu (2016), une « pédagogie rationnelle » (mais aussi cohérente et congruente).
Une première tentative de conclusion
Nous avons vu que la forme d’enseignement scolaire constitue un creuset puissant de construction de différences entre les élèves et que, de surcroit, l’hégémonie de cette forme s’est imposée pour de mauvaises raisons. Nous avons évoqué qu’à l’intérieur de cette forme d’enseignement, la différenciation pédagogique peut être passive ou active (Kahn, 2010) :
– passive, quand l’enseignant n’a pas la volonté de différencier, mais que, de fait, ses pratiques sont différenciatrices, c’est-à-dire qu’elles créent des apprentissages différents chez ses élèves, toujours au détriment des élèves les plus scolairement dépendants et fragiles. C’est obligatoirement ce qui se passe dans toute pédagogie (Chopin, 2011 ; Maurice et Murillo, 2008).
– active, quand l’enseignant a des pratiques de pédagogie différenciée et que ces dernières contribuent à creuser les écarts d’apprentissage entre les élèves, toujours au détriment des élèves les plus scolairement dépendants et fragiles (Rey et al., 2003).
Nous avons évoqué une distinction entre une différenciation pédagogique intégrée au fonctionnement d’une classe, soit une pédagogie où le groupe est concerné par les apprentissages de chacun et de tous (Brigaudiot, 2015 ; Connac, 2009) et une différenciation pédagogique « injectée » sous la pression de l’enseignant qui répond ainsi à une pression institutionnelle et morale qui peut mener à des dérives différenciatrices, toujours au détriment des élèves les plus scolairement dépendants et fragiles. Bref, la pédagogie différenciée est une opération extrêmement délicate qui peut contribuer aux inégalités scolaires.
35À ce temps précis de la réflexion, nous pouvons simplement penser que moins une pédagogie différenciée est intégrée au fonctionnement ordinaire de la classe, moins elle est l’affaire du groupe classe (élèves et enseignants) dans son entier, moins elle est pensée a priori, moins elle prend en compte spécificités des savoirs à apprendre et plus elle est risque d’être différenciatrice, c’est-à-dire augmenter les écarts d’apprentissages au détriment des élèves les plus fragiles.
Bibliographie
Baillet, D., Rey, B. (2015). Rapport au savoir, pratiques d’études et culture disciplinaire à l’université. Dans M. F. Carnus, V. Vincent, P. Perrenoud (dir.), Le rapport au(x) savoir(s) au cœur de l’enseignement (p. 147-158). De Boeck Supérieur.
Bédouret, T. (2003). « Tutorat »,« monitorat » en éducation : mises au point terminologiques. Recherche & formation, 43(1), 115-126.
Bourdieu, P. , Passeron, J. C. (2016). Les héritiers : les étudiants et la culture. Minuit.
Brigaudiot, M. (2015). Enseigner à l’école. Langage et école maternelle. Hatier.
Bugnard, P. (2016). Un pédagogue à l’origine de l’école actuelle le père Grégoire Girard (1765-1850) : textes essentiels et biographie. Alphil.
Caron, J. (2002). Apprivoiser les différences. Guide sur la différenciation des apprentissages et la gestion des cycles. Montréal : Chenelière éducation.
Chopin, M.- P. (2011). Le temps de l’enseignement. L’avancée du savoir et la gestion des hétérogénéités dans la classe. Presses Universitaires de Rennes.
Compère, M.-M. (1985). Du collège au lycée. Généalogie de l’enseignement secondaire français (1500-1850). Gallimard
Connac, S. (2009). Apprendre avec les pédagogies coopératives. ESF Editeur.
Faillet, V. (2017). La Métamorphose de l’école quand les élèves font la classe. Descartes & Cie.
Foucault, M. (1972). Histoire de la folie à l’âge classique. Gallimard.
Foucault, M. (1975). Surveiller et punir. Gallimard.
Foucault, M. (2003). Le Pouvoir psychiatrique. Cours au Collège de France (1973-1974). EHESS-Gallimard-Seuil.
Garant, M., Letor, C., Bonami, M. (2010). Leadership et apprentissage organisationnel. Dans L. Corriveau (dir.). Travailler ensemble dans les établissements scolaires et de formation : Processus, stratégies, paradoxes (p. 63-77). De Boeck Supérieur.
Giambaresi, C. (2017). Les conceptions de la différence et de la difficulté scolaire chez les futurs enseignants (mémoire de Master non publié). Université Libre de Bruxelles, Belgique.
Goffman E. (1987). Le parler frais d’Erving Goffman. Editions de Minuit.
Hume, K. (2009). Comment pratiquer la pédagogie différenciée avec de jeunes adolescents ? De Boeck supérieur.
Joigneaux, C. (2011). « Forme scolaire et différenciation des élèves à l’école maternelle. Un cas d’école ». Dans J.-Y. Rochex, J. Crinion (dir.). La construction des inégalités scolaires (p. 147-155). Presses Universitaires de Rennes.
Jouan, S. (2020). La classe à plusieurs cours à l’épreuve de la forme scolaire dominante. Histoire et persistances du modèle pédagogique de la classe homogène en France du 19ème siècle à nos jours. Thèse de doctorat en Sciences de l’éducation soutenue le 21 février 2020, Université Lumière Lyon 2.
Kahn, S. (2010). Pédagogie différenciée. De Boeck.
Kahn, S. (2011). « La relativité historique de la réussite et de l’échec scolaires ». Education et Francophonie, 39(1), 54-66.
Kahn, S., Belsack, E. (2018). « Pédagogie différenciée et doxa : quand l’arbre cache la forêt ». Dans S. Kahn, C. Delarue-Breton, G. Ferone, (dir). Les enseignants et leur métier : entre doxas et incertitudes (p. 85-96). Education et Formation.
Latour, B. (1984). Les Microbes. Guerre et paix. Métailié.
Legrand, L. (1984). La différenciation pédagogique. Scarabée, CEMEA.
Lorain, P. (1837). Tableau de l’instruction primaire en France. Hachette.
Maison des trois espaces. (1993). Apprendre ensemble, apprendre en cycles : Avec la Maison des trois espaces, classes maternelles et primaires. ESF.
Margolinas, C., Laparra, M. (2011). Des savoirs transparents dans le travail des professeurs à l’école primaire. Dans J.-Y. Rochex, J. Crinon (dir.). La construction des inégalités scolaires (p. 19-32), Presses Universitaires de Rennes.
Maurice, J.-J., Murillo, A. (2008). La distance à la performance attendue : un indicateur des choix de l’enseignant en fonction du potentiel de chaque élève. Revue Française de Pédagogie, 162, 67-79.
Meirieu, P. (1985). L’école, mode d’emploi. Des méthodes actives à la « pédagogie différenciée ». ESF Editeur.
Mottint, O. (2018). Inconsistance et dangers du culte des différences en pédagogie. http://www.skolo.org/2018/01/08/inconsistance-dangers-culte-differences-pedagogie/
Pallotta, J. (2017). L’école mutuelle au-delà de Foucault. EuroPhilosophie Éditions.
Perrenoud, P. (1997). Pédagogie différenciée. Des intentions à l’action. ESF Editeur.
Piaget, J., Garcia, R. (1983). Psychogenèse et histoire des sciences. Flammarion.
Poucet, B. (2009). Petite histoire de l’enseignement mutuel : l’exemple du département de la Somme. Carrefours de l’education, 2009/1 (27), 7-18.
Querrien, A. (2005). L’école mutuelle. Une pédagogie trop efficace ? Seuil.
Rey, B., Kahn, S., Ivanova, D., Robin, F. (2003). Elaboration d’un outil d’aide au fonctionnement pédagogique des cycles d’apprentissage à l’école primaire. Recherche commanditée par le Communauté française. Rapport terminal. www.agers.cfwb.be/prof/dossiers/recheduc (lien inactif)
Rey, B. (2014). La notion de compétence en éducation et formation : enjeux et problèmes. De Boeck.
Roland, E. (2017). Généalogie des dispositifs éducatifs en Belgique du XIVe au XXe siècle. Disciplinarisation et biopolitique de l’enfance : des grands schémas de la pédagogie à la science de l’éducation (thèse de doctorat non publié). Université Libre de Bruxelles, Belgique.
Roland E. (2018) « Le mouvement d’éducation nouvelle : tensions et controverses ». Conférence présentée lors du Colloque international « Regards croisés sur les pratiques pédagogiques en pédagogie active » du 21 au 23 mars 2018, Bruxelles. En ligne : http://www.colloque-pedactives-cocof.com/files/uploads/2019/01/20190110_Cocof_recueil_web.pdf (lien inactif)
Sensevy, G. (2011). Le sens du savoir. Éléments pour une théorie de l’action conjointe en didactique. De Boeck.
Talhaoui, A. (2017). Pédagogies actives et milieux populaires : étude de cas des pratiques d’enseignement au sein d’un pouvoir organisateur d’une commune bruxelloise. Mémoire de Master en Sciences de l’éducation. Université libre de Bruxelles.
Tomlinson, C. A. (2003). La classe différenciée. Chenelière éducation.


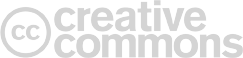
Répondre à cet article
Suivre les commentaires : |
|
