Elisabeth Plé et Laurence Dedieu, « Développer des modes de pensée à travers un dispositif mettant en œuvre un jeu de rôle en Education au Développement Durable : une étude de cas », Éducation et socialisation [En ligne], 76 | 2025, mis en ligne le 30 juin 2025, consulté le 01 septembre 2025. URL : http://journals.openedition.org/edso/33767 ; DOI : https://doi.org/10.4000/148mq
Un des enjeux de l’éducation au développement durable (EDD) est de faire acquérir aux jeunes les compétences qui leur permettront, une fois adultes, de participer au débat public, prendre position et agir sur les questions de développement durable (DD) en faisant preuve d’esprit critique et de créativité (UNESCO Education 2030 - Déclaration d’Incheon, 2016). C’est dans la perspective de monter des projets ayant cette ambition que nous avons mis en place une recherche collaborative sur deux années mobilisant deux enseignantes-chercheures, des enseignants d’école primaire et collège, ainsi que des conseillers pédagogiques. La première année a permis d’échanger sur les pratiques effectives des enseignants en matière d’EDD en plus d’explorer et commenter la littérature tournée vers l’enjeu précédemment énoncé. La seconde année a été consacrée à la mise en œuvre d’un projet dans deux classes, pour lequel les maîtres d’œuvre étaient les enseignants des deux classes et deux conseillères pédagogiques. Ces dernières étaient habituées à travailler selon cette modalité car elles ont eu l’occasion de participer à une précédente recherche collaborative dont la thématique était la problématisation dans les activités scientifiques. La particularité du fonctionnement du groupe était telle que c’était l’équipe enseignante engagée dans le projet qui concevait les activités. Cette équipe présentait de manière régulière l’état du travail réalisé dans la classe au groupe de recherche, ce qui faisait l’objet de discussions, échanges et de remarques. La conception des séquences et l’évolution du travail de classe ont donc été laissées à l’appréciation de l’équipe enseignante.
Cadre théorique et problématique
En matière d’éducation au développement durable, Lange (2014a) distingue différentes actions éducatives qu’il qualifie de formes « d’éducation faible » lorsqu’il s’agit, selon une conception behavioriste, d’un simple apprentissage de gestes ou bien de formes « d’éducation forte », lorsque l’action repose sur la mise à jour de controverses socio-scientifiques par des débats et vise alors une transformation sociétale via le développement de dispositions collectives et proactives. C’est dans cette seconde approche, avec en point de mire la volonté de développer l’engagement des élèves, que s’inscrit notre projet de recherche.
La notion d’engagement a fait l’objet de travaux variés conduisant à repérer différentes formes (Redondo, 2020). Dans le champ des Questions Socialement Vives (QSV), Simonneaux et Simonneaux (2017) et Legardez et Simonneaux (2011) identifient un gradient d’engagement dont un premier niveau serait la motivation des élèves et leur intérêt pour une question donnée. Le niveau le plus abouti serait une forme d’activisme où la capacité des individus à prendre position et à prendre des décisions de manière raisonnée dans un processus collectif est complétée par l’exercice de la persuasion en vue d’influencer les décideurs et de développer des actions pour améliorer le bien-être des individus, des sociétés et de l’environnement. Barrué (2014) et Barrué et Grenier (2021), proposent un modèle d’Education Citoyenne critique et émancipatrice pour l’étude des questions socio-scientifiques (QSS), dans lequel ils repèrent trois niveaux successifs d’engagement de l’élève futur citoyen, allant de l’expression de son opinion et la confrontation à celle d’autrui, à la prise de position et pour finir, à la prise de décisions. Selon Normand (2017), l’engagement nécessite un apprentissage expérientiel (au sens de Dewey, 1968) mobilisant l’attitude active des élèves et la mise en œuvre de stratégies de coopération et de mutualisation. Lange et Barthes (2020) défendent, quant à eux, un engagement donnant une place importante à l’initiative et la créativité au sein d’un collectif où se combinent « le faire et le dire, l’action et la réflexion et une éthique de la responsabilité mise au service d’une créativité sociale ». Cette éducation émancipatrice et créative est, selon eux, une condition pour dépasser les inhibitions aujourd’hui observées chez les jeunes tant au niveau épistémique (immensité de la tâche à accomplir) que social (doute sur ce qui peut être fait à l’échelle individuelle). C’est dans cette acceptation de l’engagement que nous nous inscrivons.
Parmi les actions éducatives dites « fortes » au sens de Lange (2014b), le jeu de rôle semble être une approche prometteuse pour favoriser l’engagement des élèves. Chen et Martin (2015) repèrent dans sa mise en œuvre quatre critères clés de l’apprentissage dit transformatif théorisé par Mezirow (2009) : se focaliser sur le changement et pas seulement sur l’acquisition de connaissances ; révéler les comportements dans un contexte réel ; mettre en évidence ce qui influence le comportement (émotions et pensées internes mais aussi points de vue et expériences d’autrui) ; inclure une approche de résolution de problèmes qui exige une recherche de solution.
Le jeu introduit par lui-même une motivation favorable à l’engagement dans l’activité et est porteur d’apprentissage. Il implique un effet de distanciation qui favorise la conscientisation et la compréhension des situations. En jouant le rôle d’un autre, on comprend mieux ses préoccupations, ses priorités, ce qu’il ressent, ce qu’il pense. Le jeu de rôle permet ainsi le développement de l’empathie. L’expérience est un autre élément clé de l’apprentissage présent dans le jeu de rôle. A l’instar de Dewey, nous ne mettons pas en opposition expérience et savoirs académiques et soutenons l’idée que l’expérience est un levier favorable à la construction et la mobilisation des savoirs. Elle permet en outre une prise de conscience chez l’apprenant (Piaget, 1977) favorisant la mise en mots et les échanges avec les autres ainsi que la compréhension de l’action. Pour finir, le groupe constitutif du jeu de rôle est un autre élément soutenant l’apprentissage. Il favorise, au travers du conflit socio-cognitif généré par la confrontation des idées, savoirs et représentations avec d’autres que soi, la co-construction du savoir et une certaine compréhension des éléments conscients et inconscients qui orientent les comportements (Patin, 2005).
Différentes typologies de jeux de rôle ont été décrites dans la littérature. Pour le domaine de l’EDD qui nous concerne ici, nous en retiendrons deux. Celle de Matas (2003) envisage quatre catégories : l’étude documentaire ou de cas ; le jeu d’interprétation où le participant se voit attribuer un rôle avec un descriptif aussi précis que possible ; la simulation à travers le jeu et la simulation numérique. Celle de Barrué (2014) identifie quant à elle deux catégories selon que la préparation du jeu mette les élèves en situation de construire l’argumentation des personnages dont ils endossent le rôle (Albe, 2005 ; Said et Schneeberger, 2007 ; Hingant, 2013) ou pas. Dans le second cas, les élèves disposent alors de cartes-rôles leur livrant des arguments préconstruits qu’ils s’approprieront lors du jeu (Simonneaux, 2003 ; Colucci-Gray, 2007 ; Belova, Eilks et Feierabend, 2015 ; Chalmeau et al., 2019). On comprend dès lors que le type de jeu de rôle choisi oriente fortement la nature des apprentissages.
Notre question de recherche vise, à partir d’un exemple de dispositif original d’EDD finalisé par un jeu de rôle dont on définira les caractéristiques, à analyser les formes de pensée (pensée créative et pensée critique) que ce dispositif privilégie pour favoriser l’engagement des élèves. À la suite de Bailin (2002), nous soutenons qu’une certaine dose de créativité est nécessaire au développement de la pensée critique. Selon Lubart, Mouchiroud, Tordjman et Zenasni (2003), la créativité se définit comme la capacité à générer une production nouvelle originale et adaptée aux contraintes de la réalité. D’autres auteurs (Guildford, 1950 ; Piccardo, 2016) y ajoutent l’idée de complexité. Lubart (2017) propose un modèle pour analyser la créativité. Cette approche connue sous le nom de « 7C » intègre sept dimensions, les créateurs, le processus créatif, les contextes de création, les créations ou productions créatives, les collaborations nécessaires à l’activité créative, la consommation des créations et la formation à la créativité. Le processus créatif peut être analysé à deux échelles (Botella, Nelson et Zenasni, 2016). L’échelle macro identifie les étapes du processus. L’échelle micro vise à déterminer les mécanismes à l’œuvre dans la création d’idées. C’est sur cette échelle que portera notre analyse en se focalisant sur deux des microprocessus les plus étudiés : la pensée divergente et la pensée convergente. La pensée divergente se définit comme la capacité à générer des idées nombreuses et variées (Runco, 1991), tandis que la pensée convergente conduit à n’en retenir qu’une seule (Chermahini et Hommel, 2012). En ce qui concerne la pensée critique et le contexte favorable à son développement, nous nous rallions à Rapanta et Iordanou (2023) qui avancent que l’argumentation en est la manifestation observable. C’est donc au prisme de la construction de l’argumentation par les élèves que nous dégagerons la capacité de ce dispositif EDD à mobiliser leur pensée critique. A noter que ce travail ne vise pas à analyser les arguments construits par les élèves, mais à identifier les savoirs que le dispositif leur permet de convoquer pour construire leur argumentation.
Le développement de la pensée critique (Fuchs-Gallezot et Bächtold, 2023) n’est cependant pas l’apanage des situations éducatives d’EDD. Les enseignants engagés dans le dispositif analysé dans cet article sont d’ailleurs plus habitués à développer l’argumentation de leurs élèves à partir de situations d’investigation empirique en sciences. Cela nous amène à comparer comment joue la pensée critique dans les situations mises en place dans ce dispositif EDD et dans celles de sciences avec apprentissage par problématisation. Ce point sera développé dans la discussion.
Méthodologie
Dispositif pédagogique
Contexte
L’étude s’est déroulée à partir d’un projet mis en œuvre dans deux classes, une classe de CM1-CM2 (9-10 et 10-11 ans) d’une école élémentaire de Troyes (Aube, Région Grand Est, France) et une classe de sixième (11-12 ans) d’un collège du même secteur. La conception et le suivi du projet pédagogique ont mobilisé quatre personnes : l’enseignante de la classe de CM1-CM2, le professeur de Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) de la classe de sixième, la coordonnatrice du Réseau d’Education Prioritaire et la coordonnatrice du réseau d’actions scientifiques pour l’école. Les enseignantes-chercheures, autrices de cet article, ont donné pour consignes à l’équipe de concevoir un projet qui s’inscrive dans une « éducation forte » (au sens de Lange, 2014a) et qui engage les élèves dans un débat autour d’une question socio-scientifique qui les concerne dans leur environnement proche. Elles ne sont pas intervenues, ni sur la conception, ni sur le suivi du projet. Ce projet, finalisé par la réalisation d’un jeu de rôle rassemblant les élèves des deux classes, est certes fictif, mais fortement lié au territoire dans lequel vivent les élèves. Il s’agissait pour eux de concevoir un nouvel espace de vie impliquant de transformer radicalement le territoire où sont ancrés leurs établissements scolaires et leurs habitations pour le rendre agréable et durable.
Déroulement
En amont du projet, les élèves des deux classes ont, avec leurs enseignants respectifs, travaillé sur l’énergie, ses différentes sources et formes et le fonctionnement d’objets techniques nécessitant de l’énergie. Le scénario pédagogique du projet s’est organisé en plusieurs étapes. Les élèves ont d’abord été invités, par petits groupes et par classe, à imaginer un territoire de vie agréable et durable sous la forme d’une maquette. Lors d’une seconde séance de travail, les concepteurs du projet ont introduit des contraintes amenant les élèves à apporter des aménagements dans leur territoire et à se poser des questions quant à la nature et la pertinence de ces aménagements. Ces contraintes ont été suggérées aux élèves par l’apport de photos montrant, selon les groupes, un château d’eau, un réseau souterrain de canalisations, des lignes électriques aériennes, des routes, des voitures, des courses alimentaires … qu’ils devaient mettre en relation avec des besoins de la population sur le territoire qu’ils avaient imaginé (besoins de se déplacer, de s’alimenter, d’énergie…). Les concepteurs du projet ont alors organisé une rencontre forum avec des experts, pour permettre aux élèves d’obtenir des informations et/ou réponses à certaines de leurs questions. Douze experts ont ainsi été réunis : un urbaniste, un spécialiste de bâtiments basse consommation, un apiculteur, un conseiller municipal, un spécialiste d’une chaudière bois/paille qui alimente des bâtiments publics, un représentant de la régie de l’eau de la ville, des membres d’une association de défense des pistes cyclables, des membres d’une fédération de pêche, un spécialiste de la distribution de l’électricité, un spécialiste de la qualité de l’air et des représentants de diverses associations de quartier. Le forum a été suivi d’une mutualisation des informations collectées par les élèves. Enfin, un débat sous forme de jeu de rôle a été mis en place. Il a été préparé 30 minutes avant la séance. Les élèves, répartis par groupes, ont été informés à ce moment-là du sujet à débattre – prendre position par rapport à l’implantation d’un parc d’attraction dans leur quartier – et de leur rôle, attribué par tirage au sort. Ils ont alors rédigé leurs arguments en remobilisant les connaissances construites lors des étapes précédentes.
Lors du jeu de rôle, les élèves ont été répartis autour de tables disposées en cercle. Le professeur de SVT, qui jouait le rôle du maire, a introduit la problématique devant son conseil municipal dont les membres étaient joués par les trois autres porteurs du projet et les invités experts, joués par les élèves. Notons qu’un expert n’était pas représenté par un seul élève, mais par un petit groupe ; chacun des participants pouvant prendre la parole lors du débat au nom du groupe.
Méthode de recueil et d’analyse des données
Afin d’analyser ce que le dispositif décrit précédemment mobilise comme modes de pensée chez les élèves, nous avons collecté deux types de données. D’une part, le document rédigé par l’équipe décrivant le projet, d’autre part, les intentions visées par celle-ci via des entretiens semi-directifs auprès de deux de ses membres, le professeur de SVT et la coordonnatrice du réseau d’actions scientifiques pour l’école. Les deux entretiens ont fait l’objet d’un enregistrement audio et ont été réalisés par la même chercheure. La grille d’entretien a été élaborée par les deux chercheures, après lecture du scénario pédagogique décrit dans le document projet. Il s’agissait d’obtenir des précisions sur le scénario et les choix qui l’ont guidé ; sur la place et le rôle du forum et du jeu de rôle dans le dispositif ; sur le positionnement des enseignants par rapport aux savoirs et aux experts sollicités lors du forum ; sur leur rôle tout au long du projet.
Les entretiens ont été retranscrits et analysés de façon croisée par les deux chercheures.
L’analyse générale des données a porté sur les deux axes suivants : les conditions favorisant la mise en œuvre d’un processus créatif et les conditions favorisant la pensée critique.
Le processus créatif en jeu dans le dispositif a été analysé en référence aux travaux de Botella, Nelson et Zenasni (2016) du point de vue des microprocessus permettant de caractériser les mécanismes soutenant la création d’idées. Parmi ces microprocessus, nous avons retenu la pensée divergente et la pensée convergente, dont nous avons recherché la mobilisation dans le dispositif. L’analyse du développement de la pensée critique des élèves a, quant à elle, été approchée par l’identification des types de savoirs mobilisables par les élèves dans le dispositif pour construire leur argumentation et par les conditions de mise en œuvre de celle-ci. Les savoirs en jeu dans les différentes phases de travail du dispositif ont été catégorisés selon trois mondes d’exploration : scolaire, « hors-école » et « entre-deux ».
Résultats
Analyse du dispositif du point de vue du processus créatif
À l’instar de Lange (2015), nous considérons le processus créatif dans les projets EDD comme une condition essentielle de l’engagement citoyen futur des élèves, une sorte de transformation d’eux-mêmes (Joas, 1992) les amenant à faire preuve de créativité, en particulier de « créativité sociale ». Le dispositif décrit dans cet article montre que le scénario se construit « chemin faisant », en faisant appel à l’imagination des élèves, en s’appuyant sur leur autonomie et leur capacité à accéder à l’information et à la mutualiser. D’autre part, il est finalisé par un débat sous forme de jeu de rôle, sorte de point d’orgue du dispositif, dans lequel les arguments ne sont pas livrés aux élèves, mais nécessitent une construction faisant appel à diverses sources et mettant en jeu une communauté toute entière (ici, constituée par les deux classes). Cette conception du dispositif fait appel à la créativité sociale des acteurs, acteurs qu’il ne convient pas de réduire aux élèves, mais à toute l’équipe engagée. Dans un précédent article (Dedieu et Plé, 2023), en nous référant aux 7C de la créativité de Lubart (2017) et aux travaux de Capron-Puozzo (2016), nous avons analysé la créativité dans ce dispositif et montré que ce dernier intègre outre plusieurs créateurs (élèves, équipe enseignante), quatre autres facettes de la créativité. Le processus créatif est en effet alimenté tout au long du projet qui n’est pas écrit d’avance. Le contexte du projet (en relation avec l’environnement proche et les préoccupations des élèves) favorise l’expression de la créativité. Par ailleurs, le projet mobilise plusieurs créations, matérielles et immatérielles (maquettes, échanges d’information, synthèses). Enfin, il valorise des collaborations diversifiées (entre pairs chez les élèves et au sein de l’équipe et entre élèves et experts) requises pour l’activité créative. Nous prolongeons ici cette analyse en identifiant dans le dispositif la mobilisation des pensées divergente et convergente, en tant que microprocessus sous-jacents à la création d’idées (Botella, Nelson et Zenasni, 2016). Le tableau ci-après en propose un relevé au cours des différentes étapes.
Tableau 1 : mobilisation des différentes formes de pensée créative dans le dispositif
Comme l’indique la coordonnatrice du réseau d’actions scientifiques pour l’école, l’introduction des contraintes pour revisiter le territoire idéal sous forme de photos non légendées, laisse l’interprétation libre, ce qui favorise les propositions des élèves par une exploration de l’espace des possibles. Par ailleurs, les mises en commun pour mutualiser les propositions et les organiser selon une nouvelle configuration, favorisent la pensée convergente, une convergence créative dont le but n’est toutefois pas de proposer une solution unique, mais une solution combinant différentes idées. Lors de la préparation du jeu de rôle, les élèves exercent de nouveau la pensée convergente lorsqu’il s’agit de définir leurs arguments en cohérence avec le rôle qu’ils ont à endosser et après avoir pris connaissance de la situation. Finalement, les deux formes de pensée, divergente et convergente, exercées de manière successive et impulsées par le dispositif pédagogique, se complètent pour garantir la production d’idées pertinentes qui viendront en réponse à la situation proposée lors du jeu de rôle.
Analyse du dispositif du point de vue du développement de la pensée critique
Analyse des savoirs mobilisés dans le dispositif
Ce dispositif, comme le rappellent les enseignants interviewés, est finalisé par l’idée de faire acquérir un esprit critique par rapport à des annonces sociétales, aux futurs écocitoyens que sont les élèves engagés dans ce travail. L’exercice de cet esprit critique se fera au moyen du jeu de rôle sur lequel ce dispositif débouche. Pour jouer leur rôle, les élèves vont devoir tenir des positions et les argumenter ce qui nécessite de maitriser une forme de savoir assez éloignée des savoirs scolaires. Nous allons examiner la construction de ce type de savoir.
Les élèves vont mobiliser deux grandes formes de savoir (Fig. 2). Tout d’abord un « savoir scolaire » construit en amont du dispositif (séquence sur l’énergie) dans un cadre scolaire classique, essentiellement autour des questions énergétiques. Puis, la rencontre avec les experts du territoire les amène à découvrir ce que nous nommerons, avant de le caractériser plus précisément, « le savoir des experts ». Quant au « savoir documentaire », il est une forme de savoir « à portée de mains des élèves » vers laquelle ils se dirigent spontanément, avant de quitter le monde scolaire et rencontrer les nouveaux protagonistes que sont ces experts. Il n’a pas de fonction cognitive particulière et joue essentiellement, selon les propos de la coordonnatrice du réseau d’actions scientifiques pour l’école, un rôle de tranquillisant.
Dans ce dispositif, les élèves vont être confrontés à trois mondes, où les savoirs mobilisés jouent des rôles différents.
Dans le « monde scolaire », les élèves mobilisent les savoirs scolaires acquis essentiellement pour modifier les maquettes réalisées, passer d’un territoire rêvé à un territoire raisonné qui est conçu comme une réponse aux contraintes apportées par l’enseignant. Cette étape est aussi l’occasion de s’accorder entre les deux classes sur une liste de besoins à satisfaire pour que le territoire conçu soit vivable et durable (se nourrir, se déplacer, se chauffer, faire du sport, bénéficier de loisirs…). On note un fort investissement des élèves, car ce territoire sur lequel ils travaillent est le leur. Ils sont attachés à le transformer collectivement et certains d’entre eux en oublient même le caractère fictif du projet, comme en témoigne la coordonnatrice du réseau d’actions scientifiques pour l’école : « Parce qu’il y en a qui se sont tellement investis, ils se sont tellement projetés dans le sujet que … ils ont cru que ça allait vraiment leur arriver ». Le fort engagement est aussi dû au caractère ludique de la situation et à l’autonomie accordée aux élèves qui doivent prendre des décisions en groupe. À propos du jeu de rôle, l’enseignant de SVT reconnait : « des élèves que je connaissais, moi parmi mes collégiens, qui n’étaient pas forcément très impliqués habituellement dans la tâche scolaire, ils se sont prêtés au jeu, ça se voit, très bien. Ils avaient une grande attention, une grande motivation ».
Les deux classes vont ensuite vers les experts lors d’un forum, avec une liste de questions communes établies de manière consensuelle avec les deux classes. Cette rencontre est assez intimidante pour les élèves, car ils entrent dans le monde « hors-école » qui leur est étranger, celui de la gestion de savoirs pratiques liés à la vie du territoire. La coordonnatrice du réseau d’actions scientifiques pour l’école signale en effet que l’échange n’a pas été facile pour les élèves, car « ils étaient un peu passifs quand même… ils ont été impressionnés ». Le temps de rencontre étant limité, seuls huit experts ont été consultés par chacun des groupes. Cette restriction rend la mutualisation de l’information nécessaire pour chacune des deux classes sous la houlette de l’enseignant. Ce dernier, absent dans la transmission de ces savoirs pratiques, retrouve un rôle dans leur reformulation et leur mise en forme dans les cahiers des élèves.
Enfin, le jeu de rôle se situe dans un monde entre-deux. La situation est à la fois scolaire, car gérée par l’ensemble de la communauté enseignante engagée dans le projet, mais elle met en scène une situation où la responsabilité citoyenne des élèves est engagée, car ils doivent se prononcer sur la réalisation d’un projet modifiant complètement l’aménagement de leur territoire de vie quotidienne. Pour examiner ce projet, ils doivent endosser le rôle d’un expert, autrement dit, développer un argumentaire en s’appuyant sur le savoir dudit expert.
Analyse du dispositif du point de vue des conditions favorisant l’argumentation
Comme signalé par les concepteurs du projet, la finalité du dispositif est de permettre aux élèves de développer leur pensée critique et de l’exercer lors du jeu de rôle qui en est l’aboutissement. Seulement 30 minutes avant sa réalisation, les élèves découvrent la situation sur laquelle ils auront à débattre : la construction d’un parc d’attraction dans leur quartier. Cette situation ne leur est pas inconnue puisqu’elle a été proposée par l’un des groupes. De ce fait, elle se révèle fortement attractive et suscite d’emblée l’enthousiasme de tous. Cependant, comme rapporté par la coordonnatrice du réseau d’actions scientifiques pour l’école, des élèves ont réalisé « qu’il y avait des choses qui n’étaient pas dites » dans le cahier des charges qui leur a été remis pour préparer le jeu de rôle. En effet, en étudiant ce cahier des charges (raser une partie du quartier pour implanter le parc, plantation de 400 arbres, plantation de plus de 200 espèces de fleurs différentes, implantation de bâtiments basse consommation, création d’un canal et d’un plan d’eau, création de 30 emplois, tarif d’entrée dans le parc d’attraction de 23€), les élèves prennent conscience que celui-ci contient implicitement toute une série de désagréments et de nuisances. Ils découvrent ainsi que la mise en place du parc impose des expropriations ou encore, la destruction d’arbres, même si des plantations sont prévues par la suite dans le parc. Ils discutent par exemple de la pertinence de l’implantation d’un parc d’attraction au sein même de la ville, ce qui va certes rapporter des revenus à la municipalité permettant le développement de diverses infrastructures, mais risque de créer des nuisances sonores bien au-delà des enceintes de ce parc, y compris pour le cimetière, non mentionné dans le projet, mais dont ils connaissent l’existence dans leur quartier. Ils examinent aussi l’hypothèse de délocaliser le parc en dehors de la ville, solution qui selon eux minimise les nuisances sonores, mais pour laquelle le transport des visiteurs augmente la consommation d’énergie ainsi que la pollution atmosphérique, tout en privant la ville d’apports financiers… La situation ainsi choisie non seulement mobilise fortement les élèves, mais favorise aussi l’exercice de leur pensée critique.
Le fait que la situation soit portée à la connaissance des élèves seulement une demi-heure avant le jeu de rôle, laisse peu de temps à ces derniers pour préparer leurs arguments. La plupart sont inspirés par les étapes antérieures, notamment la mutualisation consécutive à la rencontre avec les experts et les recherches documentaires spontanées, mais d’autres arguments se construisent dans l’action, pendant le jeu de rôle.
En même temps que les élèves découvrent la situation, ils prennent connaissance du rôle d’expert qui leur est attribué par tirage au sort et qu’ils doivent endosser. Compte tenu du dispositif et des activités qui ont précédé le jeu de rôle, ils construisent leur argumentaire en lien avec le rôle tiré au sort, tout en ayant connaissance de la position associée aux autres rôles. Cette particularité renforce l’empathie (ils connaissent les arguments des autres experts et peuvent comprendre leur position) et la recherche d’un compromis. L’enseignant de SVT qui orchestre le jeu de rôle final signale ainsi un moment emblématique dans le débat. Les élèves prennent conscience que la suppression de la forêt est problématique dans leur projet d’aménagement : « (…) certains se proposaient de replanter des choses, de faire des jardins à la place, de faire des bâtiments avec des toits en herbe ». Enfin, le rôle attribué juste avant le débat concerne un collectif, dans la mesure où ce n’est pas un élève qui l’endosse, mais un groupe d’élèves au sein duquel chacun peut intervenir au nom de l’expert que le collectif représente. Ainsi, chaque élève appartient à une double communauté, un groupe d’experts et un groupe représentant un type d’experts, ce qui nécessite pour chacun une attention particulière à l’autre, une écoute, un respect des points de vue, autant de compétences essentielles pour développer la pensée critique et former l’écocitoyen de demain.
Discussion - conclusion
C’est au prisme de l’argumentation construite par les élèves, que nous avons examiné les conditions pour développer leur pensée critique. Remarquons qu’une des réponses de l’équipe enseignante conceptrice du projet pour développer l’engagement des élèves, a été de solliciter leur autonomie. L’autonomie est ici entendue au sens de Kant, c’est-à-dire non comme une liberté sans limites, mais comme le fondement d’une « responsabilité solidaire », autrement dit un « pacte intersubjectif selon lequel la responsabilité envers soi-même que chacun est en mesure d’exercer est la condition essentielle, non seulement de la responsabilité de l’autre envers soi, mais aussi du lien social qui existe entre deux sujets » (Barbot et Camatarri, 1999, p. 26). Pris dans ce sens, la responsabilité engendrée par l’autonomie est la capacité du sujet à répondre de ses propres actions, à prendre en charge la possibilité de se tromper en acceptant les conséquences de ses erreurs comme de ses réussites. Pour ce faire, le dispositif n’impose pas une norme qui obligerait les élèves à obéir, mais offre un pouvoir aux élèves. Il s’agit ici du pouvoir d’aller collecter des informations auprès des experts ce qui, nous l’avons vu, n’est pas spontané, car cela oblige les élèves à changer de monde, passer du monde des savoirs scolaires à celui des savoirs professionnels, les documentaires étant là pour les épauler. C’est aussi le pouvoir d’endosser un rôle d’expert au cours d’un débat et d’argumenter des prises de position dans une situation qui n’est pas apprêtée, tout en exerçant leur pensée critique en débusquant en particulier toutes sortes de nuisances et désagréments que la situation alléchante à l’étude ne laissait pas apparaître… Ce rôle d’expert est endossé à partir des savoirs collectés auprès de professionnels. Ces savoirs nourrissent l’argumentation, mais celle-ci se construit en plus dans l’interaction au sein de la communauté de figurants d’experts, les élèves prenant rapidement conscience de la divergence des points de vue et de la nécessité de composer entre eux pour construire une solution collective inédite. Cette construction est rendue possible par la créativité du dispositif qui combine cinq des sept facettes de la créativité (Lubart, 2017) et permet l’exercice des pensées convergente et divergente en amont du jeu de rôle. La pensée créative, dans le dispositif que nous avons analysé, est donc au service de la pensée critique.
La situation de ce jeu de rôle avec les contraintes spécifiques exposées fait, comme le soulignaient Haeberli, Audigier et Freudiger (2015) dans un contexte un peu différent (à partir d’une situation où la liberté individuelle est en jeu), que les points de vue construits par chacun sont certes nourris par les savoirs et informations disponibles, mais surtout par les significations que les élèves accordent, dans l’interaction, à la situation de débat proposée. Autrement dit, rapidement se construit un argument de communauté (Breton, 2001) autour de la question de « vivre en commun » et plus spécialement ici, « qu’est-ce qu’on gagne/ qu’est-ce qu’on perd » qui sert de référence partagée afin d’éprouver l’argumentation élaborée par chacun des protagonistes du jeu de rôle. Ce jeu de rôle original relève donc à la fois de la simulation suivant la typologie de Matas (2003) et du jeu avec construction de l’argumentation, si on se réfère à Barrué (2014).
Notons toutefois que les enseignants embarqués dans la construction de ce dispositif étaient plus familiers des activités scientifiques que du traitement des questions écocitoyennes. À l’instar de Fuchs-Gallezot et Bächtold (2023) ainsi que Jimenéz-Aleixandre et Puig (2012), nous pensons que les situations d’argumentation collective en classe à partir de questions scientifiques ou de questions socio-scientifiques sont des moyens privilégiés pour contribuer au développement de la pensée critique des élèves. Cependant, les compétences d’esprit critique construites dans l’un et l’autre de ces domaines sont-elles de même nature ?
Afin d’examiner de plus près cette question, nous avons comparé (Tableau 2) la pratique de la coordonnatrice engagée depuis très longtemps dans des recherches collaboratives avec notre équipe (Plé et Vasseur, 2023), dans des activités visant à construire des savoirs scientifiques dans le cadre d’apprentissage par problématisation (A) et dans cette activité d’EDD (B) que nous venons de présenter.
Tableau 2 : comparaison de deux situations (activités scientifiques A / EDD B), menées par la coordonnatrice-enseignante du projet, où l’argumentation est centrale
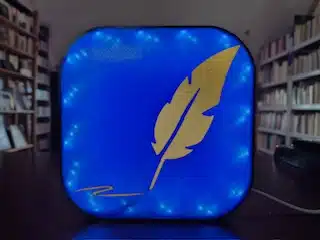
Dans le cas A, les savoirs sont l’objet de la construction et, comme le soulignent Orange et Orange Ravachol (2023, p. 137), « développement de la pensée critique et construction de savoirs sont donc indissociablement liés ». Dans le cas B, les savoirs sont reçus, servent à endosser un rôle et à développer une argumentation pour échafauder une solution collective. Ainsi, dans le cas A, les savoirs se construisent grâce à l’argumentation, alors que dans le cas B, ils permettent la construction de l’argumentation.
Si l’autonomie, l’argumentation et la pensée critique sont centrales tant, dans les activités scientifiques mobilisant le cadre de la problématisation, que dans les activités d’EDD, conduites par cette enseignante, elles y jouent cependant des fonctions bien différentes mais complémentaires pour la formation de l’esprit. À l’ère de l’Anthropocène, les activités d’EDD, nécessaires pour développer l’engagement des élèves, ne doivent toutefois pas se substituer aux activités scientifiques indispensables à la construction de l’autonomie intellectuelle de l’élève.
Enfin, si cette étude a le mérite de présenter un dispositif mettant en œuvre un jeu de rôle original, elle présente bien sûr des limites, dans la mesure où dans le présent article, nous nous sommes limitées à analyser les caractéristiques de ce dispositif pour développer la créativité et l’esprit critique des élèves, sans avoir la possibilité d’étudier l’impact réel sur leur apprentissage.
Bibliographie
Albe, V. (2005). Un jeu de rôle sur une controverse socio-scientifique actuelle : une stratégie pour favoriser la problématisation ? Aster, 40, 67-94.
Bailin, S. (2002). Critical thinking and science education. Science & Education, 11(4), 361-375.
Barrué, C. (2014). L’enseignement des thèmes de convergence au collège : mise en débat d’une question socioscientifique en classe pour une éducation citoyenne [Thèse de Doctorat, ENS de Cachan-Université Paris Saclay].
Barrué, C. et Grenier, D. (2021, 31 mars – 2 avril). Un jeu de rôle pour la scolarisation d’une question socioscientifique : la question des énergies renouvelables [Com. orale]. Colloque de l’ARDIST, Bruxelles.
Barbot, M. J. et Camatarri, G. (1999). Le principe d’autonomie. Dans M. J. Barbot et G. Camatarri (Eds), Autonomie et apprentissage. L’innovation dans la formation (p. 7-48). Presses Universitaires de France.
Belova, N., Eilks I. et Feierabend T. (2015). The evaluation of role-playing in the context of teaching climate change. International Journal of Science and Mathematics Education, 13(Suppl 1), 165-190. https://doi.org/10.1007/s10763-013-9477-x
Botella, M., Nelson, J. et Zenasni, F. (2016). Les macro- et microprocessus créatifs. Dans I. Capron Puozzo (Eds.), La créativité en éducation et en formation. Perspectives théoriques et pratiques (p. 33-46). De Boeck.
Breton, P. (2001). L’argumentation dans la communication. La Découverte.
Bronckart, J. P. (1996). Activité langagière, textes et discours. Delachaux et Niestlé.
Capron-Puozzo, I. (2016). Créativité et apprentissage : dilemme et harmonie. Revue française de pédagogie, 197, 5-12. https://doi.org/10.4000/rfp.5130
Chalmeau, R., Julien, M. P., Calvet, A., Léna, J. Y. et Vergnolle Mainar, C. (2019). Le jeu de rôle en EDD pour dépasser une pensée binaire : une étude de cas à l’école primaire. Éducation et didactique, 1, 83-104. https://doi.org/10.4000/educationdidactique.3829
Chen, J. C. et Martin, A. R. (2015). Role-play simulations as a transformative methodology in environmental education. Journal of Transformative Education, 13(1), 85-102. https://doi.org/10.1177/1541344614560196
Chermahini, S. A. et Hommel, B. (2012). Creative mood swings : divergent and convergent thinking affect mood in opposite ways. Psychological research, 76, 634-640. https://doi.org/10.1007/s00426-011-0358-z
Colucci-Gray, L. (2007). An investigation on role-play about controversial socio-environmental issues, and how this can educate for a nonviolent approach to the resolution of conflicts [PhD’s thesis, Centre for Science Education, Open University, UK] http://www.iris-sostenibilita.net/iris/docs/pubblicazioni/Colucci-Gray_PhDThesis.pdf
Dedieu, L. et Plé, E. (2023). A sustainable development project including a role-play : analysis of teachers’ intentions to promote students’ engagement. Environmental Education Research, 29(8), 1104–1117. https://doi.org/10.1080/13504622.2023.2185573
Dewey, J. (1968). Expérience et éducation. Armand Collin.
Fuchs-Gallezot, M. et Bächtold, M. (2023). L’esprit critique dans l’enseignement des sciences : quelles approches ? Quelles prises en charge par la recherche ? Quelles prises en charge scolaires ? RDST Recherches en didactique des sciences et des technologies, 28, 9-30. https://doi.org/10.4000/rdst.5066
Guilford, J. P. (1950). Creativity. American Psychologist, 5, 444-454.
Haeberli, P., Audigier, F. et Freudiger, N. (2015). Des élèves débattent et argumentent à propos du développement durable. Valeurs en jeux, enjeux de valeurs. Dans N. Muller Mirza & C. Buty (Eds), L’argumentation dans les contextes de l’éducation. Peter Lang.
Hingant, B. (2013). Les nanotechnologies dans l’enseignement secondaire : une recherche sur la compréhension des controverses “nanos” par des lycéens [Thèse de Doctorat, ENS de Cachan, Institut Néel de Grenoble].
Jiménez-Aleixandre, M. et Puig, B. (2012). Argumentation, evidence evaluation and critical thinking. In B. Fraser, K. Tobin et C. McRobbie (Eds.), Second international handbook for science education, vol. 2 (p. 1001-1017). Springer.
Joas, H. (1992). La créativité de l’agir. Édition du Cerf (1999, trad.).
Lahire, B. (2001). La construction de l’« autonomie » à l’école primaire : entre savoirs et pouvoirs. Revue Française de Pédagogie, 134, 151-161.
Lange, J.M. (2014a). Curriculum possible de l’Éducation au Développement Durable : entre actions de participation et investigations multiréférentielles d’enjeux. Éducation relative à l’environnement. https://doi.org/10.4000/ere.691
Lange, J.M. (2014b). Des dispositions des personnes aux compétences favorables à un développement durable : place et rôle de l’éducation. Dans A. Diemer (Ed.), Education au développement durable : Enjeux et controverses (p. 163-182). De Boeck Supérieur.
Lange, J.M. (2015). Éducation et engagement : La participation de l’École à relever les défis environnementaux et de développement. Éducation relative à l’environnement. https://doi.org/10.4000/ere.441
Lange, J.M. et Barthes, A. (2020). Déterminants de l’engagement de jeunes en fin de scolarité obligatoire vis-à-vis des enjeux de durabilité/soutenabilité. Dans M. Barroca-Paccard and S. Demers (Eds.) Crise écologique : citoyennetés en lutte et éducation (p. 1-21. Numéro spécial EducationS). ISTE.
Legardez, A.et Simonneaux, J. (2011). Développement durable et autres questions d’actualité : questions socialement vives dans l’enseignement et la formation. Educagri éditions.
Lubart, T. I., C. Mouchiroud, S. Tordjman et F. Zenasni. (2003). Psychology of Creativity. Armand Colin.
Lubart, T.I. (2017). The 7 C’s of Creativity. The Journal of Creative Behavior, 51, 293-296. https://doi.org/10.1002/jocb.190
Matas, A. (2003). Los juegos de rol como recurso formativo. Una aplicación en educación ambiental. Bordón. Revista de pedagogía, 55(2), 281-291.
Mezirow, J. (2009). Transformative learning theory. Dans J. Mezirow and E. Taylor and Associates (Eds.) Transformative learning in practice (p. 8-32). Jossey-Bass.
Normand, R. (2017). Empowerment/Capacitation. Dans A. Barthes, J.M. Lange et N. Tutiaux-Guillon (Eds.), Dictionnaire critique des enjeux et concepts des « éducations à » (p. 419-425). L’Harmattan.
Orange, C. et Orange Ravachol, D. (2023). Pensée critique et savoirs en SVT : un point de vue depuis le cadre théorique de l’apprentissage par problématisation. RDST. Recherches en didactique des sciences et des technologies, 28, 115-142. https://doi.org/10.4000/rdst.5201
Patin, B. (2005). Le jeu de rôles : pratique de formation pour un public d’adultes. Les cahiers internationaux de Psychologie sociale, 67-68, 163-178.
Piaget, J. (1977). The Development of Thought. Equilibration of Cognitive Structures. Basil Blackwell.
Piccardo, E. (2016). Créativité et complexité : quels modèles, quelles conditions, quels enjeux ? Dans I. Capron Puezzo (Ed.), La créativité en éducation et formation. Perspectives théoriques et pratiques (p. 47-64). De Boeck.
Plé, E. et Vasseur, I. (2023). Les effets de recherches collaboratives à l’épreuve du temps : des écrits instrumentaux en situation d’argumentation à l’école maternelle. Dans P. Roy, C. Orange & M.N. Hindryckx (Eds), Construire et mobiliser des savoirs en éducation scientifique et dans le champ des « éducations à » au moyen des recherches participatives (p. 133-149). Presses universitaires de Liège.
Rapanta C. et Iordanou K. (2023). Argumentation and critical thinking. In R. Tierney, F. Rizvi et K. Ercikan (Eds.), International Encyclopedia of Education (4e éd, p.575-587). Elsevier.
Redondo, C. (2020). La place de la notion d’empowerment dans le champ de l’éducation au développement durable : Quels transferts entre développements théoriques et traductions pratiques ? Spirale-Revue de recherches en éducation, 66(3), 151-164.
Runco, M. A. (1991). Divergent thinking. Ablex Publishing Corporation.
Said, F. et Schneeberger P. (2007). Etude du discours argumentatif chez les élèves français de seconde concernant une controverse socio-scientifique. Actes des XXVIIIes Journées Internationales sur la communication, l’Education et la culture Scientifiques, Techniques et Industrielles. Chamonix.
Simonneaux, L. (2003). Argumentation dans les débats en classe sur une technoscience controversée. Aster, 37, 189-214.
Simonneaux, L. et Simonneaux, J. (2017). STEPWISE as a Vehicle for Scientific and Political Educ-action ? Dans L. Bencze (Ed.), Science and Technology Education Promoting Wellbeing for Individuals, Societies and Environments. Cultural Studies of Science Education (Vol. 14). Springer, Cham. http://doi-org-443.webvpn.fjmu.edu.cn/10.1007/978-3-319-55505-8_27
UNESCO. (2015, 19-22 mai). Education 2030 : Incheon déclaration and framework for action : towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all. World Education Forum, Incheon, Republic of Korea.





Répondre à cet article
Suivre les commentaires : |
|
