Un article de Serge Abiteboul, François Bancilhon ,repris du blog binaire, une publication sous licence CC by

binaire : Judith, peux-tu nous dire qui tu es, d’où tu viens ?
JR : Je suis au départ une juriste, professeure de droit privé à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Au début, je m’intéressais aux grandes notions juridiques classiques, dont la propriété privée. Puis, sous le coup de rencontres et d’opportunités, j’ai exploré deux directions : le droit du numérique d’un côté ; et, avec un groupe de travail composé d’économistes, d’historiens, de sociologues, les « communs » dans la suite des travaux d’Elinor Ostrom (*), d’un autre côté. Cela m’a amenée à retravailler, entre autres, la notion de propriété. Par la suite, pour concrétiser certains des résultats de ces réflexions, j’ai dirigé, avec Marie Cornu et Fabienne Orsi, la rédaction d’un dictionnaire des biens communs. Aujourd’hui, je m’intéresse particulièrement à toutes les formes de biens communs et de communs, principalement en matière numérique et de données ainsi qu’en environnement.
binaire : Pourrais-tu préciser pour nos lecteurs les notions de « biens communs » et de « communs » ?
JR : Le vocabulaire n’est pas complètement stabilisé et peut varier suivant les interlocuteurs. Mais si l’on tente de synthétiser, on parlerait de « biens communs » pour saisir des biens, ressources, milieux, etc., à qui est associé un intérêt commun socialement, collectivement et juridiquement reconnu. Ce peut être l’intérêt d’une communauté nationale, internationale ou l’intérêt de groupes plus locaux ou restreints. On peut prendre l’exemple des monuments historiques : en 1913, on a assisté à des combats législatifs épiques pour faire reconnaître qu’il fallait les identifier, les classer, et admettre qu’ils présentaient un intérêt pour la nation française dans son ensemble ; qu’en conséquence, leurs propriétaires, fussent-ils privés, ne pouvaient pas avoir sur eux de pleins pouvoirs (comme le voudrait l’application de la propriété classique), jusqu’à celui de les détruire ; qu’ils devaient tenir compte de l’intérêt pour d’autres (voire pour les générations à venir), avec des conséquences juridiques importantes (l’obligation de les conserver dans leur état, de demander une autorisation pour les modifier, etc.).
Il existe d’ailleurs divers intérêts communs reconnus : l’intérêt historique et/ou artistique d’un monument ou d’autres biens culturels, l’intérêt environnemental ou d’usage commun d’un cours d’eau ou d’un terrain, l’intérêt sanitaire d’un vaccin, etc.
Mais précisons la terminologie. D’abord, il faut différencier entre « biens communs » et le « bien commun » discuté, par exemple, dans « Économie du bien commun » de Jean Tirole. Le second renvoie davantage à l’opposition entre bien et mal qu’à l’idée d’un intérêt commun.
Ensuite, il faut distinguer « biens communs » et « communs ». Avec la notion de « communs » (dans le sens que lui a donné Elinor Ostrom), on ajoute l’idée d’une organisation sociale, d’un gouvernement de la ressource par la communauté. C’est cette communauté qui gère les accès, les prélèvements, les différents droits…, et assure avec cela la pérennité de la ressource. C’est le cas par exemple pour un jardin partagé, un tiers-lieu, ou une encyclopédie en ligne telle que Wikipédia, administrés par leurs utilisateurs ou un groupe de personnes dédiées.
Un commun se caractérise typiquement par une communauté, une ressource que se partage cette communauté, et une gouvernance. Dans un bien commun, on n’a pas forcément cette gouvernance.
binaire : Cela conduit bien-sûr à des conflits avec la propriété privée ?
JR : On a souvent tendance à opposer les notions de biens communs ou de communs au droit de propriété privée, très belle avancée de la révolution française en termes d’émancipation et de reconnaissance d’un espace d’autonomie sur ses biens au bénéfice de l’individu propriétaire. Reconnaître qu’un bien porterait un intérêt commun poserait des limites au pouvoir absolu que la propriété renferme, en imposant la considération de l’intérêt d’une communauté. Cela peut être vrai dans certains cas, comme celui des monuments historiques évoqué.
Mais c’est oublié qu’il peut y avoir aussi une volonté du propriétaire d’aller en ce sens. La loi de protection de la biodiversité de 2016 permet ainsi, par exemple, de mettre un bien que l’on possède (un terrain, une forêt, etc.) au service d’une cause environnementale (la réintroduction d’une espèce animale ou végétale, la préservation d’une espèce d’arbre,…) en passant un accord pour formaliser cette direction : le propriétaire établit un contrat avec une association ou une collectivité, par exemple, et s’engage (et engage ses héritiers) à laisser ce dernier au service de la cause décrite. On assiste alors à une inversion de la logique de la propriété : elle sert à partager ou à faire du commun plutôt qu’à exclure autrui. C’est la même inversion qui sert de fondement à certaines licences de logiciel libre : celui qui pourrait bénéficier d’une « propriété » exclusive, à l’égard d’un logiciel qu’il a conçu, choisit plutôt de le mettre en partage et utilise pour cela une sorte de contrat (une licence de logiciel libre particulière) qui permet son usage, des modifications, mais impose à ceux qui l’utilise de le laisser en partage. Le droit de propriété sert ainsi à ouvrir l’usage de cette ressource plutôt qu’à le fermer.
binaire : Pour arriver aux communs numériques, commençons par internet. Est-ce que c’est un bien commun ? Un commun ?
JR : C’est une grande discussion ! On a pu soutenir qu’Internet était un commun mondial : on voit bien l’intérêt de cette ressource ou de cet ensemble de ressources (les différentes couches, matérielles, logicielles, etc.) pour une communauté très large ; ses fonctionnement et usages sont régis par des règles que se donnent des « parties prenantes » et qui sont censées exprimer une sorte de gouvernance par une partie de la communauté intéressée. En réalité, internet a même plusieurs gouvernances — technique, politique — et on est loin d’une représentation de l’ensemble des parties prenantes, sans domination de certains sur d’autres. La règle, cependant, qui exprime peut-être encore le mieux une partie de cette idée est celle de neutralité du net (dont on sait qu’elle a été bousculée aux États-Unis) : tout contenu devrait pouvoir y circuler sans discrimination.
binaire : Est-ce qu’on peut relier cela au droit de chacun d’avoir accès à internet ?
JR : Oui, ce lien est possible. Mais, en France, le droit à un accès à internet a plutôt été reconnu et fondé par le Conseil constitutionnel sur de vieilles libertés : comme condition des libertés d’information et d’expression.
binaire : Le sujet qui nous intéresse ici est celui des communs numériques. Est-ce tu vois des particularités aux communs numériques par rapport aux communs tangibles ?
JR : Oui tout à fait. Ostrom étudiait des communs tangibles comme des systèmes d’irrigation ou des forêts. La menace pour de telles ressources tient principalement dans leur surexploitation : s’il y a trop d’usagers, le cumul des usages de chacun peut conduire à la disparition matérielle de la ressource. D’ailleurs, l’économie classique postule que si j’ouvre l’usage d’un bien tangible (un champ par exemple, ouvert à tous les bergers désirant faire paître leurs moutons), ce dernier sera surexploité car personne ne ressentira individuellement la perte de façon suffisante et n’aura intérêt à préserver la ressource. C’est l’idée que synthétisera Garrett Hardin dans un article de 1968 resté célèbre, intitulé la « Tragédie des communs » (**). La seule manière de contrer cet effet serait d’octroyer la propriété (ou une réglementation publique). Ostrom s’inscrira précisément en faux en démontrant, à partir de l’analyse de cas concrets, que des systèmes de gouvernance peuvent se mettre en place, édicter des règles de prélèvements et d’accès (et autres) et assurer la pérennité de la ressource.
Pour ce qui est des communs numériques, ils soulèvent des problèmes différents : non celui de l’éventuelle surexploitation et de la disparition, mais celui qu’ils ne soient pas produits. En effet, si j’ouvre l’accès à des contenus (des notices de l’encyclopédie numérique, des données, des œuvres, etc.) et si, de plus, je rends gratuit cet usage (ce qui est une question un peu différente), quelle est alors l’incitation à les créer ?
Il faut bien préciser que la gratuité est une dimension qui a été placée au cœur du web à l’origine : la gratuité et la collaboration, dans une vision libertaire originaire, allaient quasi de soi. Les logiciels, les contenus distribués, etc. étaient créés par passion et diffusés dans un esprit de don par leurs concepteurs. Or, ce faisant, on fait un choix : celui de les placer en partie hors marché et de les faire reposer sur des engagements de passionnés ou d’amateurs désintéressés. La question se pose pourtant aujourd’hui d’aller vers le renforcement de modèles économiques qui ne soient plus basés que sur cette utopie du don, ou même sur des financements par fondations, comme ceux des Mozilla et Wikipedia Fundations.
Pour l’heure, la situation actuelle permet aux grandes plateformes du web d’absorber les communs (les contenus de wikipédia, des données de tous ordres, etc.), et ce sans réciprocité, alors que l’économie de l’attention de Google dégage des revenus énormes. Par exemple, alors que les contenus de l’encyclopédie Wikipédia, un commun, alimentent grandement le moteur de recherche de Google (ce sont souvent les premiers résultats), Wikipédia n’est que très peu rétribuée pour toute la valeur qu’elle apporte. Cela pose la question du modèle économique ou du modèle de réciprocité à mettre en place, qui reconnaisse plus justement la contribution de Wikipédia aux revenus de Google ou qui protège les communs pour qu’ils demeurent communs.
binaire : On pourrait également souhaiter que l’État soutienne le développement de communs. Quelle pourrait être une telle politique de soutien ?
JR : D’un côté, l’État pourrait s’afficher aux côtés des communs : inciter, voire obliger, ses administrations à choisir plutôt des communs numériques (logiciels libres, données ouvertes, etc.). C’est déjà une orientation mais elle n’est pas véritablement aboutie en pratique.
D’un autre côté, on pourrait penser et admettre des partenariats public-commun. En l’état des exigences des marchés publics, les acteurs des communs ont du mal à candidater à ces marchés et à être des acteurs reconnus de l’action publique.
Et puis, le législateur pourrait aider à penser et imposer la réciprocité : les communs se réclament du partage. Eux partagent mais pas les autres. Comment penser une forme de réciprocité ? Comment faire, par exemple, pour qu’une entreprise privée qui utilise des ressources communes redistribue une partie de la valeur qu’elle en retire ? On a évoqué le cas de Google et Wikipédia. Beaucoup travaillent actuellement sur une notion de « licence de réciprocité » (même si ce n’est pas simple) : vous pouvez utiliser la ressource mais à condition de consacrer des moyens ou du temps à son élaboration. Cela vise à ce que les entreprises commerciales qui font du profit sur les communs participent.
Dans l’autre direction, un projet d’article 8 de la Loi pour une République Numérique de 2016 (non adopté finalement) bloquait la réappropriation d’une ressource commune (bien commun ici) : il portait l’idée que les œuvres passées dans le domaine public (des contenus numériques par exemple) devenaient des « choses communes » et ne pouvaient pas être ré-appropriées par une entreprise, par exemple en les mettant dans un nouveau format ou en en limitant l’accès.
D’aucuns évoquent enfin aujourd’hui un « droit à la contribution », sur le modèle du droit à la formation (v. L. Maurel par exemple) : une personne pourrait consacrer du temps à un commun (au fonctionnement d’un lieu partagé, à l’élaboration d’un logiciel, etc.), temps qui lui serait reconnu pour le dédier à ces activités. Mais cela demande d’aller vers une comptabilité des contributions, ce qui, à nouveau, n’est pas facile.
En définitive toutes ces propositions nous conduisent à repenser les rapports entre les communs numériques, l’État et le marché.
binaire : Nous avons l’impression qu’il existe beaucoup de diversité dans les communautés qui prônent les communs ? Partages-tu cet avis ?
JR : C’est tout à fait le cas. Les communautés qu’étudiaient Ostrom et son École étaient petites, territorialisées, avec une centaine de membres au plus, identifiables. Avec l’idée des communs de la connaissance, on est passé à une autre échelle, parfois mondiale.
Certains communs se coulent encore dans le moule. Avec Wikipédia, par exemple, on a des communautés avec des rôles identifiés qui restent dans l’esprit d’Ostrom. On a la communauté des « bénéficiaires » ; ses membres profitent de l’usage de la ressource, comme ceux qui utilisent Wikipédia. On a aussi la communauté « délibérative », ce sont les administrateurs de Wikipédia qui décident des règles de rédaction et de correction des notices par exemple, ou la communauté « de contrôle » qui vérifie que les règles ont bien été respectées.
Mais pour d’autres communs numériques, les communautés regroupent souvent des membres bien plus mal identifiés, parfois non organisés, sans gouvernement. Je travaille d’ailleurs sur de telles communautés plus « diffuses », aux membres non identifiés a priori mais qui bénéficient de ressources et qui peuvent s’activer en justice pour les défendre quand celles-ci se trouvent attaquées. Dans l’exemple de l’article 8 dont je parlais, il était prévu de reconnaître que tout intéressé puissent remettre en cause, devant les tribunaux, le fait de ne plus pouvoir avoir accès à l’œuvre du domaine public du fait de la réappropriation par un acteur quelconque. Il s’agit bien d’une communauté diffuse de personnes, sur le modèle de ceux qui défendent des « ressources environnementales ». On peut y voir une forme de gouvernance, certes à la marge.
binaire : On a peu parlé de l’open data public ? Est-ce que la définition de commun que tu as donné, une ressource, des règles, une gouvernance, s’applique aussi pour les données publiques en accès ouvert ?
JR : Il y a des différences. D’une part, les lois sur l’open data ont tout d’abord été pensées pour renforcer la transparence de l’action publique. D’une part, les lois ont vu dans l’open data public le moyen de rendre plus transparente l’action publique : les données générées par cette action devaient être ouvertes au public pour que les citoyens constatent l’action publique. Puis, en 2016, notamment avec la loi pour une République numérique évoquée, cette politique a été réorientée vers une valorisation du patrimoine public et vers une incitation à l’innovation : des startups ou d’autres entreprises doivent pouvoir innover à partir de ces données. Les deux motivations sont légitimes. Mais, mon impression est qu’aujourd’hui, en France, l’État voit moins dans l’open data un moyen de partage de données, qu’un espace de valorisation et de réappropriation. D’autre part, ce ne sont pas du tout des communs au sens où il n’y a pas de gouvernance par une communauté.
binaire : Tu travailles beaucoup sur le climat. On peut citer ton dernier livre « Justice pour le climat ». Quelle est la place des communs numériques dans la défense de l’écologie ?
JR : Je mets de côté la question de l’empreinte environnementale du numérique, qui est un sujet assez différent, mais néanmoins très préoccupant et au cœur des réflexions à mener.
Sur le croisement évoqué, on peut tracer deux directions. D’une part, il est évident qu’un partage de données « environnementales » est fondamental : pour mesurer les impacts, pour maîtriser les externalités. Ces données pourraient et devraient être saisies comme des « biens communs ». On a également, en droit, la notion voisine de « données d’intérêt général ». Il y a déjà des initiatives en ce sens en Europe et plus largement, que ce soit à l’égard des données publiques ou de données générées par des entreprises, ce qui, encore une fois, est délicat car elles peuvent recouper des secrets d’affaires.
D’autre part, la gravité de la crise environnementale, et climatique tout particulièrement, donne lieu à des formes de mobilisations qui, pour moi, témoignent de nouvelles approches et de la « conscientisation » des biens communs. Notamment, les procès citoyens que je décris dans le livre, qui se multiplient dans une bonne partie du monde, me semblent les expressions d’une volonté de réappropriation, par les citoyens et sous la pression de l’urgence, du gouvernement d’entités ressenties comme communes, même si le procès est une gouvernance qui reste marginale. Ils nous indiquent que nous aurions intérêt, pour leur donner une voie de gouvernement plus pacifique, à installer des instances de délibération, à destination de citoyens intéressés (territorialement, intellectuellement, par leur activité, leurs besoins, etc.) saisis comme des communautés diffuses. A cet égard, une initiative comme la Convention Citoyenne sur le climat était particulièrement intéressante, ouvrant à une version moins contentieuse que le procès.
Il pourrait en aller de même dans le cadre du numérique : l’utilisation de l’ensemble de nos données personnelles, des résultats de recherche obtenus en science ouverte, etc. pourraient, comme des communs, être soumise à des instances de délibération de communautés. On prendrait conscience de l’importance des données et on délibérerait sur le partage. Sans cela, on assistera toujours à une absorption de ces communs par les modèles d’affaires dominants, sans aucune discussion.
Serge Abiteboul, Inria & ENS Paris, François Bancilhon, serial entrepreneur
(*) Elinor Ostrom (1933-2012) est une politologue et économiste américaine. En 2009, elle est la première femme à recevoir le prix dit Nobel d’économie, avec Oliver Williamson, « pour son analyse de la gouvernance économique, et en particulier, des biens communs ». (Wikipédia)
(**) « La tragédie des biens communs » est un article décrivant un phénomène collectif de surexploitation d’une ressource commune que l’on retrouve en économie, en écologie, en sociologie, etc. La tragédie des biens communs se produirait dans une situation de compétition pour l’accès à une ressource limitée (créant un conflit entre l’intérêt individuel et le bien commun) face à laquelle la stratégie économique rationnelle aboutit à un résultat perdant-perdant.


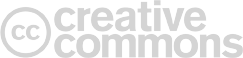
Répondre à cet article
Suivre les commentaires : |
|
