Y.C - En ces temps de grandes remises en cause à l’université et dans les grandes écoles, où les manières de donner cours sont bouleversées, je voudrais vous poser cette question-ci : qu’est-ce que "faire école" ?
Y.R - Si "faire école" exprime l’idée de bâtir une école performante dans le domaine de l’enseignement, votre interrogation est pertinente même si que je pense qu’elle pouvait déjà se poser bien avant la crise sanitaire et sociale que nous vivons. Car, depuis longtemps, notre système universitaire ne se porte pas aussi bien qu’on peut l’imaginer. Songez simplement à cette incroyable réalité : près de 60 % des étudiants quittent l’université sans diplôme [1]. Comment, alors, ne pas poser la question de l’efficacité de l’enseignement indépendamment des turbulences actuelles ?
Y.C - Cet échec massif est-il seulement le fait d’un enseignement supposé défaillant ?
Y.R - En effet, il faut faire la part des choses car la réussite scolaire dépend de multiples facteurs. Par exemple, 46 % des étudiants travaillaient en parallèle de leurs études en 2017. Il a souvent été démontré que le cumul emploi-études avait des effets négatifs quant à la réussite aux examens [2].
Mais en réalité, une analyse plus approfondie montre qu’exercer un travail n’est pas toujours synonyme d’échec car cela peut concerner des étudiants motivés. Et puis, c’est surtout une activité salariée importante, de plus de 16 heures par semaine, qui augmente la probabilité d’échec. Or, la part des étudiants dans ce cas est faible [3]. Donc, les engagements extrascolaires n’expliquent pas tout et l’on voit bien que l’interrogation sur la qualité de l’enseignement garde toute sa légitimité.
Y.C - Pour continuer sur ce même sujet, entrevoyez-vous des différences entre les étudiants universitaires et ceux des grandes écoles ?
Y.R - Oui, je vois trois différences majeures. D’abord, les étudiants des grandes écoles sont moins confrontés à la question socio-économique. En 2019, HEC n’abritait que 11 % d’étudiants boursiers [4]. Travailler pour vivre est moins une nécessité. En second lieu, ils intègrent les écoles à l’issue d’un concours très sélectif qui suggère que ce sont des élèves à fort potentiel, rarement en échec scolaire. Enfin, et ceci distingue négativement les grandes écoles de l’université, une fois franchi l’obstacle du concours, la sélection devient bien moins drastique. L’on n’échoue quasiment pas en grande école, ce qui traduit peut-être un niveau d’exigence moindre aux examens et, corollairement, moins d’engagement dans les études.
Y.C - Rejoint-on encore l’idée d’un enseignement perfectible ?
Y.R - Absolument ! Finalement, le dénominateur commun à l’université et aux grandes écoles, c’est cette même interrogation qui pèse dans l’esprit des professeurs, à tous niveaux d’études : comment faire pour que les étudiants travaillent mieux qu’ils ne le font, fassent de meilleurs apprentissages ? Bref, comment mieux "faire école" ?
Y.C - C’est une problématique générale !
Y.R - Oui ! Et il est amusant de noter que les comportements des étudiants sont globalement identiques partout dans le monde. Par exemple, lorsqu’Éric Mazur – un professeur à l’université d’Harvard – invente la classe inversée [5], il le fait parce qu’il est las de constater que les étudiants ne travaillent qu’à l’approche des examens et pas tout au long de l’année. Vous voyez, on est à Harvard, la Mecque des études !
Y.C - Comme enseigner est vieux comme le monde, savoir "faire école" ne devrait-il pas être un problème réglé depuis longtemps ?
Y.R - Idéalement, nous devrions tous avoir en poche une définition fonctionnelle de l’enseignement. Mais dans la pratique, tout est différent. Dans un dialogue de Platon, quand Socrate demande à Ménon de définir la vertu, ce dernier cite une multitude de vertus particulières : celle de l’homme, de la femme, de l’enfant, de l’esclave… Bref, d’un élément, il en compose « tout un essaim » [6]. C’est pareil avec l’enseignement ! De quel enseignement voulez-vous parler ? De celui des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, de celui donné aux collégiens, aux étudiants, aux apprentis ? Définir d’un mot l’enseignement est impossible. C’est un problème très embrouillé et sans doute pourquoi chacun peut en avoir une idée très personnelle.
Y.C - Par quel bout le prendre, alors ?
Y.R - Je pense d’abord qu’il faut évoquer le contexte et rappeler qu’à l’université, l’intérêt pour la pédagogie est extrêmement récent. Il date de la fin des années 90. Auparavant, le sociologue P. Bourdieu disait de la pédagogie universitaire, précisément, qu’elle n’existait pas. Constat sévère mais juste. Il ne faut donc pas s’étonner ou s’émouvoir si l’enseignement présente encore de nos jours bien des hésitations et des errements, c’est tout à fait normal.
Et puis, enseigner est comme détaché de l’obligation de réussite. Philippe Meirieu, un éminent pédagogue, citait Molière et son Médecin malgré lui pour le souligner : « Je trouve que c’est le meilleur métier du monde ; car, soit qu’on fasse bien, soit qu’on fasse mal, on est toujours payé de la même sorte. (…) Un cordonnier (…) ne saurait gâter un morceau de cuir qu’il n’en paye les pots cassés, mais ici, l’on peut gâter un homme sans qu’il n’en coûte rien… » [7]. Bien enseigner n’a jamais été une quête absolue dans le supérieur et si un étudiant devient plus tard un mauvais professionnel, nul n’invoquera la responsabilité de telle ou telle institution scolaire.
Y.C - Mais alors, est-ce à dire que les enseignants manqueraient de compétence ?
Y.R - Non, ce n’est pas ainsi qu’il faut l’interpréter. Il faut comprendre que les professeurs, aussi brillants et consciencieux soient-ils, évoluent dans un milieu qui n’est pas propice à leur formation professionnelle. Meirieu l’expliquait bien : « L’apprentissage et ses véritables conditions d’efficacité sont toujours esquivés. » [8]. La conséquence, poursuivait-il, est que les enseignants se définissent davantage comme des spécialistes d’une discipline que comme des professionnels de l’apprentissage [9].
Y.C - Le paradoxe des écoles serait-il de ne pas assez parler « d’apprentissage » ?
Y.R - Exactement. C’est ce que disait l’auteur et s’il ne visait pas spécifiquement la situation dans le supérieur, je pense que cela vaut parfaitement dans ce cas précis. Il faut « se coltiner la difficile question de l’apprentissage, (…) pour nous occuper sérieusement de ce qui se passe dans la classe (…) » [10], c’était ses propres mots.
Y.C - En résumé, bien "faire école" consisterait d’abord à ouvrir la discussion autour du concept d’apprentissage ?
Y.R - Les écoles supérieures font énormément de choses, de la recherche, de la communication, organisent des cours, des stages, des examens, collaborent avec des entreprises, et j’en oublie… Et rien de tout ceci n’est à négliger ! Mais oui, « faire école » au sens d’enseigner en salle de cours, c’est en concentré prendre la question de l’apprentissage au sérieux pour en faire quelque chose sur le terrain pédagogique. Et cela procède aussi d’un état d’esprit particulier dont nous parlerons bientôt.
À suivre.
Qu’est-ce que « faire école », partie 2 : Cultiver un certain état d’esprit


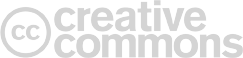
Répondre à cet article
Suivre les commentaires : |
|
