
Le 23 février dernier, lors de son déplacement à l’EDHEC Business School de Croix dans le Nord, le premier ministre Édouard Philippe a fait une déclaration portant sur les enjeux de la maîtrise de l’anglais chez les lycéens et les étudiants, notamment dans le but d’augmenter les exportations et de réduire le déficit commercial français.
Il a mentionné l’intérêt de faire certifier ce niveau d’anglais, notamment par le biais de certifications externes aux systèmes d’enseignement secondaire et supérieur français (c’est-à-dire en faisant appel à des organismes anglo-saxons privés).
Comme le note Pierre Frath, les linguistes seraient donc inaptes à l’évaluation de leurs propres élèves et étudiants :
« […] il semble acquis pour la plupart des collègues que les certifications externes sont les seules à pouvoir assurer des évaluations crédibles. Mais si les universités ont le droit légitime de décerner des licences de mathématiques ou de droit, pourquoi ne pourraient-elles pas certifier les langues ? » (Pierre Frath. 2O12)
Cette question s’inscrit dans une réflexion plus large sur la mise en place d’une démarche qualité appliquée à l’enseignement supérieur français.
Par exemple, certaines écoles d’ingénieurs et écoles de commerce choisissent de faire labelliser leurs formations dans le cadre d’accréditations délivrées par des organismes internationaux.
Cette démarche ne vise pas la validation du niveau des étudiants. Elle porte sur des indicateurs de qualité des formations, beaucoup plus globaux, tels que la qualité de la mission de l’établissement et de son corps professoral, la stabilité de la gouvernance et la cohérence globale des dispositifs. Dans ce cadre, la certification d’un niveau de compétence en langues est-elle justifiée ?
Pourquoi la démarche qualité ne s’appliquerait-elle pas aux formations en langues dont tout le monde s’accorde à dire qu’elles constituent un atout pour l’internationalisation des formations et l’insertion professionnelle ?
Pistes et impasses de la certification à grande échelle
Si les niveaux B2 et C1 du CECRL émergent actuellement comme des points de repère en Licence et en Master (Béjean & Monthubert, 2015 : 70 ), nous savons également que la question de la compétence est aussi une affaire de contenu en ce qu’elle englobe des savoir-faire en langue pour affronter les situations du monde professionnel et la diversité linguistique (Rapport LEMP 2015).
La mesure de la compétence des étudiants suppose donc, d’une manière ou d’une autre, la simulation de situations d’échanges crédibles et relativement complexes (Douglas, D. 2001).
Dans ce cadre, les différentes approches de la certification sont-elles de bons indicateurs ? L’approche structuro-psychométrique – le Test of English for International Communication (TOEIC) et Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – est certes attractive à première vue mais elle a des effets négatifs (washback effect) sur la formation proposée en amont. Celle-ci est souvent réduite à l’entraînement à un test qui ne rend pas véritablement compte d’un besoin aussi fondamental que la capacité à interagir.
L’approche actionnelle du Certificat de compétences en langues de l’enseignement supérieur (CLES) est certes beaucoup plus pertinente en ce qu’elle teste cette capacité d’interaction mais son manque d’adéquation avec la spécialité fine des étudiants et le coût (humain et organisationnel) d’une mise en place à grande échelle sont des obstacles majeurs à sa généralisation.
Concevoir la compétence en anglais pour l’insertion professionnelle et académique
La compétence en anglais dans le monde professionnel d’aujourd’hui est le reflet d’une compétence métier.
Par exemple, la compétence en anglais d’un ingénieur en informatique suppose non seulement qu’il ou elle maîtrise la terminologie et les genres de son métier (rapport technique, procédures, etc.), mais qu’il ou elle affronte également les situations sociales d’échanges parfois très diverses (échanges informels entre collègues, réunion avec des inconnus) dans différents modes (face-à-face, courriers électroniques, conférences téléphoniques, etc.) le tout dans une temporalité pouvant varier d’un contexte à l’autre (l’ensemble des situations énoncées précédemment accumulées en une journée ou utilisation plus ponctuelle).
Il est indéniable que cette complexité pose un problème de taille pour toute tentative de modélisation de la compétence en anglais de spécialité en ce qu’elle dépend, au fond, de notre connaissance du « spécialisé en anglais ».
Mais c’est précisément cette connaissance que les anglicistes de spécialité, en France comme à l’étranger, cartographient depuis maintenant plusieurs décennies si bien qu’il est désormais possible d’envisager la conception d’un vaste ensemble de dispositifs d’évaluation pertinents pour l’attestation de la compétence en anglais à destination de domaines académiques ou professionnels très divers.
Ces dispositifs peuvent en effet se fonder sur les recherches actuelles portant sur la description des variétés spécialisées de l’anglais, nos connaissances des genres académiques et professionnels et, plus largement, notre connaissance de la culture des milieux spécialisés anglophones et internationaux.
Aujourd’hui, des modalités d’attestation des compétences en langues se développent en interne dans un nombre grandissant d’universités. Ces modalités présentent généralement de nombreux avantages tels qu’un coût très faible comparé aux certifications externes, une adéquation aux besoins des filières et la formalisation des connaissances en langue (Millot 2017).
Alors pourquoi, lorsqu’elles existent, sont-elles largement méconnues des décideurs ?
La première cause tient à un problème de fond lié à la place souvent mineure accordée aux formations en langues de spécialité dans les universités. Il s’ensuit que les équipes de linguistes sont peu nombreuses et tendent à se tourner vers des solutions « clé en main » faute de pouvoir consacrer suffisamment de temps au développement de dispositifs d’attestation formelle des compétences.
La deuxième tient à la pression commerciale exercée sur les établissements d’enseignement supérieur par des organismes de certification qui, pour la cause précédemment évoquée, formulent des offres sans que les établissements ne soient véritablement en mesure de proposer de contre-offre crédible et reconnue.
La troisième raison découle des deux premières et résulte en une croyance selon laquelle les certifications « externes » seraient les plus à même d’attester efficacement et formellement des compétences. Cette croyance, manifestement relayée au plus haut niveau de l’État, pourrait conduire – conduit déjà ? – à nombre d’effets pervers comme l’accroissement de l’investissement en direction de l’attestation au détriment de la formation.
De la même manière que le thermomètre ne saurait ralentir le réchauffement climatique, la certification systématique ne saurait augmenter massivement le niveau de compétence de nos étudiants. En revanche, il y a fort à parier qu’elle expose, de manière étroite mais avec grande netteté, les dysfonctionnements d’un système parfois à bout de souffle.
![]()
Séverine Wozniak est membre du Groupe d’étude et de recherche en anglais de spécialité (GERAS).
Cédric Sarré est membre du Groupe d’Etude et de Recherche en Anglais de Spécialité (GERAS).
Philippe Millot est membre du GERAS
Valérie Braud est membre du GERAS.


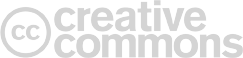
Répondre à cet article
Suivre les commentaires : |
|
