Un article repris de la revue Education et socialisation, une publication sous licence CC by nc nd
Emmanuel Triby, « La coordination en travail social : un avatar du management transversal », Éducation et socialisation [En ligne], 68 | 2023, mis en ligne le 29 juin 2023, consulté le 14 octobre 2023. URL : http://journals.openedition.org/edso/24096 ; DOI : https://doi.org/10.4000/edso.24096
Introduction
La coordination dans le travail social est une préoccupation ancienne, réactualisée plus récemment pour devenir une pratique de management dans les établissements. Parler de management dans le travail social ne va pas de soi. La culture professionnelle y est rétive et les intitulés de postes et de fonctions n’en font guère mention. Assimiler le coordinateur à un manageur comporte ainsi un double obstacle : outre la résistance professionnelle, c’est la nature même de la fonction de coordinateur qui semble ne pas pouvoir être assimilée à du management puisque les offres d’emploi et les fiches de poste précisent qu’il s’agit d’une fonction « non hiérarchique ». Il pourrait donc exister un management non hiérarchique.
C’est là tout le sens de notre question de départ : en quoi, l’activité de coordination relève-t-elle du management ? De quel management s’agit-il et pour quels effets ? Bien évidemment, la réponse à cette double question n’est possible que si l’on s’est d’abord interrogé sur la nature de cette coordination, dans et hors du travail social. Une recherche-formation mise en œuvre depuis huit ans nous a permis d’enquêter sur le réel de cette fonction et de recueillir un matériau et des données substantiels. Nous en tirons certains résultats et questionnons les « préconisations » que les participants formulent dans les monographies issues de cette formation.
La coordination comme problème : contextualisation et conceptualisation
Comprendre la coordination comme management dans le travail social exige d’opérer une contextualisation sociohistorique de la fonction et une interrogation de la notion elle-même.
Brève histoire de la coordination
La coordination n’est pas née dans le travail social. C’est une fonction portée par toute activité sociale impliquant une certaine division du travail. Le besoin de coordination est consubstantiel aux activités humaines dans la mesure où elles comportent forcément une « dimension collective » qui « apparaît comme un caractère constituant à peu près universel du travail » (Schwartz, 1997, p. 33). Plus précisément, la coordination des actions individuelles « se concrétise par un ordonnancement des actions, entendu comme un “agencement des actions de chacun des opérateurs impliqués dans un certain ordre afin d’atteindre le but final de façon efficace“ (Barthe, 2000), mais également par une adaptation réciproque des acteurs et de leurs actions à celles des autres » (Marcel et al., 2007, p. 10). En fait, à partir du moment où un groupe de personnes contribue à la réalisation d’un produit, un bien ou un service, une activité qui exige du temps, des ressources coûteuses et surtout de partager (collaboration) ou de se répartir (coopération) des tâches, il faut de la coordination.
Dans l’imaginaire rationalisateur des économistes, c’est le marché qui porte les besoins de coordination. Il les porte dans le sens où il définit un manque socialement partagé et induit de la part des acteurs clés de ce marché, les « entrepreneurs » ou les « organisations », la nécessité de créer les moyens de cette coordination. Cela va conduire à mettre en place les dispositions et les dispositifs nécessaires pour assurer la coordination de l’activité, en interne, dans l’activité productive, en externe, « sur » le marché [1]. Cela concerne en réalité tout un ensemble d’actes qui ne sont pas forcément pris en charge par une personne en particulier ; c’est une fonction distribuée entre différentes personnes et organisations en interaction, dont la prise en charge est donc d’abord collective.
Ainsi, « le marché est une façon très particulière d’agencer et de stabiliser les relations entre acteurs » (Ledoux, 2022, p. 274). Ce « marché » est une dynamique historique nourrie à la fois par une extension infinie de son champ d’intervention et par un effort d’institutionnalisation au moyen de règles et de contraintes instituées pour assurer un fonctionnement durable. Il se constitue en « logique » lorsqu’il pénètre des domaines d’activités « non marchandes », gérées directement ou indirectement par l’État et les autres acteurs « publics » : services publics et associations dont le fonctionnement est alors soumis à des principes et des règles, censés se substituer à ceux du marché tout en assurant ses prétendus avantages : compétition, concurrence, comparabilité des offres…
Très férus de cette notion, les économistes précisent : « le marché et l’organisation sont deux modes de coordination, mais l’un a pour instrument les prix tandis que l’autre a pour vecteur des règles ; l’un est inintentionnel, car il repose sur la compétition, tandis que l’autre est intentionnel et vise la coopération au service d’un projet collectif » (Favereau, 2012, p. 97). Une organisation est alors un mode de coordination alternatif au marché « lorsque les coûts de transaction rendent celui-ci inefficient » (ibid., p. 99). En fait, grâce à la coordination, l’organisation « fournit des instruments de contrôle qui ne sont pas disponibles sur le marché et met en œuvre des adaptations coopératives plus vite que le marché » (Williamson, 2012, p. 91) ; ces instruments concernent le travail, les produits, les ressources mobilisées, la légalité. C’est donc un principe d’économie assez élémentaire, notamment dans les sociétés dites « développées ».
Dans cette conception, que l’on se situe dans la sphère marchande ou non marchande des activités sociales, la coordination est « un des concepts de base de la théorie des organisations » (Nizet et Pichault, 2012, p. 11). Ces auteurs notent qu’elle varie suivant la situation de l’organisation dans son environnement. C’est une fonction portée par des activités ; elle peut être spécifique à une situation de travail ou en intégrer plusieurs…
Relevons également que le besoin de coordination est d’autant plus fort que l’organisation subit une double pression : une pression venant de l’extérieur, une pression venant plutôt de l’intérieur. La pression extérieure est principalement celle de la concurrence, pour l’économie marchande, celle des politiques publiques et leurs instruments, pour le non marchand. Les pressions internes sont liées aux modalités d’organisation du travail et des rapports propres à chacune des deux sphères de production ; dans le secteur marchand, à force de coordination, ces pressions déterminent « les chaines de valeur internes », à savoir : « comment chacune des activités de l’entreprise participe à la création de valeur et à la formation de l’avantage concurrentiel » (Mousli, 2013, p. 34). Cette valeur est la grandeur monnayable résultant de la conversion du produit en argent selon le « code du capital », toutes ces règles de droit (et donc de comptabilité) qui garantissent que « l’actif » sera bien converti en argent (Pistor, 2023). Les choses se compliquent pour le non marchand, et c’est peut-être un des enjeux théoriques de cette contribution : quelle est cette « valeur » qui y est créée et comment est-elle « monnayée » ? Qu’est-ce qui correspond à « l’avantage concurrentiel », notamment pour une institution du travail social ?
La coordination, un management « transversal »
Le management sert à nommer les activités pratiques de gestion d’une production partagée entre différents opérateurs ; gérer, dans ce sens, c’est « faire faire » par un autre ou une équipe. Cette « délégation » (Morin, 1985) suppose l’existence d’un rapport hiérarchique entre celui qui fait faire et l’autre qui fait. Mais manager, c’est aussi ménager, employer cette ressource humaine avec mesure et discernement, ajustée aux besoins de l’activité même : ses conditions matérielles, ses risques, ses temporalités, etc. C’est garantir le bon fonctionnement de son « ménage » qui, en économie, constitue l’unité économique de base, notamment par l’établissement de bonnes relations avec ses travailleurs, fournisseurs et clients. [2]
La diversification progressive des différents modes de management dans les organisations contemporaines décline toutes les modalités d’organisation du travail censées assurer la « gestion » du rapport de l’entreprise au risque, au réel, au temps et à la valeur (Hubault, 2013). De l’organisation taylorienne des origines à « l’entreprise libérée » d’aujourd’hui (Gilbert et al., 2017), en passant par le lean management (INRS, 2022) et le management participatif (Saussois, 2012), c’est un double paradoxe qui apparaît : la distance entre le discours (et ses prescriptions) et le réel de la mise au travail dans les collectifs organisationnels (Vannereau, 2018) ; les pratiques apparemment les plus novatrices continuent toujours de comporter les traces de l’ancien (Dietrich et Pygère, 2016). Au point que l’on peut s’interroger sur l’intérêt qu’il y a d’opérer des distinctions tranchées pour une activité et une fonction dont l’exercice se transforme moins du fait de l’évolution des principes d’action que du fait des changements du contexte social et économique : l’organisation des milieux de travail, la nature des tâches à réaliser, les profils générationnels des personnes, etc. (Gaulejac et Vandewattyne, 2020).
C’est dans cette configuration problématique qu’il convient de traiter du « management transversal » auquel pourrait être assimilée la coordination. Sa « transversalité » tient à l’absence de lien hiérarchique avec les personnes ou l’équipe avec qui le manageur travaille ; cela n’exclut pas pour autant des liens hiérarchiques par ailleurs. Cela peut faire douter de son caractère de management sauf si on n’en retient que l’idée qu’il s’agit de « faire faire » [3], sans l’appui du lien hiérarchique.
La coordination serait donc « une posture », en rupture avec les rapports hiérarchiques, mais un management tout de même. Ce management a quelque chose du « management du projet », mais il est permanent. Il relève sans doute du « management d’équipe », mais il se situe à l’articulation du pilotage et du pouvoir hiérarchique (Lemonnier, 2015). Il a certainement contribué à promouvoir dans le discours managérial l’idée « d’intelligence collective » (Gomez, 2016). Cette posture pourrait se condenser en ces termes : ayant fondamentalement une fonction de coordination, ce manageur « transverse » est le garant, dans la durée, de l’action juste des personnes ou des instances extérieures partageant la charge d’un produit particulier. Elle est juste parce que le manageur mobilise les bonnes ressources et les normes adaptées pour parvenir à la réalisation des objectifs de l’équipe ; elle est juste également parce qu’elle est en phase avec les besoins et les intérêts du bénéficiaire du service (Grosstephan et Lémonie, 2023).
La coordination dans le travail social
La coordination est une préoccupation déjà relativement ancienne dans l’action sociale puisqu’elle apparaît dans l’après-guerre 1914-18, mais au niveau des départements. Même si cette échelle reste importante aujourd’hui, la coordination dont il sera surtout question, et justifiant ainsi son inscription dans une problématique de management, concerne la coordination interne aux établissements sociaux dont le développement date plutôt des années 2000, notamment à l’occasion du vote d’un texte de loi assez décisif.
Une vieille histoire réactualisée aux débuts des années 2000
Afin de saisir la portée de ce nouveau besoin qui a fini par générer la fonction de coordination, il faut croiser l’histoire des politiques sociales (Löchen, 2013) depuis le début du XXème siècle et l’histoire plus récente du travail social. Cela fait apparaître un double mouvement, « vertical » et « horizontal » : du niveau central de l’État au niveau local des institutions et des services dans les territoires, d’un côté, une dynamique issue du terrain entre individualisation du service et développement partenarial, de l’autre.
Dès le début du XXe siècle, est affirmé « le besoin de coordination des efforts publics et privés » (P. Strauss, ministre de la santé en 1923, cité par Garcette, 2008, p. 46) dans la lutte contre la tuberculose. Le ministre ajoute que, « faute d’une action méthodique, risque de se produire le gaspillage des générosités et des dévouements » ; il convient donc « d’assurer la liaison la plus intime entre tous les services » (ibid, p. 47). En l’occurrence, cette fonction est prise en charge par des « comités départementaux » largement confortés par le gouvernement Blum en 1936. Ce qui importe ici est son apparition dans le champ du médico-social et la préoccupation clairement économique à laquelle la coordination doit répondre. À cet égard, le ministre de la santé de L. Blum, Henri Sellier, insiste sur « le défaut de coordination, éminemment préjudiciable au rendement technique et financier d’organismes qui (…) tirent leurs ressources des fonds publics » (ibid. p 48). Cela étant, jusqu’à la fin du siècle, le modèle administratif domine : la loi du 4 août 1950 ou le décret du 7 janvier 1959 restent centrés sur le « comité départemental ».
Ainsi, avec la prise en charge des pathologies de masse, la coordination de « parcours » va ouvrir le mouvement dans le médico-social, avec notamment la « coordination gérontologique » (Amyot, 2010). On y trouve alors à la manœuvre des médecins puis des soignants et aujourd’hui des assistants du service social. Cependant, le besoin de coordination qui émerge à la fin du XXème siècle est d’une autre nature (Jaeger, 2010) et sera formalisé dans les lois et décrets des années 2000. La coordination devient alors « un mot clé de l’action sociale » (Garcette, 2008).
Les coordinateurs dans le travail social, aujourd’hui [4]
– Le besoin d’un nouveau mode de gestion du travail social
Pour comprendre le devenir actuel de la fonction de coordination dans le travail social, il convient d’abord de la situer dans l’apparition d’un nouveau besoin de management issu de la gestion des problématiques sociales “sur le terrain“. Au tournant du siècle, le besoin de coordination est intimement lié à l’émergence de l’idée de cohésion sociale [5], « nouveau paradigme de l’intervention sociale » (Fouret et al., 2013, p. 15). La cohésion sociale est une préoccupation qui émerge une fois la globalisation des économies européennes réalisée, à la fin des années 1990. Cela étant, elle s’inscrit dans une tendance historique plus longue : le processus « civilisationnel » de l’individuation (Elias, 1998) ; enfin, elle prend toute son importance avec la crise du lien social, nouvelle « question sociale » (Castel, 1995).
Analyser les visées des politiques dites de cohésion sociale, c’est un peu établir la feuille de route du coordinateur en travail social. Un premier constat est formulé : « les Français restent préoccupés par la question des inégalités et des discriminations » (Fouret et al., 2013, p. 9). Or, on a fini par comprendre que, pour se rapprocher de l’égalité, il faut éviter le service standard, il faut au contraire le différencier. Cependant, « la cohésion sociale n’est pas seulement menacée par la persistance des inégalités mais aussi par la persistance de facteurs divers : précarisation du travail, éclatement du modèle familial, prégnance des discriminations… » (ibid, p. 11). Ainsi, une politique de cohésion sociale doit d’abord « poser la question du territoire pertinent d’intervention permettant un maillage fin de la prise en compte des besoins, une bonne organisation des ressources et une synergie entre les acteurs en vue de répondre aux situations de rupture sociale » (ibid., p. 13). L’action publique en matière sociale doit alors se déployer de manière transversale, territorialisée et ciblée : transversale car « les risques sociaux sont cumulatifs et appellent des réponses coordonnées » ; territorialisée car il faut prendre acte de la décentralisation et « mettre en place une véritable gestion de proximité » ; ciblée, car « les problématiques peuvent différer selon les caractéristiques des publics » (ibid., p. 14). Enfin, « les attentes des individus eux-mêmes se sont modifiées (…) vers une exigence de reconnaissance et de dignité » (ibid., p. 15). Il convient donc de « prendre en compte l’évolution des capacités de l’individu, associer davantage aux processus qui l’affectent et lui octroyer davantage de pouvoir sur son environnement » (ibid.). Cela implique une « logique de parcours » pour les usagers (cf. encadré), censée pouvoir construire un cheminement vers l’autonomie, mais surtout une attention particulière à leur demande.
- Les poids de nouvelles législations
La « loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale » fait explicitement mention de la « cohésion sociale » et relève les « sept séries de droits » de « l’usager citoyen » dont « le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes, (…) un accompagnement individualisé de qualité, (…) (sa) participation directe à la conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui le concerne ». Cette loi est renforcée par celle du 11 février 2005 instituant « le projet personnalisé d’autonomie ». Ce n’est pas un vain mot ou une expression marquée par l’air du temps : elle veut affirmer l’intention politique d’inverser la relation de service. Il s’agit de passer de la prise en charge et du traitement d’un problème local selon des démarches instituées, à la production d’un service en rapport à une demande singulière afin d’en tirer un projet d’action co-construit avec l’usager (et, si nécessaire, sa famille). Pour les travailleurs sociaux, cela implique à la fois une attention au terrain, une capacité réflexive et surtout l’inscription dans une démarche coordonnée d’intervention (Bouquet, 2006). Ce que certains ont appelé la « disciplinarisation du travail social » (Rullac, 2016).
– Du besoin de coordination au besoin de coordinateur
À la faveur de l’entrée des économies occidentales dans la globalisation, les pouvoirs publics s’orientent vers la définition politique d’une « contrainte budgétaire » : instauration de « l’austérité », réduction des financements publics, introduction de la pratique des appels d’offre, développement des procédures de certification discriminant les bénéficiaires de financements socialisés (formation, aide sociale, travail social), recherche d’une plus grande efficience des services publics. C’est le développement de ces « quasi-marchés » (Nyssens, 2015) qui a abouti à distancier les chefs de service vis-à-vis du terrain ; ils doivent se concentrer sur la gestion des ressources, notamment humaines, et le relevé des indices d’efficience des services. Cet éloignement a créé ainsi un besoin de coordination au niveau du terrain, l’horizontal.
Si la coordination « par le haut » reste d’actualité et constitue le mode de mise en œuvre dominant des politiques sociales au niveau départemental, la coordination qui nous occupe est celle qui fonctionne « par le bas ». La coordination est proprement une logique d’action, concept forgé « pour rendre compte de la diversité des interprétations possibles des phénomènes observés ; (…) de plus, c’est une manière de définir le sens qu’un acteur donne à son action » (Bernoux, 2012, p. 117). Le sens vient toujours d’un croisement entre l’axe de l’ancrage dans une situation, elle-même dans un contexte, et l’axe du devenir, tendu entre le passé et la généalogie qu’il trace jusqu’à l’à-venir, les perspectives qu’il ouvre au sujet et, simultanément, le porte (Mailliot, 2013). C’est donc un double mouvement, croisant lui-même l’individuel et le collectif (comme ressource d’interactions et de relations, et comme possibles appartenances), articulant du court et du plus long terme (de l’urgence, du réactif, de l’adaptatif, et du construit). Ce que cela signifie au fond, c’est que les personnes visées par l’action sociale sont jugées « vulnérables », y compris vis-à-vis des institutions occupées à « les prendre en charge » : elles les empêchent, soit d’accéder une certaine autonomie, soit d’exercer la plénitude de leurs droits ; c’est typiquement le cas du « non-recours » (Warin, 2017).
Un dossier récent sur la coordination des Cahiers de l’Actif s’intitule opportunément : « la coordination : une fonction à géométrie variable au service des logiques de parcours » (2018). Même si la coordination se décline également en coordination d’équipe ou de projet, c’est la coordination de parcours qui est première et reste l’horizon de toutes les coordinations. Lorsque les travailleurs sociaux ont à « traiter » des cas individuels à travers un « projet individualisé », l’objectif est de remettre la personne en mouvement, de l’inscrire dans un parcours : différents partenaires et services sont à coordonner. Avec l’expression de parcours, apparaît également celle de territoire, déjà relevée, expression récurrente dans le champ des politiques sociales voulant signifier la définition d’espaces d’intervention à la fois géographiques et professionnels (Bouquet, 2007).
En ce sens, l’activité de coordination n’est possible que si elle vise simultanément la collaboration voire la coopération. « La coordination est une obligation fonctionnelle liée à des enjeux de pouvoir : elle résulte de l’obligation morale et politique de la coopération » (…) Elle répond à une demande de prise en compte de la complexité et de la pluralité des besoins des personnes en difficulté » (Jaeger, 2010, p. 16). « Il ne peut s’agir simplement de transposer sur le terrain des directives publiques, mais d’apprendre à travailler en commun au sein d’un ensemble disparate de missions, d’objectifs, d’ambitions, de représentations des acteurs, d’organisations et de professionnels, ensemble mû par des forces individuelles ou institutionnelles qui se contrarient » (Amyot, 2010, p. 35).
Ceci implique une démarche de professionnalisation et une personnalisation. « La confiance à la base de la professionnalisation d’une activité et du groupe professionnel qui la déploie repose sur trois piliers : la légitimité pratique et/ou éthique de cette activité, l’excellence et la validité des référents déontologiques » (Aballea, 2013, p. 18). Cela appelle une formation spécifique, reconnue et ancrée. La personnalisation de la fonction qui, ailleurs, est distribuée spontanément entre les acteurs, internes et externes à l’organisation, parait alors s’imposer. Elle semble liée au caractère politique de la fonction, particulièrement dans le travail social :
– la personnalisation s’impose pour faire travailler ensemble des acteurs qui, ayant la même finalité d’action, n’ont, ni les mêmes intérêts, ni le même point de vue ;
– elle est demandée également pour articuler étroitement, et dans la durée, l’activité de professionnels attachés à la réalisation de projets personnalisés, inscrits dans une institution ;
– elle est exigée pour assurer l’articulation effective de l’action « horizontale » et le rapport hiérarchique, « vertical », de l’institution.
Ces éléments devront être clarifiés par notre enquête.
Un contexte local : une formation continue de coordinateur en travail social
Notre enquête est attachée intimement à la création d’une formation diplômante concernant la coordination en travail social. Dès son origine, compte tenu des enjeux identifiés, nous nous sommes inscrits dans une démarche de recherche-formation.
La conception et l’organisation d’une formation : la possibilité d’une recherche-formation
En 2014, a été mise en place une formation, un diplôme universitaire, de « coordinateur en travail social et médico-social », en collaboration entre l’Université, son département des sciences de l’éducation et de la formation, et l’IRTS [6] de la région. Dès le départ, en cohérence avec cette double tutelle mais plus encore avec son objet, cette action a été conçue comme une recherche-formation. En effet, la coordination était, à cette date, et est restée jusqu’à aujourd’hui une activité « à géométrie variable » et « en mal de reconnaissance », deux formules récurrentes dans la littérature professionnelle et savante la concernant. Dans cette perspective, former des coordinateurs, professionnels ayant déjà une expérience significative, doit passer par les voies du questionnement et de la recherche.
Modalité particulière de recherche-action (Bergeron, 2014), la démarche de recherche-formation combine « recherche de terrain à visée académique, réflexion sur la pratique, innovation pédagogique et formation diplômée » (Paillé, 1994, p. 215). Elle comporte deux caractéristiques principales, deux principes d’action :
– une forte correspondance de la démarche de formation avec les modèles de la démarche de recherche, autour du triptyque problématisation – conceptualisation – formalisation ;
– un mode d’engagement conjoint des professionnels étudiants et du chercheur dans l’action : les premiers avec leur expérience et la volonté de l’interroger pour la faire évoluer ; le second avec le projet de générer des connaissances afin de rendre plus intelligibles, et mieux adaptées, les interventions développées dans ce champ.
Le cadre et la démarche de cette recherche-formation
Afin d’actualiser et d’enrichir ce travail de problématisation et de conceptualisation, nous avons développé une démarche d’enquête visant conjointement la professionnalisation des stagiaires, professionnels expérimentés du travail social, et la production de résultats en termes de connaissances, dans le champ des sciences de l’éducation et de la formation. Cette formation annuelle est conçue et mise en œuvre autour de la réalisation d’une monographie individuelle, elle-même nourrie par une démarche de problématisation de son expérience professionnelle par les étudiants-stagiaires.
Il s’agit, dans le cadre d’une formation professionnelle pour adultes, de mettre des professionnels dans une démarche de questionnement empruntant à la démarche de la recherche dans le champ de l’activité (Barbier, 2013) ; ils ont la volonté de pousser la problématisation jusqu’à la formation de compétences nouvelles dans leur travail. En écart à cette action, le chercheur analyse à la fois les modes d’implication de ceux-ci dans la démarche de questionnement et les effets que cela produit sur leurs points de vue et leurs conceptions de leur activité. Les professionnels-étudiants sont informés de cette activité d’observation. La construction de la monographie est bien sûr accompagnée par des apports conceptuels et expérientiels, et des débats organisés à partir des questions apportées par les étudiants-stagiaires.
Parmi les stagiaires, la plupart sont aujourd’hui en fonction de coordination, mais selon des statuts et des modes de reconnaissance différents ; certains visent la création de cette fonction, d’autres, plutôt marginaux (1 ou 2 par an sur des promotions qui vont de 15 à 20 dans les années récentes) se forment en vue de trouver un emploi dans ce domaine. La formation étant en cours de certification, elle est essentiellement financée par les structures, par le plan de développement des compétences ; ceci suppose que les étudiants-stagiaires ont l’appui de leur direction, ce qui n’est pas anodin.
La démarche d’enquête mise en œuvre
Il va de soi que ce matériau a été l’objet d’un traitement particulier compte tenu de l’orientation thématique de cette contribution. Il avait subi un tout autre traitement pour une précédente publication (Triby, 2022).
Les idées directrices de notre enquête
Idée directrice 1. Issue des politiques sociales en vigueur depuis le début du siècle en France, l’activité de coordination consiste à transposer dans les situations de travail avec les usagers les exigences d’organisation et d’efficience formulées à l’échelle macro-sociale et politique. Bien que ne s’inscrivant pas dans une relation hiérarchique, le coordinateur doit chercher à exercer une influence sur le travail des professionnels de l’équipe. L’exercice de cette fonction implique à la fois la mobilisation de savoirs et de points de vue divers ; il est au cœur d’enjeux organisationnels et relationnels qui, forcément, le dépassent.
Idée directrice 2. La coordination peut être assimilée au « management transversal », avec ses potentialités mais également ses limites. Le coordinateur fonctionne dans l’horizontalité des relations de travail entre les professionnels et les publics dont il cherche à améliorer l’efficacité de la coopération. Il est contraint d’articuler son activité à celle du chef de service au sein d’une aire de compétences partagée, donc susceptible de contestations.
Ces idées directrices pour le traitement des données sont largement inspirées de théories de l’activité (Mayen, 2012 ; Schwartz, 2021) :
– l’activité fonctionne à travers la mobilisation et la réduction toujours provisoire de tensions, voire de contradictions, entre l’individuel et le collectif, l’usager et le professionnel… Chaque tension est susceptible de s’articuler à une autre à travers le mode de démarche mise en œuvre (plus ou moins collaboratif), le type d’instrument mobilisé, l’objectif évaluable visé, etc.
– le travail de coordination se nourrit de la subjectivation de professionnels du travail social contraints de créer des situations et des instruments intellectuels et opérationnels pour donner corps à leur fonction ; ce travail tend à construire les conditions de développement de cette forme de management, tant en termes sociocognitifs que politiques.
Matériau et méthodologie de l’enquête
Le matériau de l’enquête ici présentée est constitué en fait de trois éléments : l’élément principal sont les monographies rédigées depuis la création de la formation (de 25 à 35 pages, hors annexes) ; c’est aujourd’hui la huitième promotion, ce qui équivaut à une cinquantaine de monographies recensées et enregistrées dans leur mouture finale. À cela s’ajoutent des traces des séances d’accompagnement à l’élaboration des monographies ainsi que l’organisation des débats lors des séances de formation. Pour ces deux dernières sources de matériaux, il s’agit davantage d’éléments réunis a posteriori que de données à proprement parler ; elles n’ont pas le même poids dans l’analyse.
Les monographies comportent trois types de données analysables :
– des informations sur la mise en œuvre concrète de la coordination en contexte, entre intentions et résistances du terrain : ce sont des faits matériels mais également des informations sur les fiches de poste, les organigrammes, les salaires, et l’analyse critique que leurs auteurs en font… Cela nourrit à la fois la problématisation et la conceptualisation, et oriente bien évidemment l’enquête des étudiants ;
– des données d’enquête réalisée par les professionnels-étudiants auprès de leurs collègues, y compris la hiérarchie des établissements, plus rarement auprès des usagers ou des partenaires extérieurs ; il s’agit principalement de comptes-rendus d’entretiens. Cela permet aux auteurs de se construire un point de vue personnel et professionnel ;
– des « préconisations » et des plans d’action conçus par les professionnels-étudiants. Le principe de cette étape opérationnelle est de pouvoir développer la représentation de leur pouvoir d’agir, dans l’aire potentielle d’intervention d’un coordinateur.
Le traitement de ces données – saisie des informations et des analyses, collecte de verbatims d’enquête, description du plan d’action – est réalisé par une démarche assez classique d’analyse de contenu thématique, elle-même structurée par les deux idées directrices.
Résultats de l’enquête
Les résultats d’une recherche-formation sont forcément marqués par le cheminement de la formation sur près de dix ans et l’implication du chercheur dans cette formation. La structuration des résultats reprend les orientations de nos idées directrices.
La réalité de l’activité des coordinateurs
Que font les coordinateurs ? De quoi la coordination est-elle le nom dans les institutions du social ? L’analyse de notre matériau d’enquête apporte quelques pistes de compréhension.
La création du poste
Même s’il reste des institutions sans coordinateur parmi celles qui sont représentées dans la formation, c’est de plus en plus rare aujourd’hui. La raison invoquée pour la création d’un poste de coordinateur est plus souvent la surcharge de travail du chef de service que le choix politique de créer un emploi qui, du fait de l’évolution des missions dans le travail social, pourrait s’avérer judicieux. Trop souvent encore, il reste des cas de postes créés à la place de la création d’un poste de chef de service. L’argument financier (le coût respectif des deux postes) n’est pourtant jamais invoqué par les directions.
À parts à peu près égales, on trouve des coordinateurs à temps complet ou à temps incomplet : à mi-temps, voire à temps très partiel (un jour par semaine). L’autre mi-temps est un poste de travailleur social (TS) [7], sauf dans deux cas : une secrétaire et une chargée de communication. L’initiative de la création revient majoritairement aux directions, mais il arrive que ce soit un TS qui pousse à cette création (et a demandé, dans ce but, à suivre la formation).
La définition des tâches n’est pas toujours clairement établie. La plupart des établissements ne disposent pas de fiche sur ce poste et se réfèrent à des documents externes pour exposer leurs attentes. Avant leur entrée en fonction, les coordinateurs ont en général une ancienneté significative dans leur établissement. Ils bénéficient tous d’un surcroit de rémunération. Les établissements privilégient volontiers la promotion – si l’on peut dire pour une fonction non hiérarchique – en revanche, les données sont plus floues sur les critères de choix des personnes promues : un professionnel confirmé, ayant fait ses preuves, ou une personne identifiée pour ces dispositions apparentes pour la fonction ? Cela pose deux questions : quelles sont les compétences effectivement attendues ? Plutôt des compétences professionnelles dans le travail social ou plutôt des compétences en management ? Ceci est loin d’être anodin au regard de la manière dont la fonction sera effectivement occupée. Quel peut être l’effet du choix de promouvoir un membre de l’équipe sur le fonctionnement même de cette équipe ? C’est une question ancienne dans les organisations industrielles [8] qui comporte à la fois des enjeux professionnels (identité) et des enjeux proprement économiques (efficacité).
Les potentialités de la fonction
Un coordinateur renvoie sa fonction à un « développement généralisé de l’horizontalité des rapports, en tout cas plus horizontal qu’à une certaine époque » (50) [9]. L’efficience de la fonction serait ainsi liée à un phénomène social beaucoup plus vaste dont la coordination ne constituerait qu’une déclinaison locale.
Un coordinateur travaillant au 115 (accueil d’urgence) cherche, dans l’exercice de sa fonction, à « participer à la fluidité des parcours (et donc des dispositifs) du public afin de l’optimiser (dans l’intérêt statistiques/financement) de tout le monde » (29) ; ce qui est l’expression même de l’horizontalité dans une « société liquide » (Z. Bauman). Ce professionnel précise que c’est dans l’intérêt de l’usager, mais aussi dans « l’intérêt statistique » en lien aux attentes « des financeurs et des politiques ». Un autre se voit plutôt « comme un sujet porteur d’un ensemble de ressources mobilisables autour d’une vision partagée » (34). Il s’agit alors « de créer les conditions de la motivation » des membres de l’équipe : on touche là la dimension managériale mais peut-être plus encore à l’accompagnement, tellement nécessaire dans nos sociétés d’individus (Paul, 2021). À ce propos, une coordinatrice informe qu’elle a l’habitude d’aller sur le terrain en binôme avec un membre de l’équipe ; elle relève que ce sont « des occasions d’échanges et de confidences : moment de doute, perte de sens, fatigue, colère » (49). Un autre coordinateur pense que la fonction permet « d’améliorer le repérage et la remontée des besoins » (42). Ceci se situe dans la ligne des préconisations des lois de 2002 et 2005, et, de façon plus générale, dans le cadre des actions qui visent à « remettre l’usager au centre » des politiques sociales et conforte la fonction.
Plus simplement, une assistante sociale dans le champ professionnel du grand âge et de la dépendance rappelle les fondamentaux de la fonction : celle-ci l’aurait « amenée à (s)’interroger sur le rôle de la coordination comme levier médico-social dans la prise en charge sanitaire de la personne âgée. Et par conséquent, sur la place du coordinateur pour impulser cette dynamique » (11). Cela renvoie aux sources historiques de la coordination dans le secteur médico-social, sachant qu’aujourd’hui, hormis la Covid-19, ce sont moins les épidémies que le vieillissement de la population et le développement de pathologies diminuant l’autonomie possible des personnes qui sont en cause : ils semblent exiger ce format d’action par le parcours qui recouvre moins l’idée d’un cheminement maitrisé, toujours très aléatoire en la matière, qu’une meilleure répartition de la prise en charge entre différents partenaires. L’offre d’action sociale se disperse sur le territoire, il convient donc de la coordonner.
Les difficultés rencontrées par la mise en œuvre de la coordination
Malgré ces potentialités peu contestées dans les monographies analysées, des difficultés significatives apparaissent pourtant, parfois de façon récurrente. Elles concernent notamment la reconnaissance des tâches liées à ce poste et le fonctionnement effectif de la coordination. En rapport à la reconnaissance des tâches, deux cas de figure apparaissent dans certaines monographies :
– le transfert des tâches administratives. Puisque le coordinateur est payé pour pouvoir passer plus de temps dans son bureau, les TS lui réservent tout un ensemble de tâches, de nature plutôt « administrative » : gestion des plannings, rédaction et diffusion des écrits professionnels, rédaction des comptes-rendus de réunions d’équipe, renseignement des documents de suivi de l’activité, etc. Le coordinateur se présente davantage comme un assistant du chef de service qu’un tenant d’un pouvoir organisateur ; c’est ainsi au moins que l’interprètent les professionnels concernés dans leurs monographies ;
– la perte d’une certaine légitimité sur le terrain. Ce constat n’est pas majoritaire mais apparaît de façon suffisamment fréquente dans les monographies (presqu’une vingtaine de fois) pour être relevé ; cette évolution est généralement regrettée par les auteurs qui la constatent. Dans un verbatim collecté par un étudiant, un éducateur s’écrie, parlant de « son » coordinateur : « de toutes façons, Yannick n’est plus dans le groupe ! (…) il est moins impliqué qu’avant » (26). Il n’est plus vraiment « travailleur social », professionnel qui co-construit son activité avec les usagers. C’est le principe des « cadres de proximité » dans les services hospitaliers, laissant entendre qu’une certaine distance aux actes professionnels est nécessaire pour coordonner l’activité des soignants. Il est ainsi reproduit dans le secteur social et médico-social. La coordination pourrait s’accommoder d’une certaine abstraction pour se réaliser, tout en ayant besoin d’une personne désignée pour la prendre en charge.
Concernant le fonctionnement effectif de la coordination, il y a d’abord ce « manque de temps » régulièrement relevé (avec des formulations variées mais convergentes), particulièrement pour les professionnels à mi-temps ou à temps très partiel dans cette fonction : « à ce jour, ma plus grande difficulté est le manque de temps en raison de ma double activité et la rationalisation de mon travail. Cependant, il est primordial pour moi et la crédibilité de la fonction de mener à terme les projets engagés » (38). Cette citation montre combien l’invocation de ce manque est révélatrice d’un défaut de l’organisation du travail au regard de ce que les professionnels portent comme conceptions de leur métier et du « travail bien fait » (Clot, 2013), bien plus que d’un défaut absolu de temps disponible : une tension entre l’idéal de l’activité et ce que l’organisation autorise pratiquement. Un autre élément de la pratique de la coordination dans cette situation rencontrée à plusieurs reprises par un coordinateur : la question de « la prise de décision en situation d’urgence » (50) (une décision d’hébergement pour un « sans papier », par exemple). Le coordinateur en question est surpris par le fait que ses collègues de l’équipe lui demandent parfois de prendre la décision et de l’expliquer à la personne, alors que cela fait partie intégrante de leur responsabilité. Dans un entretien de suivi de monographie, ce coordinateur (qui a 30 ans de métier mais deux années dans cette fonction) s’interroge sur le fait que cela pourrait être lié à un phénomène générationnel chez les TS plus jeunes. Plus sûrement, cela semble lié à une évolution de la conception de sa responsabilité dans une société aux liens sociaux fragilisés et à une précarisation des ressources disponibles.
Les actions préconisées en tant que coordinateur
Deux grandes orientations, assez complémentaires, sont proposées pour répondre le plus spécifiquement possible à ces difficultés : l’une concerne la communication, l’autre concerne le suivi des projets et de l’activité de l’équipe.
Pour la communication, les « solutions » préconisées par certains professionnels étudiants concernent notamment les comptes-rendus des réunions d’équipe, qui doivent être particulièrement soignés afin de constituer des aides efficaces pour le travail individuel et collectif ; cela semble un peu dérisoire sinon vain, pourtant la possibilité de disposer d’un écrit permet de partager une certain conception de ses missions : la recherche de référents langagiers et sémantiques communs peuvent améliorer le sentiment d’un agir commun. D’autres préconisent de « formaliser davantage les temps de transmission au moment des changements d’équipe » (32). Dans une logique de « récit d’expérience » mis en commun autant que de continuité du service, c’est une autre intelligibilité de son travail qui peut être à l’œuvre.
Pour le suivi des projets, outre la communication, de nombreux étudiants sont tentés par « l’élaboration d’outils de suivi et d’évaluation des projets » (4, 23, 27, 32, 35). Assumant à leur insu les attendus du « public management », ces professionnels sont surtout préoccupés de rendre plus visible le projet en train de se réaliser, ce qui pourrait donner aux membres de leur équipe le sentiment d’une plus grande maitrise de leur activité. Cependant, d’autres ont déjà tenté l’expérience : « j’ai proposé un outil d’évaluation des projets personnalisés, parce que je pense qu’il est important de se rendre compte de ce qu’on a fait. Pour l’instant, mes collègues s’en servent trop peu » (26). Les expérimentateurs éprouvés invoquent « la surcharge de tâches administratives » (17, 26) à laquelle sont déjà confrontés leurs collègues, ce qui laisse entendre combien une évaluation formalisée sert davantage à l’administration qu’à l’action. D’autres évoquent plutôt une « réticence » (23) ou une « résistance viscérale » (25) à l’évaluation dans ce milieu professionnel, rejoignant alors des réflexions sur la « déprofessionnalisation » du travail social et éducatif (Aballéa, Dubet).
Aux termes de son étude historique, C. Garcette conclut : « finalement, la coordination ne se décrète pas, elle se construit » (2008, p. 54). Cette construction se situe au croisement des modes d’intégration du coordinateur dans son équipe et d’appropriation de ses tâches, d’un côté, des orientations organisationnelles des directions d’établissement, d’autre part. La place dévolue au coordinateur parait centrale : sa définition explicite et partagée, la spécificité réelle de ses tâches, les conditions d’exercice de sa fonction.
Le fonctionnement effectif du management transversal
Quelle est la réalité de ce management transversal ? L’horizontalité du pouvoir a-t-elle un sens ? Notre enquête apporte quelques réponses.
L’identité du manager « transversal »
Le rapport au terrain paraît ici décisif pour définir la place de ce nouveau manager : rapport au travail des TS « sur le terrain » et rapport avec les usagers. La directrice d’un établissement interrogée par un de ses coordinateurs et étudiant dans la formation, l’affirme tout de go : « coordinateur, c’est une nouvelle fonction (…) pour ne pas qu’on perde le terrain » (50). Une coordinatrice fait écho à cette position tranchée : « mon rôle de proximité et d’interlocuteur à travers la coordination les a rassurés » (33). Une assistante sociale stagiaire précise : « je pense que le fonctionnement horizontal permet une certaine neutralité avec l’équipe entière. Le fait de ne pas avoir de lien hiérarchique favorise la communication avec les coordinateurs » (50) ; elle invoque la neutralité pour qualifier la posture du coordinateur, précisant que, pour l’équipe, « l’absence de lien de subordination permet des liens plus importants avec les coordos » ; elle y trouve « une approche différente de celles des membres de l’équipe ».
Largement discutée dans la formation, la possibilité de formuler un point de vue, à la fois mode de compréhension et d’implication, est apparue essentielle ; un point de vue différent de celui de la hiérarchie mais aussi des membres de l’équipe, pour exprimer l’activité que suppose une telle prise de position. Le coordinateur est résolument du côté du savoir plus que du pouvoir ; en ce sens, il serait activateur de « l’intelligence collective » (Lemonnier, 2015), si cette expression a un sens. Dans le contenu des monographies, les professionnels montrent l’importance de cette « position médiatrice » (36) mais aussi la complexité qu’il y a à débattre et prendre des décisions à ce « niveau horizontal » (46). Un assistante sociale interrogée lors d’une enquête conclut pourtant : « ce fonctionnement prouve qu’on peut travailler en toute intelligence et de manière efficace sans lien hiérarchique, tout en prenant des décisions quand c’est nécessaire, en se consultant d’égal à égal » (47).
Les rapports avec la hiérarchie
Ces rapports articulent les liens de la hiérarchie avec le terrain et les liens du terrain, particulièrement les équipes, avec cette hiérarchie. L’enjeu, pour le coordinateur, est de constituer le point d’articulation de ces rapports littéralement opposés. Une cheffe de service interrogée constate : « le fait d’avoir un coordinateur bouscule quand même l’organisation dans le sens où le chef de service perd une partie de sa proximité à la fois avec les équipes et avec le public » (48). Un psychologue interviewé dans une monographie dit que « la distribution des missions remet les chefs de service sur des tâches plus administratives parce qu’il y a des exigences de traçabilité, plus de comptes à rendre » (50). Ceci pourrait laisser entendre que l’apparition des coordinateurs a séparé les chefs de service du terrain. Alors que c’est historiquement l’inverse qui s’est passé : c’est parce que les chefs de service avaient perdu leur « proximité » qu’il a fallu introduire des coordinateurs. Il est intéressant de voir qu’aujourd’hui, ce soit une lecture inversée qui en est faite ; cela semble montrer l’institutionnalisation de la fonction et de la place des coordinateurs, et la reconnaissance implicite que le besoin social réel qui fonde la mission des TS est du côté du « terrain », plutôt que ce qu’en font et disent les politiques. La position des chefs de service autant que des coordinateurs est révélatrice de cette tension, de ce « malaise » dans le travail social.
Certains chefs de service refusent cette coupure par rapport au terrain, ils « ne veulent pas lâcher ce côté-là, le terrain, l’éducatif » (48). Une coordinatrice interrogée relève : « la cheffe de service parle d’amertume de devoir quitter le terrain (…), il y a toute une vie du service qu’elle n’a plus » (50). Une autre coordinatrice précise qu’il y a pour eux (les cadres) une « perte de gestes techniques » (48). Un psychologue explique ainsi la situation : « le fait de travailler ensemble avec l’équipe, de travailler avec du bon sens, c’est manager par les valeurs. Ce qu’un chef de service ne peut plus forcément beaucoup faire car il a des obligations administratives de reporting qui souvent bousculent ses valeurs » (50). Une assistance sociale renchérit : « on voit de plus en plus de cadres dans des conflits de valeurs. Vous (les coordinateurs) managez avec toutes vos valeurs » (36). C’est bien en ce sens qu’il faut comprendre la position dite « intermédiaire » des chefs de service, à l’instar des manageurs et anciens contremaitres dans les organisations marchandes. Ces conflits de valeurs, très fréquemment relevés dans les monographies, n’ont rien de théorique : ils correspondent à des manières pratiques et alternatives d’orienter ses choix, de prendre des décisions, d’écouter les demandes des usagers.
C’est le rôle des manageurs, hiérarchiques ou non, de gérer ces conflits de valeurs ; mais, dans une position verticale, on encadre le lien, dans l’autre (horizontale), on construit le lien. Ce que résume d’une certaine façon ce coordinateur : « ces habitudes régulières de travail de terrain, bras dessus bras dessous, facilitent la construction d’un lien un peu plus solide au détriment de la cheffe de service. Il faut alors penser à ne pas marcher dans les plates-bandes des cadres, savoir qui fait quoi entre les coordinateurs et les chefs de service et savoir en référer au niveau en supérieur en cas de complication » (47).
La directrice déjà citée plus haut tranche dans ce sens : « l’organisation verticale a un rôle hiérarchique, très RH. (…) L’horizontalité est sur la mission, le métier » (50). Ce qui ne simplifie pas les choses. Elle ajoute, dans une visée sans doute consensuelle : « ces deux organisations ne s’opposent pas, elles sont complémentaires ». La formule a le mérite d’affirmer le bien-fondé de cette dualité managériale ; elle énonce également le caractère forcément problématique de la position des coordinateurs.
Les actions préconisées pour agir sur le management lui-même
Malgré le souci de permettre le déploiement du problème de l’activité de coordinateur, une consigne de la monographie concernant les plans d’action était de circonscrire le champ des préconisations à ce qui pouvait effectivement relever du pouvoir d’agir d’un coordinateur. Ceci exige de se limiter au niveau micro des situations, de s’inscrire dans les réseaux d’interaction impliquant le coordinateur, de s’intéresser avant tout à ce qui définit les buts des actions de l’équipe. Dans cette perspective, deux types d’action méritent particulièrement d’être relevées dans les propositions des professionnels étudiants.
Le travail sur l’explicitation de la fonction et la place du coordinateur. Cela concerne la définition de la fonction et les modalités de sa mise en actes : cela renvoie pratiquement au travail sur la fiche de poste, pour la reformuler ou la préciser quand elle existe, pour la construire et la renseigner quand elle reste à élaborer. Ensuite, cela suppose le partage des conceptions et des attendus de la fonction avec l’équipe ; il s’agit bien sûr de la mettre en débats avec les collègues et d’autoriser l’affirmation d’un point de vue de la part du coordinateur, dans le cadre d’une rencontre à laquelle participe le chef de service. Embrassant toutes les composantes du « travail de management » (Hubault, 2013), les préconisations des monographies varient beaucoup sur cette thématique, entre celles qui privilégient plutôt la construction du lien dans l’équipe, celles qui sont plutôt orientée vers l’importance de l’écoute de la demande des usagers, ou celles encore centrées sur l’interface avec la direction de l’établissement. Enfin, une visée plus formelle et normative est énoncée : la révision de l’organigramme et la participation du coordinateur dans les instances de régulation des établissement. Le formalisme propre à l’organigramme est mal adapté à représenter « la réalité des rapports de pouvoir dans leur totalité » (Morin, 1985, p. 12) ; dans le cas du coordinateur, c’est particulièrement juste et c’est sans doute pourquoi les auteurs de monographie qui abordent cet objet préconisent surtout que cette fonction soit discutée au moyen de l’organigramme, même s’il est impossible et porteur de confusions de vouloir produire un organigramme qui présenterait le coordinateur à sa juste place…
L’instauration de la réunion de coordination. La référence à la réunion comme moyen de renforcer la coordination ne va pas de soi tant il semble acquis pour beaucoup de ces professionnels comme de leurs collègues qu’une réunion, c’est souvent du temps un peu perdu, on s’y ennuie et, finalement, cela n’est pas très utile à l’activité. Quand elles abordent cet objet (pour près de la moitié d’entre elles), les monographies n’utilisent pas forcément cette appellation : réunion de coordination. C’est pourtant de cela qu’il s’agit lorsque, dans l’une d’entre elles, son autrice semble découvrir cette (fausse) évidence : « en fait, les réunions d’équipe, ça devrait être fait pour poser les problèmes » (24). Les problèmes, ce ne sont pas simplement les dysfonctionnements ou les tensions dans l’équipe ; c’est ce qui empêche et perturbe l’activité, et la possibilité d’en tirer un surcroit de pouvoir d’agir.
Le modèle de la réunion de coordination a été développé notamment par Gagneur et Mayen pour « favoriser l’instauration de la coordination de l’activité collective » (2010, p. 70). Il paraît assez fidèlement condenser les intentions que les professionnels étudiants indiquent dans leurs monographies et les discussions qui précèdent. Trois principes orientent le fonctionnement de cette réunion : « le principe de l’interaction conversationnelle à propos d’une situation réelle » (ibid., p. 71) ; la visée d’explicitation et de mise en discussion des buts, des manières de faire, le fonctionnement observable de la collaboration, des occurrences de l’inattendu ; les conversations portent toutes sur l’activité et les conditions de l’activité, dans la perspective de « la régulation du changement » (ibid.).
C’est comprendre la nature profonde de la coordination que de faire du changement une sorte de norme de fonctionnement pour une équipe, et de la régulation des tensions et des conflits inévitables, une occasion d’inspirer ce changement. Non pas le « changement » auquel les salariés opposeraient une « résistance », aux dires des directions d’entreprise qui cherchent à l’instituer, mais le changement qui est consubstantiel à toute activité sociale en rapport à l’humain, toujours singulière, toujours mobile, particulièrement dans les contextes socio-institutionnels actuels. Ce changement n’est pas toujours visible ou perçu, mais constitue le mouvement naturel des choses. Ces « transformations silencieuses », cette « impermanence » (Jullien, 2009), ne sont visibles que si l’on s’interroge, collectivement, et si l’on est prêt à apporter des réponses ajustées à ce changement identifié. Les coordinateurs intéressés par cette orientation relèvent deux phénomènes en particulier :
– à condition de les rechercher, il y a toujours un peu de nouveautés susceptibles de mettre en question des routines, donc il convient d’être prêt à intégrer de nouveaux modes d’interpréter et de faire, donc apprendre et faire évoluer sa compétence en situation ;
– il y a toujours risque de différends voire de conflits, entre l’usager et le professionnels, le professionnel et les partenaires, entre les professionnels, donc besoin de « réajuster son point de vue » (45), la compréhension de son intérêt et sa conception du service à rendre, donc de l’apprentissage encore [10].
Reconnaissons tout de même que cette pratique de la réunion de coordination n’a été expérimentée que par deux professionnels de notre panel. S’ils relèvent, tous les deux, une certaine « fidélisation » (24, 36) à ces réunions d’équipe d’un genre particulier, cela ne suffit pas pour en confirmer, aujourd’hui, ni leur possibilité, ni leur bien-fondé. Celle-ci devra faire l’objet d’autres expérimentations.
Ces résultats et les préconisations que les professionnels en tirent confirment « les difficultés à travailler de manière collaborative à construire un espace de travail horizontal » (Grosstephan et al., 2023, p. 97), et donc le besoin de « soutenir les efforts des acteurs pour apprendre à reconcevoir leur travail de façon à dépasser la contradiction entre une division verticale du travail et les enjeux liés à une injonction au travail horizontal » (ibid.) C’est ce qui justifie la présence de coordinateurs dans le travail social. Si la notion de « management transversal » ne convainc pas toujours, en particulier les étudiants, c’est moins pour le paradoxe qu’elle contient, que pour l’espèce de paroxysme des tensions qu’il voudrait justement masquer par cette appellation (Gauffer, 2018).
Conclusion
Notre enquête a confirmé des analyses déjà formulées à propos de la coordination dans le travail social ; elle a surtout apporté la dimension du vécu et la diversité des points de vue dans une fonction qui reste problématique, tant pour son utilité que pour la légitimité de celles et ceux qui l’occupent. Le fonctionnement réel de la coordination est le symptôme d’un travail social en transition dans nos sociétés d’individus marquées par une nouvelle précarité, des vulnérabilités multiples et un désir un peu paradoxal d’inclusion à tout prix. Le coordonnateur est censé être l’accompagnateur des changements que cette transition dessine d’une manière un peu floue, indéterminée.
Finalement, ce management en travail social implique-t-il un développement des personnes, des personnes accompagnées comme les professionnels concernés ? Sans doute, si sa mise en œuvre effective autorise de plus grandes interactions partagées sur l’activité même des personnes comme des professionnels ; et si cette mise en œuvre passe par une véritable redéfinition des places dans les configurations sociales complexes au sein desquelles ils sont pris et cherchent à se défaire (Marin, 2022). En somme si elle parvient à se traduire par une vitalité nouvelle de la démocratie aujourd’hui (Dewey, 1916, 2022).
Vous avez dit : « usager » ?
Quand on s’intéresse aux activités de service, particulièrement aux services dits « publics », la dénomination de la personne « bénéficiaire » de ce service n’est pas vraiment stabilisée. L’appellation d’usager est courante, empruntant à un vocabulaire administratif qui s’impose souvent dans les interactions sociales. Le terme « usager » renvoie pourtant à deux idées ou connotations distinctes : quelqu’un – quelque chose, peut-être – de plutôt passif, d’une part, l’expression d’une relation unilatérale du professionnel qui produit le service à l’usager qui le « consomme », d’autre part. Nous savons pourtant que, en matière de service, le prétendu consommateur est nécessairement co-producteur du service, du fait même qu’il constitue la matière même de ce service ; en fait, sa production ne peut pas être dissociée de son usage. Avec ces préventions importantes et au risque de contrarier les chercheurs du domaine, nous privilégions malgré tout ce terme…
Ce que nous retenons, c’est le verbe (infinitif) substantivé, comme il est possible de parler du devenir, du penser. On ne postule pas un pouvoir d’agir particulier, mais l’activité qui consiste à mettre en usage les ressources et les normes propres à un dispositif, un instrument. Cette mise en usage comporte à la fois une dimension individuelle d’appropriation active de ces ressources et normes, et une dimension sociale de développement de « formes de vie » (Ferrarese et Laugier, 2018 ; Fassin, 2018) ; celles-ci forment un ensemble de pratiques et de modes d’action marqués par des croyances, des valeurs, mais également par des institutions ou des appartenances singulières. Substantiver un verbe infinitif, c’est la possibilité de ne pas lui faire perdre son sens actif. En l’occurrence, le sujet ne fait pas qu’utiliser des instruments, mobiliser certaines ressources. En usant de ce service, il affirme une place particulière, une forme d’engagement dans une activité, son activité, il donne corps à ces ressources, donne vie à ces normes et crée ce « rapport d’usage » avec les parties prenantes de l’action sociale (Janvier, 2018).
Dans cette optique, l’usager devient l’un des acteurs du service et de sa réalisation ; il concourt à définir, ou à redéfinir, la place et le mode d’engagement du professionnel attaché à ce service, et donc la relation qui le lie à l’usager. Le sens courant n’est pas masqué pour autant : nous n’oublions pas que cet usager est également le sujet des politiques publiques. Ce double positionnement a l’intérêt d’inscrire les personnes concernées dans « un rapport de politisation » : elles s’ancrent ainsi dans l’espace des politiques de protection sociale et leur « permet de mieux saisir la "portée politique" de leurs activités et leur situation » (Giraud, 2022, p. 183).
Cette conception du sujet des politiques sociales devient l’occasion de redéfinir la possibilité d’un management dans ce « rapport d’usage ». Celui-ci ne peut plus être l’objet d’un traitement institué. Il comporte une action conjointe du professionnel et de l’usager ; dans cette action, la part du professionnel doit être l’objet d’une attention, d’une organisation, d’un aménagement particuliers. Elle ne peut pas simplement découler de directives issues de la hiérarchie. Dans cette optique, le rôle du professionnel se défait d’une fonction d’encadrement ou de contrôle des pratiques et de justification de la politique pour devenir interpellation de cette mise en usage (Foucault, 2023, p. 307-324).
Bibliographie
Des DOI (Digital Object Identifier) sont automatiquement ajoutés aux références par Bilbo, l’outil d’annotation bibliographique d’OpenEdition.
Les utilisateurs des institutions abonnées à l’un des programmes freemium d’OpenEdition peuvent télécharger les références bibliographiques pour lesquelles Bilbo a trouvé un DOI.
Aballea, F. (2013). L’anomie professionnelle. Déprofessionnalisation et désinstitutionalisation du travail. Recherche et formation, 72, 15-26.
DOI : 10.4000/rechercheformation.2014
Barbier, J.-M. (2013). Un nouvel enjeu pour la recherche en formation. Savoirs, 33, 9-22.
Baudot, P.Y. (2022). Les politiques du handicap. Dans O. Giraud et G. Perrier (dir.). Politiques sociales : l’état des savoirs (p. 96-114). La découverte.
DOI : 10.3917/dec.girau.2022.01.0097
Bergeron, G. (2014). Le développement des pratiques professionnelles inclusives : le cas d’une équipe engagée dans une recherche-action-formation. [Thèse, Université du Québec à Trois-Rivières]. https://www.depot-e.uqtr.ca.
Bernoux, P. (2012). Sociologie des organisations. Nouvelles approches, In J.-M. Saussois (dir.). Les organisations. État des savoirs (p. 107-120). Sciences humaines.
Bouquet, B. (2006). Management et travail social. Revue française de gestion, 168-169, 125-141.
DOI : 10.3166/rfg.168-169.125-142
Bouquet, B. (2007). Territoires et action sociale. L’Harmattan.
Cahiers de l’Actif (2018). Dossier : La coordination, une fonction à géométrie variable au service de la logique de parcours, 504-507, mai-août.
Castel, R. (1995). Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat. Fayard.
Clot, Y. (2013). L’aspiration au travail bien fait. Le Journal de l’École de Paris du Management, 99, 23-28.
DOI : 10.3917/jepam.099.0023
Dewey, J. (2022/1ère éd. amér. 1916). Démocratie et éducation. Armand Colin.
Dietrich, A. et Pygère, F. (2016). La gestion des ressources humaines. La découverte.
DOI : 10.3917/dec.dietr.2016.01
Elias, N. (1998). La société des individus. Pocket.
Fassin, D. (2018). La vie, mode d’emploi critique. Seuil.
Favereau, O. (2012). L’économiste face aux organisations. Dans Saussois, J.M. (dir.). Les organisations. L’état des savoirs (p. 97-106). Éditions Sciences humaines.
DOI : 10.3917/sh.sauss.2016.01.0112
Ferrarese, E. et Laugier, S. (2018). Formes de vie : du biologique au social. CNRS éditions.
Foucault, M. (2023/1ère éd. 2013). La société punitive (cours de 1972-73). Gallimard-Seuil.
Fouret, C. et Malochet, G. (coord.) (2013). Les politiques de cohésion sociale. Acteurs et instruments. Publications du Centre d’Analyse Stratégique.
Gagneur, C.-A. et Mayen, P. (2010). Le territoire est-il une situation de développement ? Éducation permanente, 184, 63-78.
Garcette, C. (2008). La coordination en travail social : principe et mode d’organisation. Vie sociale, 3, 45-54.
Gauffer, C. (2018) Le travail des coordinateurs dans le champ social et éducatif. De quoi la fonction de coordination est-elle le symptôme ? L’Harmattan.
Gaulejac, V. de et Vandewattyne, J. (coord.) (2020). Dossier : les métamorphoses de l’emprise dans les organisations, Nouvelle revue de psychosociologie, 29.
Gilbert, P., Teglborg, A.-C. et Raulet-Croset, N. (2017). L’entreprise libérée, innovation radicale ou simple avatar du management participatif ? Annales des mines. Gérer et comprendre, 127, 38-49.
Giraud, O. (2022). Le rôle des idées dans la dynamique de l’État social. Dans O. Giraud et G. Perrier (dir.). Politiques sociales : l’état des savoirs (p.183-199). La découverte.
DOI : 10.3917/dec.girau.2022.01.0183
Gomez, P.-Y. (2016). Intelligence du travail. Desclée de Brouwer.
Gomez, P.-Y. (2019). L’esprit malin du capitalisme. Desclée de Brouwer.
Grosstephan, V. et Lémonie, Y. (2023). De la discussion sur la dimension verticale du travail à l’émancipation des acteurs. Dans F. Brière, et L. Espinassy (dir). Le travail des professionnels de l’éducation (p.95-114). Presses universitaires de Provence.
Hubault, F. (2013). Le travail de management. Travailler, 29, 81-96.
DOI : 10.3917/trav.029.0081
Janvier, R. (2012, 2ème éd.). Vous avez dit « usager » ? Le rapport d’usage en action sociale. ESF.
Jaeger, M. (coord.) (2010). Dossier : coopérer, coordonner, nouveaux enjeux. Vie sociale, 1.
Jullien, F. (2009). Les transformations silencieuses. Grasset.
Ledoux, C. (2022). L’État social au défi du marché. Dans O. Giraud et G. Perrier (dir.). Politiques sociales : l’état des savoirs (p.270-284). La découverte.
DOI : 10.3917/dec.girau.2022.01.0270
Lemonnier, J. (2015). Le management transversal. Outils pour favoriser l’intelligence collective. Vuibert.
Löchen, V. (2013, 4ème éd.). Comprendre les politiques sociales. Dunod.
DOI : 10.3917/dunod.loche.2018.01
Mailliot, S. (2013). La transition professionnelle, « expérience de soi » face au changement. Éducation permanente, 197, 41-50.
Marcel, J.-F., Dupriez, V., Perisset-Bagnoud, D. et Tardif, M. (dir.) (2007). Coordonner, collaborer, coopérer. De Boeck.
Marin, C. (2022). Être à sa place. Éditions de l’Observatoire.
Maurice, M., Sellier, F. et Sylvestre, J-.J. (1982). Politiques d’éducation et organisation en France et en Allemagne. Essai d’analyse sociétale. PUF.
Morin, P. (1985). Le management et le pouvoir. Les éditions d’organisation.
Mousli, M. (2013). Le management de A à Z. Alternatives économiques, Hors série 64 bis.
Nizet, J. et Pichault, F. (2012). La coordination du travail dans les organisations. Dunod.
Nyssens, M. (2015). L’émergence des quasi-marchés : une mise à l’épreuve des relations pouvoirs publics-associations. Les politiques sociales, 1-2, 32-51.
DOI : 10.3917/lps.151.0032
Paillé, P. (1994). Pour une méthodologie de la complexité en éducation : le cas d’une recherche-action-formation. Revue canadienne de l’éducation, Vol 19, 3, 215-230.
DOI : 10.2307/1495128
Paul, M. (2021). Une société d’accompagnement. Raison Passion.
Pistor, K. (2023). Le code du capital. Seuil.
Rullac, S. (2016). Discipline et savoirs professionnels, pour une disciplinarisation annoncée du travail social. Champ social, 148, 17-24.
Saussois, J.-M. (dir.) (2012). Les organisations. État des savoirs. Sciences humaines.
Schwartz, Y. (1997). Les ingrédients de la compétence : un exercice nécessaire pour une question insoluble. Éducation permanente, 133, 9-34.
Schwartz, Y. (2021). Travail, ergologie et politique. La dispute.
Triby, E. (2022). La restitution par problématisation dans les formations diplômantes, une étape de professionnalisation. Dans I. Houot, E., Triby, et F. de Viron (dir.). La restitution, entre activité et formation (p.75-89). Octarès.
Vannereau, J. (2018). Pour comprendre la contradiction entre les discours et les pratiques de management. Carriérologie, 22, 579-594.
Warin, P. (2017). Le non-recours aux politiques sociales. Presses Universitaires de Grenoble.
Williamson, (2012). L’économie des coûts de transaction. Dans Saussois, J.-M. (dir.). Les organisations. État des savoirs (p.91-96). Sciences humaines.
DOI : 10.3917/sh.sauss.2016.01.0105
Auteur Emmanuel Triby
Université de Strasbourg, LISEC
Articles du même auteur
– Le management : cet obscur objet de travail et de formation [Texte intégral]
Paru dans Éducation et socialisation, 68 | 2023
– Éditorial [Texte intégral]
Paru dans Éducation et socialisation, 35 | 2014
– Actualité et inactualité de la stagification [Texte intégral]
Paru dans Éducation et socialisation, 35 | 2014


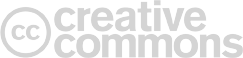
Répondre à cet article
Suivre les commentaires : |
|
