Un article de Jean-Luc Metzger repris de la revue Distances et médiations des savoirs, une publication sous licence CC by sa
Jean-Luc Metzger, « Félicie Drouilleau-Gay et Alain Legardez (dir.) (2020). Travail, formation et éducation au temps des transitions écologiques », Distances et médiations des savoirs [En ligne], 42 | 2023, mis en ligne le 19 juin 2023, consulté le 15 septembre 2023. URL : http://journals.openedition.org/dms/9150 ; DOI : https://doi.org/10.4000/dms.9150
Depuis plusieurs décennies, des scientifiques alertent l’opinion publique et les dirigeants politiques du monde entier : les modes de (sur)production et de (sur)consommation industriels, fondés sur l’exploitation de combustibles fossiles et de ressources non renouvelables, menacent la survie des civilisations. Les réactions n’ont jusqu’ici guère été à la hauteur des enjeux mis en exergue par les experts du climat. Si les discours semblent attester d’une prise de conscience, les procès en inaction climatique, intentés contre les « États » par des associations et des collectifs, montrent qu’il est encore impossible aux sociétés contemporaines de repenser leur modèle productif. Pourtant, grâce à de nombreux médias, la plupart des publics peuvent accéder aux versions simplifiées des diagnostics de plus en plus précis et rigoureux sur l’étendue des destructions irréversibles dues aux activités humaines. Pourtant, institutions publiques, médias « traditionnels » et « sociaux », associations, entreprises spécialisées, etc. mettent à la disposition des citoyens et des décideurs – politiques et économiques – toute une palette de solutions – méthodologiques, technologiques, relationnelles.
Comment alors rendre compte de cette « inertie » ?
Préfaçant l’ouvrage collectif dirigé par Félicie Drouilleau-Gay et Alain Legardez, Marie-Christine Zélem apporte un premier jeu de réponses. Derrière les postures apparemment respectueuses de l’environnement – accords internationaux, lois et discours prônant la sobriété, etc. –, nous dit l’auteure, si les gouvernements des États les plus polluants continuent à accorder la priorité à la croissance qualifiée de « verte », c’est qu’ils parient sur le rôle moteur de technologies miraculeusement « propres ». Les pouvoirs publics semblent attendre des entrepreneurs et des consommateurs qu’ils se métamorphosent en « écocitoyens », touchés par la grâce de l’altruisme environnemental, alors que de toutes parts proviennent des incitations à persévérer dans la surconsommation. Quant aux établissements d’enseignement supérieur, en particulier ceux formant des ingénieurs et des gestionnaires, ils n’ont que très rarement entrepris d’inscrire dans leurs stratégies de fonctionnement et de formation, l’ardente obligation écologique.
Aussi, pour « sortir de l’aliénation technicienne et consumériste », M.-C. Zélem propose d’agir, via la culture et le savoir, pour réaliser la capacitation de « l’ensemble des acteurs, (…) qu’ils soient simples citoyens ou professionnels » (p. 14). Cet objectif est d’autant plus ambitieux qu’il s’agit de modifier en profondeur les dispositions sociales, en particulier, celles portant sur la culture de la consommation et la priorité accordée à la croissance de flux financiers. Il s’agit également de faire prendre conscience au plus grand nombre de « la complexité à mettre en œuvre de façon pragmatique et opérationnelle les transitions écologiques » (p. 13).
Si le constat d’un inquiétant retard par rapport à l’urgence climatique est par ailleurs bien documenté, ce qui l’est moins et fait l’originalité de l’ouvrage, c’est l’insistance sur l’extrême complexité et l’intrication des problèmes soulevés par la lutte contre le changement climatique. En effet, au-delà de leur diversité, les contributions des quinze chercheurs – en sociologie, économie, anthropologie, sciences de l’éducation, écologie et démographie –, se complètent pour souligner que la mise en œuvre des technologies « propres » ne consiste pas à appliquer une méthode préexistante, ni à dérouler un protocole clés en main. Fondant leurs réflexions sur l’analyse d’expérimentations, ainsi que sur les travaux récents du Céreq, les quatorze chapitres montrent que les configurations empiriques – méthanisation, champs d’éoliennes offshore, réseau électrique intelligent, bâtiments à énergie positive, etc. – soulèvent d’innombrables difficultés que seule la coopération durable entre intervenants peut résoudre.
Mais la coopération est d’autant moins spontanée qu’il n’existe pas de consensus a priori sur la manière de penser la lutte contre les conséquences du changement climatique. S’agit-il de « remettre l’économie “à sa place”, et par là même, nombre d’entreprises dominantes, pour donner plus d’importance aux objectifs environnementaux et sociaux » – écologisation de l’économie ? Ou préfère-t-on « nourrir une nouvelle phase de croissance économique » (p. 59), celle-ci pouvant toutefois résulter d’une régulation étatique, au moyen de politiques industrielles ?
Deux ensembles de réponses sont apportés : les premières, au niveau théoriques (1) ; les secondes, au niveau empirique (2).
(1) En ce qui concerne les réflexions d’ordre théorique, la postface de Jacques Theys apporte une palette d’éclairages. Tout d’abord, l’auteur rappelle le retard inquiétant en matière d’adaptation de l’éducation et de la formation à l’urgence climatique : en 2020, il n’y avait toujours pas, en France, de « discipline, de doctorat, de titre de professeur, d’institut national de recherche, ni de corps administratif, de syndicat professionnel, pas plus que de section dans la nomenclature des activités économiques, qui portent en propre sur l’environnement en tant que tel » (p. 260). Certes, on peut expliquer cette inertie par l’existence de rigidités organisationnelles. Mais l’auteur souligne également l’extrême dispersion de tout ce que recouvrent les notions d’environnement et de développement durable.
Comment « réarticuler ces univers dispersés dans un même ensemble cohérent » (p. 260) ? Comment s’accorder sur une définition simple qui permettrait de sortir d’une autre dispersion : celle des « approches, des discours, des thèmes abordés, des modes de classement et de connaissance » (p. 261) ? Peut-être en donnant « une place beaucoup plus grande à l’écologie comme discipline intégratrice [1]. » (p. 262). Car il s’agit de s’engager collectivement dans une véritable « rupture », laquelle doit avoir lieu au niveau culturel et politique : changer le « système des valeurs, les pratiques sociales, les formes de solidarité, les modes de mobilisation démocratique ou des savoirs et finalement de mesure du bien-être et de la richesse » (p. 264). Cette rupture, que l’on ne peut donc pas réduire à une transition, transposée dans le champ de l’éducation/formation, doit simultanément anticiper sur les effets sociaux des mesures qui seront prises pour lutter contre les différentes dimensions du changement climatique. Le risque est en effet grand que ces mesures accroissent les inégalités, les fractures, les conflits, et obèrent leur acceptabilité.
10Synthétisant les principaux apports des contributions de l’ouvrage, l’auteur recommande de compléter le « verdissement » des formations spécialisées par :
– l’enseignement « des compétences génériques propres à tous les métiers (comme le travail collaboratif et l’usage du numérique) » ;
– « une connaissance partagée des enjeux de la transition et du développement durable » ;
– et « un décloisonnement des cultures techniques – avec une plus grande ouverture sur la pluridisciplinarité et les approches systémiques, sur la prospective, la créativité et les apprentissages collectifs » (p. 267).
Pour y parvenir, les sociétés contemporaines devraient corriger les limites criantes du modèle dominant – de l’économie verte, de l’industrie propre, etc. –, en développant des modèles alternatifs fondés, notamment, sur une plus grande implication des habitants et des consommateurs, un changement des modes de vie et l’invention de formes d’organisation du travail viables sur le long terme (p. 268). De tels « modèles » seraient, selon l’auteur, en cours d’expérimentation, disséminés sur les territoires, et auraient en commun « de mettre l’accent sur des ressources immatérielles, la connaissance, la circulation de l’information et d’être riches en emplois » (p. 268).
Et, plutôt que de définir les objectifs de la formation en partant d’une hypothétique capacité des entreprises à définir leurs besoins futurs en main-d’œuvre qualifiée, l’auteur propose de repenser les structures éducatives pour permettre la capacitation des individus, afin que ces derniers puissent co-construire les savoirs, savoir-faire, pratiques, dorénavant requis. En particulier, cela pourrait passer par la création « d’écoles expérimentales associant le travail collaboratif, l’engagement dans des projets collectifs, l’immersion sur le terrain et dans la nature », sans oublier le développement de « l’esprit critique et la culture scientifique » (p. 272).
(2) En ce qui concerne les éclairages empiriques, Stéphane Michun étudie le cas particulier de la filière méthanisation dans laquelle sont mis en œuvre des dispositifs de partage des connaissances, d’échanges de pratiques, des formations, autour de la réalisation de laboratoires et de plateformes de démonstration. Citant une étude du Céreq de 2016 sur la formation dans cette filière, l’auteur souligne que la formation aux enjeux environnementaux y est très limitée, consistant, soit à évoquer les « bons gestes » pour l’environnement, soit à présenter les seules prescriptions institutionnelles (normes à respecter). Ces enseignements n’envisagent aucune critique du modèle productiviste actuel, et ne présentent pas les controverses existantes quant aux orientations à privilégier en matière de transition. Conséquemment, « la logique de la certification des compétences » prend le pas sur « la formation », les diplômes sont remplacés par des certifications, etc. (p. 71). Il arrive également, comme le pointe une étude du Céreq de 2017 consacrée au secteur du bâtiment, que les artisans et les entrepreneurs ne suivent une formation que pour accéder à un marché. Dit autrement, « la formation continue tend à devenir l’auxiliaire d’une démarche de qualification pour l’avantage commercial qu’elle procure » (p. 72). Selon l’auteur, ces exemples (bâtiment, méthanisation) montrent que, pour le moment, la thématique du développement durable « relève plus du registre de la contrainte ou d’un exercice de rhétorique que d’engagements fermes dans une voie de développement radicalement nouvelle » (p. 72).
Si chaque filière professionnelle présente ses spécificités pour concevoir les formations du futur, il est possible de dégager des difficultés communes à résoudre. Ainsi, les analyses de Nathalie Bosse, sur le déploiement des Réseaux Électriques Intelligents (REI) pointent une contrainte que toutes les filières devront prendre en compte. En effet, en formation continue, il s’agit de faire évoluer des métiers existants pour que les professionnels en poste acquièrent de nouvelles compétences – par exemple, que les électrotechniciens maîtrisent un socle de compétences assez solide en TIC (Technologies de l’Information et de la Communication), tandis que les techniciens des TIC doivent acquérir des connaissances en matière d’applications électrotechniques (p. 90). La question se pose de savoir comment y parvenir quand les niveaux de formation initiale sont très variables en fonction de l’âge des salariés. Et si l’on envisage la formation initiale aux nouveaux métiers du développement durable, il faudrait intégrer aux compétences propres à chaque filière, un vaste éventail de connaissances transversales et spécialisées, elles-mêmes en cours de construction. Ce qui « interroge sur la mise en œuvre effective des formations “pluridisciplinaires” » (p. 92). Par exemple, pour ce qui est du domaine des REI, est-ce seulement envisageable de maîtriser un champ aussi vaste que celui qui va « de la production d’électricité à la gestion technique des bâtiments, (…) [en passant par] les réseaux informatiques, (…) la gestion des flux de puissance et la qualité du réseau, le stockage d’énergie, l’électronique de puissance, (…) [sans oublier] des connaissances en sciences économiques (marché de l’électricité) » (p. 92).
Le même type de contraintes à résoudre – difficulté à se projeter en matière de création de nouveaux métiers et de nouveaux cursus de formation – est souligné par Gérard Podevin qui s’est intéressé à la formation dans l’éolien offshore. En plus des nouvelles compétences techniques – celles concernant la construction, l’installation et la maintenance des éoliennes en mer –, les professionnels devraient acquérir la maîtrise du milieu maritime, très différent de l’environnement terrestre. Ce à quoi s’ajoute une préoccupation trop souvent négligée : envisager, dès leur conception, des filières permettant aux salariés des métiers les plus fatigants d’évoluer vers des postes plus adaptés.
Selon Gérard Podevin, une manière de résoudre ces difficultés consiste à miser sur l’effet capacitant des expérimentations émergeant des territoires. En effet, ceux-ci permettraient, dans certaines configurations stables sur la longue durée, d’articuler les approches en termes de filières – politiques publiques au niveau national – et de clusters – les processus d’innovation au niveau local. L’auteur mobilise la notion de « complexe territorialisé de compétences », afin que le territoire ne soit plus considéré comme le « récipiendaire de politiques et de plans d’action nationaux (…), mais comme espace spécifique de création de nouvelles logiques d’acteurs » (p. 115). Et ce, aussi bien pour le « domaine de l’innovation technologique, que pour celui de la production industrielle, la formation et l’orientation professionnelle » (p. 115).
Dans cette perspective, Hubert Amarillo et Pascal Hughetto, à partir de l’étude des réorientations actuelles du secteur du bâtiment, insistent tout particulièrement sur l’importance de mettre en œuvre une organisation du travail qui permette à l’ensemble des acteurs impliqués – entreprises, institutions, individus – de développer un apprentissage collectif. Car, de fait, tout est à inventer in situ, contrairement à ce que le terme « transition » laisse penser : ce vers quoi il s’agit d’aller, la situation à laquelle il s’agirait d’aboutir, n’est pas donné d’avance, mais résulte de la succession de décisions prises par les acteurs locaux pour s’adapter, tant bien que mal, aux exigences normatives. « Pour mesurer les effets sur le travail, les métiers, les compétences, de l’essor des principes du développement durable, il convient d’interroger l’idée même d’une pure et simple transition technologie » (p. 123).
Le principal problème soulevé par la mise en service des bâtiments basse consommation est la surcharge de travail affectant les personnels de maintenance – gardiens d’immeubles, techniciens des organismes –, souvent démunis pour apporter des réponses satisfaisantes et durables. Ces difficultés viennent, certes, de la multiplicité des équipements à faire fonctionner ensemble, mais surtout, de la complexité de la chaîne d’acteurs – bureaux d’études, fabricants d’équipements, entreprises de maintenance, exploitants des systèmes de chauffage, organismes HLM – et de leur coordination défaillante. Plus que la complexité des technologies à « maîtriser », les principaux obstacles à la généralisation de bâtiments sobres résident dans la division du travail, la mise en compétition et les modes de management. Faute de réduire ces obstacles, il est à craindre que de nouveaux conflits surgissent autour de la performance énergétique. Empiriquement, constatent les auteurs, « la qualité des interactions entre les acteurs constitue le socle d’une meilleure performance énergétique des bâtiments » (p. 138).
Sans rendre compte de la richesse des analyses de l’ouvrage, deux de ses apports nous semblent particulièrement féconds.
Tout d’abord, l’ouvrage attire notre attention sur la nécessité, avant tout déploiement de « solution », de préciser vers quel type de société nous souhaitons collectivement nous orienter. S’agit-il d’opter pour un changement radical et rapide de nos modes de vie, de production et de consommation, comme le laisse entendre le terme de décroissance, par exemple ? Ou envisage-t-on de nous engager dans une transition écologique où les activités humaines répondraient, de façon durable, aux besoins identifiés à l’échelle de territoires ? De ce choix dépend une partie des programmes d’éducation et de formation.
Ensuite, l’ouvrage donne à voir l’incroyable complexité des démarches à envisager pour réduire, effectivement et à moyen terme, les empreintes environnementales, énergétiques et sociales des activités humaines. Il est en effet urgent :
– d’anticiper sur les transformations des métiers actuels et la création de nouveaux, en prenant en compte, non seulement l’ampleur des compétences techniques à maîtriser, mais surtout, et peut-être avant tout, les capacités à coopérer ;
– de penser de nouvelles formes d’organisation du travail pour tenir compte des contraintes environnementales et énergétiques sur l’intégralité des cycles de production, ainsi que pour préserver la santé des travailleurs tout au long de leur vie ;
– de repenser les interactions entre les différentes catégories d’acteurs impliqués, sans négliger les collectifs de citoyens destinataires finaux de ces marchandises et de ces services, citoyens auxquels il faudrait également apprendre à coopérer et à s’approprier les processus technologiques ;
- de réfléchir au rôle que devraient jouer l’éducation et la formation, non seulement pour développer les compétences encore largement indéterminées, mais, plus généralement pour que les différentes catégories de la population s’approprient ou inventent une culture de l’écocitoyenneté.
On le voit, cet ouvrage collectif, publié en pleine période de confinement, est à lire de toute urgence.


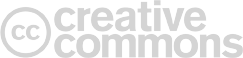
Répondre à cet article
Suivre les commentaires : |
|
