
Gérée comme une crise sanitaire, la pandémie de Covid-19 bouleverse presque tous les aspects de la vie et de l’organisation de nos sociétés, y compris l’enseignement supérieur. L’une des premières mesures destinées à enrayer la diffusion d’une épidémie considérée comme hautement contagieuse a été le confinement, en Italie d’abord puis ailleurs.
Même dans les pays qui n’ont pas pris de mesures de confinement obligatoire au niveau fédéral ou national, comme les États-Unis, l’Australie et la Russie, la plupart des universités ont été contraintes de fermer leur campus au public et de suspendre l’enseignement en face à face pendant plusieurs semaines.
L’Unesco a suivi au jour le jour la situation et montre que cette fermeture des espaces d’accueil physique des étudiants a été l’une des mesures de prévention les plus répandues. Le 12 avril 2020, on comptait 195 pays ayant fermé au public l’intégralité de leurs établissements.
Ainsi, en dépit des différences nationales, tous les établissements d’enseignement supérieur ont été confrontés, subitement, à l’impossibilité d’assurer l’une des leurs missions constitutives, dans sa modalité la plus ancienne et la plus traditionnelle : le face-à-face entre l’enseignant et l’étudiant. En France, comme dans beaucoup d’autres pays, les pouvoirs publics ont demandé aux établissements d’assurer une « continuité pédagogique » pour reprendre les mots de la ministre de l’Enseignement supérieur le 13 mars.
On leur demandait en réalité tout l’inverse, car l’enjeu était d’assurer la continuité de leur mission précisément par une rupture pédagogique. Il s’agissait d’accélérer radicalement la transition d’un enseignement « en présentiel » à un enseignement « en distanciel ». L’incertitude généralisée actuelle – sanitaire, économique et sociale – bouscule les habitudes et les points de repère de tous les acteurs : enseignants, étudiants, administrateurs et dirigeants. Les conditions dans lesquelles s’effectuera la prochaine rentrée universitaire demeurent imprécises.
Si certains établissements – comme Cambridge University en Angleterre ou California State University, la plus grande université publique des États-Unis – ont pris des décisions drastiques annonçant un enseignement entièrement à distance jusqu’à l’été 2021, il ne s’agit là que d’une minorité. À ce jour, 67 % des universités américaines envisagent une année en présentiel, 16 % hésitent ou n’ont pas encore pris de décision, tandis que 17 % ont opté pour l’« online » ou l’hybride.
Nouvelles lignes de force
L’enseignement à distance n’est certes pas une nouveauté en soi. Depuis les années 1960, et bien avant l’engouement récent pour les MOOC, les modalités de formation se sont adaptées aux apprenants qui, pour des raisons géographiques, professionnelles ou familiales étaient incapables de venir en classe. L’Open University en est un exemple.
C’est donc le passage brusque et contraint à un enseignement entièrement à distance qui génère stress et désorientation, notamment chez les jeunes adultes. Ces considérations sont exacerbées par un sentiment d’imprévisibilité plus général, lié aux perspectives de récession économique mondiale et de contraction du marché de l’emploi annoncées par le Fonds monétaire international (FMI).
Rappelons que les flux migratoires pour des raisons d’études n’ont fait qu’augmenter dans le monde depuis les années 1990, passant de 2,1 millions d’étudiants en 2001 à 4,6 millions en 2015. En moins de trente ans, la mobilité essentiellement destinée à combler une offre insuffisante ou insatisfaisante dans le pays d’origine a laissé place à une mobilité beaucoup plus hétérogène et généralisée, avec une progression de la mobilité intra-régionale (Whitol de Wenden, 2019).
Parallèlement à la valorisation croissante de l’expérience internationale, le désengagement progressif et généralisé des États du financement de l’université a entraîné une transformation profonde de son modèle économique. Des logiques de marché et de concurrence entre établissements sont apparues pour attirer les talents à l’échelle mondiale. Depuis les années 1990, la compétitivité internationale de l’enseignement supérieur est inscrite au cœur des stratégies de développement économique de quasiment tous les pays. Les « global rankings » qui apparaissent dès 2003 sont liés à ces mutations et les accélèrent.
Les nombreuses initiatives de certains pays et établissements pour devancer leurs concurrents dans la compétition au recrutement commencent pourtant à se heurter à de nouveaux freins à la mobilité : les attentats terroristes dans le pays du Nord, les évènements climatiques extrêmes, les tensions aux frontières, l’infléchissement des politiques migratoires. En dépit des alertes et prévisions de l’OMS qui, déjà, en 2019 avait classé la pandémie grippale parmi les trois premières menaces à la santé mondiale, la nouvelle perception du risque sanitaire par les étudiants entre soudain en compte dans leurs choix.
Les candidats et leurs familles comparent désormais la réputation des pays en matière d’assistance d’urgence et de soins, leur qualité et leur coût. L’apparition de nouveaux critères peut à terme modifier les équilibres du panorama mondial de l’enseignement supérieur.
Historiquement dominé par l’hégémonie des pays occidentaux de langue anglaise (États-Unis, Royaume-Uni, Australie, Canada et Nouvelle-Zélande accueillent plus de 50 % de la mobilité internationale), le marché des études supérieures est aujourd’hui organisé autour du modèle de l’université de recherche dont l’illustration la plus emblématique est l’Ivy League américaine.
La situation n’est pourtant pas stable. Le curseur se déplace progressivement vers les pays d’Asie qui, portés par leur développement économique et leur poids géopolitique, attirent de plus en plus d’étudiants étrangers, alors qu’ils étaient (notamment la Chine et la Corée du sud) des pourvoyeurs de mobilité sortante.
Depuis l’arrivée au pouvoir de Donald Trump et l’adoption de mesures restrictives en direction des ressortissants de certains pays, les États-Unis enregistrent un fléchissement discret mais constant des candidatures venant de Chine, d’Inde, du Moyen-Orient, trois pays qui alimentent aujourd’hui une grande partie de ses universités. Les jeunes de ces pays se tournent aujourd’hui davantage vers le Canada et surtout vers l’offre régionale qui se renforce et gagne en prestige et visibilité, notamment en Asie et dans le pays du Golfe.
L’annonce récente d’une possible suppression du programme Formation pratique facultative (OPT), permettant aux jeunes diplômés de travailler légalement aux États-Unis dans l’année qui suit la fin des études supérieures, risque d’amplifier le phénomène.
Retour de la pédagogie
La crise du Covid-19 ne fait qu’accentuer des tendances déjà observées. Elle lève quelques-uns des obstacles qui ont empêché jusque-là les universités des pays émergents de concurrencer les grandes universités du monde anglo-américain. Le nerf de la guerre est essentiellement le corps professoral, qui pour diverses raisons d’ordre économique, statutaire, politique – ou tout simplement de style de vie – n’est pas près de renoncer aux conditions de travail et de recherche qu’offrent de lieux comme la côte est américaine ou la Silicon Valley.
À lire aussi :
Comment la globalisation bouleverse l’université
L’expérimentation pédagogique qui a été menée pendant le confinement, dans des conditions extrêmes, mais généralement avec succès, peut être le prélude d’un retour de la pédagogie au centre de la formation. La crise a montré que la qualité de l’enseignement et la satisfaction des étudiants tient en grande partie à la conception du cours et à sa structuration, peut-être plus qu’à la liste des publications scientifiques de l’enseignant.
Ce n’est pas un hasard si le métier d’ingénieur pédagogique a fait son apparition pour devenir, en l’espace de quelques semaines, un personnage-clef dans la vie des universités. Ni que les grandes universités américaines comme Harvard augmentent le nombre de formations en ligne à l’ingénierie et au design pédagogique.
Comme l’ont déclaré plusieurs présidents d’université et experts du monde arabe et d’Asie du sud, cette crise redistribue les cartes. Elle peut inciter des établissements situés en périphérie des grands flux à mutualiser leurs ressources avec des partenaires étrangers, ce qui accroît leur visibilité et la compétitivité des formations.
Les établissements situés dans des contextes instables et fragiles, comme la Palestine ou certains pays des continents africain et sud-américain, peuvent, par le développement d’un enseignement à distance de qualité, former des publics traditionnellement exclus ou éloignés des campus universitaires.
La réponse à ces tendances et à ces rééquilibrages variera selon la nature des enjeux liés à l’enseignement supérieur. Dans les pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie qui ont fait de leur enseignement universitaire une industrie de poids dans la croissance économique nationale, tous les moyens seront déployés pour reconquérir les étudiants, par des techniques de marketing adaptées et une politique de bourses et d’aide sociale volontariste.
Il faudra aussi se prémunir contre le risque d’un désistement massif des candidats admis, d’une demande de remboursement de frais des étudiants mécontents ou d’un contentieux sur la qualité des cours. Certaines des universités les plus prestigieuses (telles la London School of Economics) dépendent en effet largement des frais de scolarités des étudiants étrangers.
Dans d’autres pays, comme la Chine, l’enjeu sera la capacité à s’appuyer sur les entraves à la mobilité internationale dans ce temps de crise pour encourager le retour des talents dans ses propres structures de recherche, et poursuivre ainsi son ambition de développement économique par l’innovation scientifique.
![]()
Alessia Lefébure ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son poste universitaire.


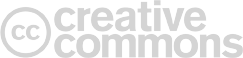
Répondre à cet article
Suivre les commentaires : |
|
