Un articlede Michel Durampart repris de la revue Distances et Médiations des Savoirs, un site sous licence CC by sa
Cette réflexion revient sur le premier texte de Daniel Peraya au sein de la rubrique Débat-discussion de DMS : « Technologies, innovation et niveaux de changement : les technologies peuvent-elles modifier la forme universitaire ? » (Peraya, 2018) prolongé depuis par d’autres chercheurs et Daniel Peraya lui-même. Le très intéressant texte quasiment prospectif de Daniel Peraya appelle et suscite plusieurs remarques et réactions. En premier lieu, nous allons souligner deux lignes de force qui nous paraissent constituer la forme scolaire : la « clôturation » et la transformation des pratiques éducatives liées au développement des médias éducatifs qui s’inscriraient alors dans la longue lignée d’une démarche pédagogique centrée sur la transformation d’un support de communication en outil de transmission (Mœglin, 2005). Ceci permet d’aborder de fait l’innovation liée aux technologies éducatives au sein de la forme scolaire comme atout principal pour penser les enjeux du statut et du rôle de l’université. La question des changements mis en œuvre dans l’évolution de la forme universitaire se pose alors.
En premier lieu, il nous semble opportun de réagir sur le prétexte utilisé par Daniel Peraya à partir de la polémique sur le smartphone dans les établissements scolaires. Nous avons conduit et participé à des programmes de recherche où indirectement cette question de la place du smartphone, de la téléphonie mobile, au sein de l’école se traduit dans la question de la place des objets-frontières (entendons par objets-frontières des objets qui, du point de vue de l’école, peuvent poser des questions de légitimité, objets informels buissonnants entre la sphère privée et publique). Dans les contextes éducatifs, nous avons partiellement constaté que le smartphone pouvait s’intégrer dans les pratiques éducatives scolaires, mais cela se produit souvent dans des dynamiques de contournement des principes et des règles sous la forme de contrats, de négociations passées entre les enseignants et personnels éducatifs et les élèves. Ce phénomène donne raison à Bruno Devauchelle (2018) : « Ce sont les acteurs eux-mêmes, et en particulier ceux qui y travaillent au quotidien, qui pilotent l’évolution de cette forme et les résistances que l’on observe ». Nous reviendrons sur cet argument en le nuançant quelque peu cependant. Pour exemple, dans une de nos observations menées en collège sur un projet pédagogique dit innovant (Collet, Durampart et Pélissier, 2014), une responsable de CDI passe un accord avec les élèves fréquentant le centre afin qu’ils puissent utiliser leur portable (proscrit au sein du centre de documentation) pour peu qu’ils en fassent un usage utile en termes de recherche d’informations liée à leur présence dans le centre. Elle se résout à agir ainsi plutôt que de passer un temps chronophage à réprimer les utilisations non conformes. Pour autant, et Daniel Peraya (2018) rappelle avec justesse et judicieusement d’autres exemples venus d’autres pays, cette interdiction/ encadrement pose question, n’est jamais vraiment réglée. Ce phénomène repose cette ancienne question bien étudiée par Pierre Moeglin (2002) de l’aporie entre stabilisation et instabilité. C’est bien aussi la porosité entre des pratiques sociales et des pratiques éducatives qui nous obsède lorsque la forme scolaire est aux prises avec l’évolution de la place des médias éducatifs en son sein. Le téléphone mobile est rétif. Il est complexe et délicat de le fondre dans une démarche bien établie au cœur de l’école qui consisterait à en faire un média éducatif, opération qui consiste donc à transformer et re-clôturer son usage pour qu’il soit conforme avec le monde scolaire et ses finalités. C’est ce qu’illustre cette situation, mais est-il possible de proscrire plutôt que de chercher à clôturer ainsi, d’une certaine manière, un dispositif qui joue une place centrale dans les relations entre l’école et son environnement. La question est ouverte et l’étude au long cours des conséquences de cette décision sera certainement fertile.
La forme scolaire permet-elle (et avec quelles limites) une caractérisation de l’université ?
Si nous revenons sur le fond même de la proposition de Daniel Peraya, nous voudrions apporter un point de vue peut-être un peu dissonant sur cette très pertinente spéculation (qui semble rejoindre certaines positions des différentes auteurs contribuant à ce débat) consistant à faire entrer une projection de la forme scolaire vers une forme universitaire. L’usage que nous faisons de la forme scolaire, et cela a ouvert une discussion récemment lors d’une communication au colloque Ludovia (Durampart, 2018), nous fait établir une certaine distance avec des catégorisations délimitées de cette forme. Il s’agit plutôt de prendre ce mouvement de pensée et ces débats sur la forme scolaire comme une invocation, une référence qui offre comme socle pertinent de reposer différemment avec d’autres focales la question du statut, du rôle et de la place de l’école et du rapport entre école et société. Il est bien sûr possible de la définir et de la prendre comme curseur d’interrogation. Autrement dit, nous serions plus sensible aux interrogations et termes de ces interrogations liées à la forme scolaire qu’au versant caractérisation. D’ailleurs, dans sa stimulante contribution Melina Solari Landa (2018) montre bien que : « ses caractéristiques [de la forme scolaire] ne font pas l’unanimité chez les chercheurs ». De plus, nous éprouvons une certaine difficulté à prendre la forme scolaire comme un concept, il s’agit pour nous plutôt d’une notion.
Sur ce plan des formes, puisque Daniel Peraya nous propose d’enrichir les références, nous voudrions souligner, évidemment sur un tout autre plan, la possibilité de prendre en compte les travaux produits, au sein du courant de la communication des organisations. Il s’agit notamment d’articles de C. Le Möenne (2001) sur les formes sociales qu’il traduit du côté des techniques par « formes objectales » à partir, par exemple, des travaux de Thévenot (1986). Formes sociales propensives, dissipatives, altérées, etc. qui tentent aussi de rejoindre une forme de matérialité du contexte sociotechnique liée à une matérialité et un imaginaire des techniques : « Ces objets numériques nous obligent au fond à repenser profondément, en remontant à l’origine des techniques, notre rapport aux objets, qui ne sont pas extérieurs à nous, qui sont des « formes objectales », dans la mesure où elles sont des dispositifs de mémoire cristallisée par des normes et des pratiques collectives accumulées, qui nous permettent, depuis l’aube de l’humanité, d’agir dans des mondes sur lesquels nous ne connaissons pas grand-chose, grâce aux routines et informations cristallisées dans ces formes. Autant dire que les dispositifs numériques apparaissent à quelques égards comme le résultat de longues lignées évolutionnaires d’objets informationnels, et non pas comme les premiers dispositifs de mémoire artificielle. » (Le Moënne, 2015). Cette traduction est évidemment très rapide. Schématiquement, elle signifie que les techniques, les objets, sont ancrés à travers des processus, des routines, des investissements affectifs qui, d’une certaine façon, peuvent cristalliser, sédimenter la façon dont les sujets sont aux prises avec la marche incertaine du monde et de l’environnent qui les entoure en les réassurant en quelque sorte face à l’incertitude. Ces formes objectales ont donc une propension, à travers des processus d’appropriation, à révéler la façon dont les sujets se conduisent dans les mondes sociaux, qu’il s’agisse d’accompagnement, de focalisation, mais aussi de détournement ou de déviation. Cette question des formes objectales qui agissent au sein des formes organisationnelles prend aussi en charge la question des rythmes d’évolution, de l’accélération, des dislocations/recompositions organisationnelles et nous paraît donc intéressante à relever. Elle offre un complément, un contrepoint, permettant d’interroger ce qui se passe entre les organisations de la connaissance et l’apport des TNIC (technologies numériques d’information et de communication) en termes de formes organisationnelles dont la forme universitaire. De plus, elle s’inscrit bien dans une archéologie des médias éducatifs en termes de filière longue, d’historicité des évolutions éducatives. Il nous semble bien que l’intéressante notion de cristallisation marque bien la tension entre pérennisation des transformations et leur délicate stabilisation.
Je voudrais ajouter à la lignée des travaux invoqués par les différents auteurs dans cette rubrique, la part cruciale du débat critique apportée par ces analyses. Nous pouvons relever que l’intérêt des travaux sur la forme scolaire (Montandon, 2005 ; Vincent, 1994) est que cette notion servait à révéler des débats qui se déroulaient alors que l’école traversait une crise de légitimité et se voyait contestée par d’autres formes concurrentes, confrontant espace ouvert et fermé, clôture et ouverture altérité et altération, formes instituées/formes informelles. Cléopâtre Montandon (2005) met cette filiation théorique en relation avec le contexte des années 1960 et 1970, pendant lesquelles l’école a été accusée de bien des manières différentes de faillir à sa mission avec les critères universalisme/particularisme, spécificité/diffusion, affectivité/neutralité pour caractériser des formes sociales de relations, dont la forme scolaire. À notre époque, l’école doit sans cesse redéfinir et préserver cette préséance avec ces formes concurrentes (en les connaissant bien également et en étant lucide sur les enjeux en lice). Cette situation critique s’est d’autant plus accentuée avec l’enseignement à distance, la formation sur mesure (notamment du fait que c’est un marché très convoité et dynamique). Le milieu scolaire et, sans doute avec une plus forte pression encore, les universités, doivent donc prendre en compte les propositions et les atouts de ces formes concurrentes. D’autant plus que celles-ci s’attachent en plus de façon disséminée à fonder leur préséance en délégitimant les formes insaturées de la transmission des connaissances comme l’université ou, tout au moins, à soutenir que ces institutions ne sont plus en mesure de remplir leur mission.
La fabrique de l’enseignement à l’université confronté aux dispositifs numériques
C’est, nous semble-t-il, un des termes de ce débat qui vaut pour l’université, mais il peut manquer un aspect dans ce qui est distinctif à l’université. Cela peut sembler une évidence (mais l’est-elle autant de fait ?) que l’on fasse une distinction entre pédagogie et andragogie au sein d’un même débat sur la légitimité de l’école comme de l’université à répondre à leur grande mission et rôle et leur contestation souvent invoquée ou implicite par toutes les formes éducatives concurrentes qu’elles soient formelles ou informelles. De ce point de vue, l’université peut connaitre ces bouleversements, mais elle est déjà dans un état de contamination, exposition à son environnement puisque, bien plus que l’école, elle est en situation de ne pas réguler les pratiques venues de l’extérieur. De ce point de vue, l’université est sans doute encore peut être plus exposée face à la construction de discours porteurs et promoteurs des MOOC, par exemple, dans la sphère de la formation, de l’apprentissage pour adultes qui devient un marché dense et extrêmement concurrentiel. L’industrialisation de la formation devient aussi l’enjeu de toutes les formes concurrentes au secteur public sur le socle de la capacité à ériger une éducation de masse.
Plus ouverte et poreuse face à sur son environnement et c’est là que l’on peut faire une distinction, l’université a-t-elle besoin d’une forme de « clôturation » pour être efficiente ? En fait, c’est bien dans deux directions que cet axiome peut se révéler pertinent. La relation privilégiée et construite avec les apprenants sur la base d’une formation citoyenne suppose la non-reproduction des modèles professionnels des mondes privés, entrepreneuriaux à partir d’une formation de masse (au moins collective) privilégiant une temporalité longue avec des parcours installés dans un cadre privilégié et spécialisé en présence et en proximité. De ce point de vue, on doit bien constater que l’université ne peut s’empêcher de reproduire des modèles importés tout en tentant de définir des modèles propres à sa forme. Il peut s’agir de création de parcours et diplômes ad hoc, de validation des acquis professionnels, d’adossement entre formation continue et formation initiale, de modèles organisées de plateformes pédagogiques collectives se voulant collaboratives, mais aussi d’importation ou de recréation de MOOC ou de propositions standardisées fournies par les grands opérateurs ou prestataires du web.
L’interrogation de la forme du point de vue du fonctionnent montre bien que l’hybridation des modèles, des supports, des situations, ne va pas de soi (Peraya, 2014). N’est-il pas question plutôt d’un renouvellement où l’innovation se doit d’assumer conjointement la rupture et le prolongement avec les pratiques en cours ?
Dans le système scolaire, il a pu se produire la tentation d’une congélation, il nous semble qu’actuellement les réalités et les politiques évoluent sur ce plan. Nous sommes en accord avec l’argument avancé par Daniel Peraya dans le premier texte : « la généralisation d’un outil, sa « routinisation », n’implique pas nécessairement une évolution générale et homogène de son usage, pas plus que des pratiques pédagogiques dans lesquelles elles s’intègrent ». Une autre idée s’insère donc alors autant pour l’école que l’université, ces formes ont pour rôle de résister aux phénomènes d’accélération (Rosa, 2010), de précipitation, de saturation, que les TNIC peuvent susciter dans d’autres formes organisationnelles. L’école a alors pour rôle de ralentir, de proposer un cadre de connaissances en sus de l’acquisition d’un savoir et d’une maitrise, l’université a au moins pour fonction, de contextualiser ces socio-technologies. Cela suppose de fait d’élaborer un socle, un processus, qui permet de propager une intelligence institutionnelle à partir d’une réflexivité (penser ce que l’on fait en même temps que l’on fait). Sous un autre angle, on pourrait évoquer le manque ou la faible consistance d’une discipline fondée dans l’enseignement historique, culturel, polémique, discuté, des technologies numériques, non pleinement assurée à l’école. Penser le numérique devrait se retraduire dans l’histoire longue d’une pensée sur la culture des techniques qui pourrait constituer une discipline (méta discipline) en elle même. C’est visiblement difficile à constituer à l’école, mais l’université, encore une fois, par le biais de disciplines constituées : sciences de l’éducation, sciences de l’information-communication, psychologie, sciences cognitives, sémiologie, philosophie, anthropologie, etc., est pour le coup bien armé. C’est bien la question d’une culture des techniques et d’une histoire des technologies et de leur traitement scientifique autant que du sens de leur usage pour l’université et d’une « pédagogisation » du numérique au sein de l’école : Sloterdijk, l’homéotechnique (2000) et Latour, la traduction (1994). Nous sommes de ce fait assez enclin à partager la conclusion du texte de François Villemonteix (2018) évoquant un rapport récent de l’IGAENR (2018) qui : « souligne la difficulté des universités à prendre en compte les potentialités qu’offre le numérique pour le développement d’une nouvelle culture professionnelle et organisationnelle ». La porosité, la contamination, ce que l’école et l’université font avec le numérique, le renouvellement en ce sens des pratiques rend encore plus sensible une nécessité de préserver un espace privilégié, hors des pressions sociales tout en assumant au mieux ces effets sociotechniques devenus incontournables avec le « technologisation » du monde, « la plissure numérique » diraient certains. Il ne s’agit donc pas tant de proscrire, que de ralentir, de contextualiser de mettre à distance. L’école, pas plus que l’université, n’a à se préoccuper de reproduire les mondes sociaux en son sein, autre incidence s’il en est de la traduction de la forme scolaire. Par contre, elle a pour destination de les faire étudier et de préparer les citoyens de demain à s’y insérer au mieux tout en gardant une liberté d’agir et d’évoluer. Nous sommes toujours un peu navré d’entendre certains collègues (notamment en Institut Universitaire Technologique, IUT) qui énoncent d’une certaine façon un contresens constituant à dire que le mieux en termes d’enseignement c’est de faire au plus près des modèles des professionnels au sein des entreprises, voire de procéder comme ils le font. Indirectement, ils reprennent ainsi à leur compte l’idée que l’université n’est pas en phase avec les attentes des entreprises. On peut se demander si, vis-à-vis des TNIC, le même type de position n’a pas tendance à se développer alors qu’il s’agit de donner ainsi aux étudiants la possibilité de les connaitre et les utiliser tout en forgeant aussi une distance et une éducation afin de former d’aussi bons praticiens que de vrais citoyens. L’enseignement de la maitrise et celui de la connaissance ne devraient pas être incompatibles, mais les conceptions qui forgent l’idée que la maitrise (par exemple celle du codage) suffit à constituer la connaissance nous paraissent au mieux emprunts d’une certaine méconnaissance de ce qu’est la délicate mission d’enseigner, au pire, emprunt d’une vision déterministe qui fait fit rapidement de l’histoire de la philosophie, de l’heuristique des connaissances et des enjeux techniques, enjeux du siècle.
Or, l’université peut aisément, autant ou plus que l’école, réapproprier dans un cadre contingent les TNIC afin de re-légitimer le rôle et le statut de l’université face à toutes ses formes concurrentes. N’y a t-il pas au fond de la question l’idée de promouvoir autrement que par des injonctions performatives ce fameux statut de l’apprenant-acteur, stratège (ce qui mérite par ailleurs une réflexion sur le fait que cette désignation « apprenant-stratège » pourrait véhiculer en germe une forme de démission de la fonction d’enseignement). Il semble bien qu’en l’état la liaison présence et distance peut être d’une certaine façon désarticulée et pourrait même renvoyer alors plutôt à l’absence (Jacquinot-Delaunay, 1993).
Justement, lorsqu’il s’agit de l’évolution des pratiques pédagogiques, le statut de l’apprenant est encore plus crucial à l’université du fait qu’il s’agit d’une andragogie destinée à des adultes. Cependant, nous voudrions relativiser la place centrale donnée aux acteurs dans le cadre des effets ou démarches de changement, d’adaptation. L’école (plus que l’université pour le coup), actuellement, montre des dispositions au niveau institutionnel à susciter des dynamiques, des matrices (E Fran, Incubateurs, Fab Ecole) qui tentent de résoudre l’infernale équation opposant les innovations locales (micro) aux conduites de changement global (niveau macro : le plan informatique pour tous à l’école dans les années 1980 et les plans équipement tablettes conduits en France à partir de 2012). Ces démarches (qui impliquent le plus souvent des chercheurs universitaires) semblent bien se développer afin d’échapper aux freins des innovations locales non transposables et des plans globaux sur un modèle général et descendant se diluant dans la lourdeur et les nombreuses apories des processus mis en œuvre ou de leurs propres contradictions. L’université serait à ce niveau plus rétive à se penser, si l’on ose dire, comme porteuse de son propre changement, mais elle est aussi structurée autour de l’activité scientifique que, finalement, elle ne sait pas toujours bien utiliser comme vecteur d’une capacité à penser l’université dans un cadre de renouvellement, donnant toute sa place aux technologies socialisées, qui modifierait également sa forme. Pour reprendre et compléter la distinction trilogique de la proposition de Daniel Peraya à partir des niveaux micro, meso, macro, nous proposons alors de subdiviser encore cette trilogie (comme le fait Melina Solari Landa) en articulant conjointement l’institution, l’organisation, le système constitué de collectifs. Le niveau micro pourrait alors s’incarner aussi dans le fonctionnement, l’opérationnel, le niveau meso dans l’activité et la structure et le macro dans l’orientation, l’encadrement, la planification. Par ailleurs, une des particularités finalement de cette forme universitaire pourrait résider dans l’adossement formation-recherche. C’est un méta savoir qui est en jeu, ce qui ravive donc la question de la contextualisation qui permet d’éviter une « clôturation » sans porosité.
De ce fait, les dynamiques d’innovation devraient donc s’accompagner d’une réflexivité, d’un auto-apprentissage, sur les changements conduits, d’une contextualisation, d’une prise en compte des remédiations. Il n’est finalement pas si grave que l’innovation soit conduite en rupture, transposition ou continuité, même s’il convient d’interroger cette trilogie dans la réponse pertinente ou non qu’elle apporte. Le problème est bien qu’un consensus se forge peu sur le sens et l’orientation des transformations conduites et pas non plus sur les stratégies qui devraient souder les pratiques de changement, les termes des innovations conduites avec l’évolution de la forme universitaire par exemple. L’université, plus encore que l’école, est en mesure de réduire ces tensions entre innovation locale difficiles à sédimenter ou à généraliser et grandes orientations stratégiques séparées d’un portage et d’une acceptabilité localisée (Mœglin, 2002) par la remise en cause d’un impérium du niveau macro avec la constitution d’une dynamique de projets portée par le collectifs. À ce niveau, nous proposerions d’étudier en parallèle comment, dans des contextes différents, des formes structurées par une mission de service public sont disloquées et reconfigurées conjointement comme l’université, l’hôpital, les organisations de santé, le secteur de l’intervention sociale. Une telle approche serait utile à prendre en compte dans la conduite d’une mise en perspective des tensions au sein des formes. Cela pourrait, et c’est là que la proposition de Daniel Peraya est très stimulante et judicieuse, souligner comment se constitue des asymétries entre les changements conduits dans le fonctionnel et l’opérationnel, les pratiques, et l’évolution réelle des formes qui ne traduisent donc qu’incomplètement et imparfaitement ces dynamiques et mouvements. C’est là aussi que l’intelligence des acteurs pourrait aussi trouver une traduction et un appui dans l’intelligence organisationnelle.
Bibliographie
Collet, L., Durampart, M. et Pélissier, M. (2014). Focus sur les terrains de recherche CRDP, médiathèques, OBTIC, en région PACA. Les cahiers de la SFSIC, p. 154-155.
Durampart, M. (2018, août). Quel devenir pour la forme scolaire face aux innovations liées aux dispositifs numériques ? Communication présentée au Colloque, Ax-les-Thermes, France.
Jacquinot-Delaunay, G. (1993). Apprivoiser La distance et supprimer l’absence ? Ou les défis de la formation à distance. Revue Française de Pédagogie, 102, 55-67. Récupéré de : http://ife.enslyon.fr/publications/edition-electronique/revue-francaise-de-pedagogie/INRP_RF102_6.pdf
Latour, B. (1994). De l’humain dans les techniques. Dans L’empire des techniques (p.167-179). Paris : Seuil.
Peraya, D. (2018). Technologies, innovation et niveaux de changement : les technologies peuvent-elles modifier la forme universitaire ? Distances et médiations des savoirs. 21. Récupéré de : http://journals.openedition.org.proxy.scd.univ-lille3.fr/dms/2111
Peraya, D. (2014). Distances, absence, proximités et présences : des concepts en déplacement. Distances et médiations des savoirs, 8. Récupéré le 20 février 2018 de : http://archiveouverte.unige.ch/unige:44549.
Mœglin, P. (2005). Outils et médias éducatifs : une approche communicationnelle. Grenoble : Presses universitaires de Grenoble.
Moeglin, P. (2002). Qu’y a-t-il de nouveau dans les nouveaux médias. Dans G.-L. Baron et E. Bruillard, Les technologies en éducation, perspectives de recherches et questions vives (p. 153-164). Paris : Maison des sciences de l’Homme.
Montandon, C. (2005). Formes sociales, formes d’éducation et figures théoriques. Dans Les formes de l’éducation : variété et variations (p. 223-243). Bruxelles : De Boeck. Raisons éducatives, 223‑43.
Le Moënne, C. (2015). Pour une approche propensionniste des phénomènes d’information-communication organisationnelle. Communication & Organisation, 47, p. 141-157.
Rosa, H. (2010). Accélération : une critique sociale du temps. Paris : La Découverte.
Sloterdijk, P. (2000). Règles pour le parc humain : une lettre en réponse à la « Lettre sur l’humanisme » de Heidegger. Paris : Mille et une nuits.
Vincent, G. (1994). L’éducation prisonnière de la forme scolaire ? Scolarisation et socialisation dans les sociétés industrielles. Lyon : Presses universitaires de Lyon.
Thévenot, L. (1986). Les investissements de forme. Paris : Presses universitaires de France.
Pour citer cet article
Référence électronique
Michel Durampart, « Les technologies peuvent-elles aider à accentuer une forme universitaire qui gagne en légitimité tout en restant singulière ? », Distances et médiations des savoirs [En ligne], 24 | 2018, mis en ligne le 17 décembre 2018, consulté le 07 janvier 2019. URL : http://journals.openedition.org/dms/3205
Auteur
Michel Durampart
Aix Marseille Univ, Université de Toulon, IMSIC, Toulon , France
Michel.durampart@univ-tln.fr



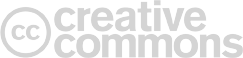
Répondre à cet article
Suivre les commentaires : |
|
