
« Mon Dieu, arrêtez-vous, laissez-moi médicamenter cette affaire. » (Molière, « Le médecin malgré lui »)
Si l’on cherche un terrain où le changement de Président et de majorité présidentielle aurait induit une rupture avec les politiques antérieures, ce n’est pas, malgré le tohu-bohu autour de Parcoursup, du côté de l’enseignement supérieur qu’il faut espérer le trouver. De réformes en réformettes, on poursuit dans la voie d’une mutation opaque qui fait perdre à l’université une part essentielle de son ambition universelle et humaniste : la voici encore plus réduite à l’horizon exclusif et étroit de la formation professionnelle.
Entre la loi Savary et la loi Fioraso, l’évolution de l’écriture des missions universitaires témoigne de cette stupéfiante atrophie des ambitions. Par un biais technique, la loi du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants (ORE) s’inscrit dans cette funeste continuité.
Le diable est dans le détail
À bien lire l’article 34 de la constitution du 4 octobre 1958, aucune des mesures prises pour l’orientation et la réussite des étudiants ne relevait du domaine de la loi qui, selon l’alinéa 4, ne fixe que les principes fondamentaux en cette matière. Les aménagements proposés appartiennent à l’évidence au domaine réglementaire, donc au gouvernement : la mesure la plus frappante, celle prévoyant la création d’un dispositif d’orientation préalable à l’inscription, ne remet pas du tout en cause le principe fondamental d’accès à l’enseignement supérieur pour tous les titulaires du baccalauréat.
Au contraire, le projet affirmé est de lui donner une réelle matérialité. En revanche, le consacrer en l’inscrivant dans une loi risquait de focaliser l’attention sur le procédé, donc d’ouvrir la voie à ses détracteurs pour y déceler une intention sélective voilée. Ce qui ne manqua pas de se produire !
Alors, pourquoi prendre le risque de solenniser une solution technique promue comme une amélioration par rapport à l’arbitraire tirage au sort, et qui laisse en suspens la question fondamentale de l’articulation entre la fin du secondaire et l’entrée dans le supérieur ? Probablement pour deux raisons : d’abord pour procéder à la validation législative, sous la pression du calendrier, d’un dispositif mis en place avant même toute intervention normative ; ensuite, et ce n’est pas sans lien, afin de se mettre à l’abri de recours intempestifs devant la juridiction administrative compétente pour les décrets et arrêtés.
Mais ce qui nous retiendra ici, plus que cette question de Parcoursup qui a fait couler beaucoup d’encre, c’est un autre aspect de la loi ORE, passé totalement inaperçu, qui concerne les conditions de vie étudiante. Il y a d’abord l’exécution d’une promesse électorale : la suppression du régime spécial de sécurité sociale. À partir de la rentrée de 2018, les nouveaux étudiants seront rattachés au régime général (les anciens devront patienter encore un an). La suppression de la cotisation représente un sensible allègement des frais payés au moment de l’inscription (217 euros en 2017).
Et puis vient le « détail » qui en dit long sur la vision que l’on se fait du statut de l’étudiant et de son mode de gestion : il est contenu à l’article 12-V de la loi et a été intégré à l’article L 841-5 du Code de l’Éducation.
L’étudiant tronçonné
Article étonnant deux fois : par ce qu’il propose, et par la manière dont il dispose. Par ce qu’il propose d’abord :
« Une contribution destinée à favoriser l’accueil et l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d’éducation à la santé réalisées à leur intention est instituée […]. »
Étrange résurgence. Il s’agit donc de percevoir un supplément aux droits d’inscription fixé au départ à 90 euros, le choc étant atténué par la suppression de la cotisation sociale. Or plusieurs universités dans les années 1990, pour faire face à leurs missions, particulièrement en matière sportive et culturelle, prélevaient des « droits spécifiques » qui leur permettaient de financer les services correspondants.
Les syndicats étudiants, l’UNEF en tête, s’étaient mobilisés contre cette pratique, en allant jusqu’à attaquer les universités concernées devant la juridiction administrative où ils ont obtenu gain de cause. De fil protestataire en aiguille juridictionnelle, on en arriva à proscrire totalement ce complément, pourtant bien utile pour encourager les universités à agir dans le domaine de la vie étudiante. Le voici qui réapparaît, imposé par un État incapable d’intégrer cette charge à la dotation globale des établissements, ou d’assumer une augmentation des droits d’inscription dont les montants restent ridicules.
Mais la surprise vire à la stupéfaction, lorsqu’on lit à l’alinéa V :
« La contribution est acquittée auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires dans le ressort territorial duquel l’établissement a son siège. »
C’est donc le CROUS qui effectuera la répartition de la nouvelle contribution, selon un barème qui sera établi par décret. Le choix de cet opérateur, derrière son apparence purement technique, n’est ni neutre ni innocent. Le CROUS ne sera pas seulement un opérateur collecteur et redistributeur : il est formellement habilité à conserver une partie de la manne collectée en sus de ses ressources propres. Ce qui revient à lui faire partager les missions des universités d’une manière concurrentielle : car, au fil des années, les établissements d’enseignement supérieur ont développé leurs propres outils tant en matière de santé qu’en matière culturelle et sportive. Parallèlement, les CROUS ont fait de même. Comment traiter la question des doublets ? Quelle efficacité peut avoir une clé de répartition décidée par décret, alors même que sur le terrain, les initiatives des établissements et donc leurs besoins diffèrent d’un site à l’autre ?
Voilà donc ce qui s’appelle, à proprement parler, jeter son bonnet par-dessus le moulin. Nous avons, dans ces mêmes colonnes, souligné le lourd archaïsme d’un système des Œuvres universitaires conçu à une époque totalement révolue de l’histoire universitaire, à la fois hypercentralisée et socialement élitaire. La confiscation de la gestion des conditions de vie étudiante prive les universités d’un levier essentiel en même temps qu’elle fracture toute approche unifiée du statut de l’étudiant. À l’heure où la décentralisation invite à une synergie des établissements universitaires avec les collectivités territoriales, où l’évolution des cadres juridiques autorise ces dernières à prendre en main la question du logement étudiant, on persiste, à contre-sens du bon sens et des recommandations de la Cour des comptes, dans le vieux monde d’Œuvres surannées !
Logement, restauration, santé, sport et culture : le lobby des CROUS et du CNOUS continue à faire prospérer son nid dans le cœur des universités. Coalition tacite de hauts fonctionnaires ignorant les évolutions ? Indifférence des responsables universitaires à la dimension éducative des conditions de vie ? Quoiqu’il en soit, voici consommée la rupture entre la vie étudiante, incluant l’apprentissage des savoirs et la culture, et la vie de l’étudiant ramenée à sa condition pratique.
L’université diminuée
Il s’agit là d’une véritable régression dans la conception des missions des universités. Dès 1968 pourtant, la loi Faure prévoit que celles-ci « facilitent les activités culturelles, sportives et sociales des étudiants, condition essentielle d’une formation équilibrée et complète » (art. 1 de la loi du 12 novembre 1968 d’orientation de l’enseignement supérieur). Accompagnant la première vague de démocratisation massive de l’enseignement supérieur dans les années 1980, la loi Savary introduit explicitement une mission de professionnalisation. En même temps, elle tente de conjuguer « l’élévation du niveau scientifique culturel et professionnel de la nation et des individus qui la composent » avec « la réduction des inégalités sociales et culturelles » (art. 2 de la loi du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur). Désormais dotées d’un conseil des études et de la vie universitaire, les universités ont pour mission de développer la culture et de « favoriser l’innovation, la création individuelle et collective dans le domaine des arts, des lettres, des sciences et des techniques » (art. 7).
Dans ce cadre – qui restait encore trop flou puisque les conditions de mise en œuvre n’étaient pas précisées – vont pouvoir se déployer sur les campus des services voire des centres culturels, chargés de conduire une action culturelle conçue en lien avec l’enseignement et la recherche, et en prise avec l’environnement institutionnel et social. Certes, les promoteurs de ces structures auront bien souvent d’énormes difficultés à les imposer et seront contraints à toutes sortes de bricolages pour les faire vivre : tiraillée entre l’indifférence des enseignants-chercheurs, la concurrence exercée par les CROUS et la convoitise des organisations étudiantes, l’action culturelle universitaire est souvent perçue comme une intruse dans une institution qui peine à encaisser le véritable choc culturel que constituent la massification et la professionnalisation de l’Université. Or c’est précisément ce double phénomène qui la rend nécessaire, pour autant que l’objectif soit réellement « d’élever le niveau scientifique culturel et professionnel de la nation ».
Nécessaire et exemplaire : l’Université, désormais ouverte aux catégories sociales qui jusque-là ne s’y sentaient pas légitimes, aurait pu et dû devenir un précieux laboratoire pour expérimenter la construction de liens équitables et fructueux entre culture cultivée, culture de masse et cultures populaires.
Il faudra un autre choc culturel, celui des attentats de 2015 et 2016, pour qu’enfin la loi prévoie la possibilité pour les universités de se doter de services communs dédiés au « développement de l’action culturelle, sportive et artistique, et à la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle. »
Curieusement, c’est en effet la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté qui inscrit formellement cette possibilité dans le Code de l’Éducation – cette même loi qui, dans son chapitre 1er intitulé « Encourager l’engagement républicain de tous les citoyens et les citoyennes pour faire vivre la fraternité », crée une réserve civique. Certes, le dispositif restait incomplet, puisque le chapitre du Code de l’Éducation consacré aux « activités péri universitaires, sportives et culturelles » ne traite que la question du sport… et aucunement celle de la culture.
Mais ce chemin détourné restait une victoire sur la prétention des CROUS à s’emparer de l’action culturelle, qu’aucun texte législatif ne leur confie spécifiquement. Il confirmait enfin, plus de trente après la loi Savary et les combats des premiers pionniers de l’action culturelle universitaire, le rôle de l’art et de la culture dans le processus de formation des étudiants. Restait à en établir ou consolider les moyens financiers.
Dans cette perspective, la création d’une contribution spécifique, telle qu’instituée par la loi ORE, est évidemment une bonne nouvelle. Mais sa perception par les CROUS est un contresens funeste et coûteux, qui confie une part essentielle de toute formation « équilibrée et complète » à des établissements n’ayant aucune compétence en matière éducative.
Cela au mépris de la nécessaire articulation de l’action artistique et culturelle avec la transmission du savoir, et au risque de réduire le périmètre de la culture à l’animation amateur de la vie étudiante. La seule manière d’empêcher cette dérive, d’éviter les doublets et les concurrences stériles, serait d’enfin intégrer les CROUS aux établissements universitaires. Mais à l’évidence, cette évidence dérange…
![]()
Claude Patriat est cofondateur de l’association nationale A+U+C, dont il été coprésident pendant 10 ans ; il a par ailleurs été 20 ans vice-président de l’Université de Bourgogne en charge de la culture.
Isabelle Mathieu a été chargée de mission à l’association nationale A+U+C.


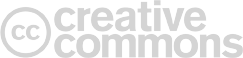
Répondre à cet article
Suivre les commentaires : |
|
