
L’idéologie numérique – l’idée que le numérique bouleverse tout, qu’il est la solution miracle qui résoudra tous les maux actuels – est combattue par de nombreux chercheurs en communication. Cependant, cette idéologie gagne sans cesse du terrain, y compris au sein des sciences de l’information et de la communication (SIC). En témoigne, la volonté d’un professeur en SIC de fermer un parcours de master à faible effectif (le parcours « Communication et démocratie participative ») pour ouvrir un nouveau parcours sensé attirer plus de monde : le parcours « Communication numérique ». Cette décision, par ailleurs vivement contestée, est un exemple édifiant, permettant de mettre en lumière plusieurs des mécanismes en jeu dans la progression continue de l’idéologie numérique et la disparition progressive, non moins continue, de l’esprit critique.
Précisons, pour commencer, que le décryptage que nous proposons ne s’inscrit ni dans un positivisme désuet visant à observer « les faits sociaux comme les choses » (Durkheim) ni dans une impossible « neutralité axiologique » (Weber). Il s’inscrit dans une épistémologie de la complexité (Morin) ne séparant pas le chercheur de l’acteur, et qui invite l’analyste à identifier ses présupposés pour favoriser la critique de ses pairs – ici que la société est un tout trop complexe pour être déterminée de manière unique par la technologie. Cette analyse, conformément à l’approche ethnométhodologique, profite de la connaissance intime du terrain (la formation analysée) pour proposer une étude réflexive non plus désincarnée mais nourrie de la chair des affects locaux.
Le discours sur la révolution numérique est une idéologie
Ces précisions épistémologiques effectuées, éclairons maintenant les termes du débat. De plus en plus d’outils et de procédures sont numériques. C’est incontestable : le monde d’aujourd’hui ne ressemble pas à celui existant au siècle dernier. Le numérique est un fait social, massif. Mais le discours disant que cette numérisation est : un, une révolution et, deux, un progrès favorisant la communication est une idéologie (la volonté d’imposer sa vision du monde en niant sa diversité). Pourquoi ?
Tout d’abord, parce qu’il n’y pas que le numérique qui prétend tout changer : toutes les technologies, de l’électricité à la pilule en passant par les nanotechnologies ou le nucléaire peuvent prétendre avoir « révolutionné le monde ». En vérité, si les technologies, numériques ou non, participent à l’évolution sociale, elles le font toujours dans une interaction conflictuelle entre elles (le téléphone contre le pc ou l’éolien contre le nucléaire, par exemple).
Surtout, les technologies se déploient ou disparaissent parce qu’elles sont soumises à des facteurs économiques (prix, rentabilité, etc.), politiques (type de gouvernement, conflits armés, etc.) et religieux (dogmes existants, nombres de croyants, etc.) qui interagissent différemment suivant les territoires. Jamais dans l’histoire de l’humanité une technologie n’a engendré une nouvelle société.
Ensuite, communiquer ce n’est pas utiliser des outils numériques. La communication c’est, essentiellement, du temps et de l’espace. Du temps, pour comprendre que l’on ne se comprend pas tout à fait ; de l’espace, pour trouver la bonne distance entre le même qui est en l’autre, et l’autre qui est en nous-mêmes. Or, les outils numériques tendent justement à abolir l’espace et le temps, donc la communication. La propagation contagieuse d’une information plus ou moins vérifiée par connexion numérique n’a rien à voir avec la communication, rappelle avec juste raison D. Wolton dans Informer n’est pas communiquer (CNRS éditions). Les termes du débat étant maintenant éclaircis, passons au décryptage proprement dit. Quels sont les mécanismes conduisant à la fermeture d’un parcours communication dédié à la démocratie au profit d’un parcours consacré au numérique ?
Premier mécanisme en jeu : le bluff technologique. On doit à Jacques Ellul cette notion qui désigne le fait que ce qui est possible technologiquement doit nécessairement être mis en œuvre au nom du progrès social. Le bluff technologique c’est le discours – porté par les industriels du secteur, les ingénieurs informatiques et les technocrates – qui fait de la technique la solution à tous les maux sociaux. Or, dit Ellul, la technologie n’est ni positive, ni négative ni neutre. Il déploie trois arguments en ce sens :
-
tout progrès technique se paie d’un point de vue écologique (pollution) ou social (chômage) ;
-
tout progrès technologique soulève au moins autant de difficultés qu’il n’en résout (cf. la question de la protection des données personnelles à l’heure d’Internet) ;
-
tout progrès technologique engendre des effets imprévisibles qui font courir des risques croissants à la société (cyberterrorisme).
Le rôle des chercheurs, explique Ellul, n’est pas de propager ce bluff qui enferme la démocratie dans les mains des ingénieurs, mais de participer à l’ouverture du débat démocratique sur les choix technologiques. Il s’agit de répéter, encore et encore, que l’évolution technologique n’a rien d’inéluctable, elle doit rester un choix de société. Il s’agit de briser « l’encerclement de l’évidence » et non d’entrer dans la ronde.
Deuxième mécanisme en jeu : ce que l’École de Palo Alto nomme une « prédiction auto réalisatrice » c’est-à-dire une prédiction qui se réalise uniquement par le fait qu’on la prédise. Un présentateur télé prévoie une pénurie de carburant, du coup tous les automobilistes se précipitent dans les pompes à essence ce qui provoque, effectivement, une pénurie ! C’est exactement le cas pour le numérique. Le bluff technologique promu par les GAFA rencontre – via la publicité, le lobbying auprès des partis politiques et le financement de certaines recherches – un fort écho médiatique, politique et social. Donc, pour ne pas être « dépassé », chacun achète du numérique et l’importance de ces outils dans nos vies s’accroît. Dès lors, les nouveaux étudiants veulent du numérique dans leur formation pour « s’adapter » à cet accroissement qu’ils ne font qu’amplifier. Au lieu de déconstruire cette « demande sociale », fruit d’une prédiction auto réalisatrice savamment orchestrée, on préfère y céder. Le rôle de l’université n’est-il pas pourtant de former des citoyens critiques ?
Les chercheurs en SIC devraient déconstruire l’idéologie numérique et non la propager
Le troisième mécanisme en jeu est donc la lâcheté des universitaires. J’ai déjà consacré un texte à ce sujet et ne vais donc pas y revenir longuement. Plutôt que de se battre contre la dégradation des conditions de recherche (de moins en moins de moyens récurrents) et d’enseignements (de plus en plus d’étudiants, pour un personnel de moins en moins nombreux), la plupart des universitaires courent après les appels d’offres du privé et/ou intègrent une logique gestionnaire dans la direction des formations qu’ils animent. Cette dernière ne vise plus la qualité de la formation, la satisfaction des étudiants ou la demande du territoire, mais obéit à un critère unique : la rentabilité à court terme. Quitte à forger des chômeurs ? Oui, hélas ! Le processus est tellement répandu que les formations à la communication numérique se multiplient au-delà de ce que le marché peut absorber !
Le quatrième mécanisme en jeu est la déconnexion, de plus en plus inquiétante, entre recherche de terrain et réflexion théorique. Comme pour la science économique, les sciences de l’information et de la communication voient se multiplier les thèses empiriques très détaillées et très bien conduites empiriquement mais très légères sur le plan théorique et presque indigentes sur le plan épistémologique. Du coup, les nouveaux enseignants-chercheurs connaissent très peu de choses sur les théories actuelles de la communication et sont incapables de penser les relations entre savoir et pouvoir. Dès lors, pour eux les concepts de communication numérique ou d’espace public numérique sont des évidences ! Pourtant, d’une part, la communication ne se réduit pas à la communication médiatisée par des outils et, d’autre part, les outils numériques ne sont pas des outils de communication mais des outils de connexion ce qui n’est pas du tout la même chose.
La tache de l’universitaire n’est pas uniquement de décrire parfaitement ce qu’il rencontre sur le terrain, elle est surtout de proposer une interprétation théorique qui suscite la réflexion sociale. Le cas décrypté ici montre tout l’inverse. Ce que révèle, en définitive, cette volonté de substituer la communication numérique à la communication politique, c’est bien la disparition d’un sens critique capable de remettre en question l’ordre établi, au profit d’un prêt-à-penser (une doxa dirait Bourdieu) faisant d’un processus social compréhensible (un bluff technologique porté par une prédiction autoréalisatrice savamment orchestrée) un mouvement inexorable et naturel. Penser c’est dire non, avertit pourtant le philosophe.
![]()
Éric Dacheux est responsable du parcours de master « Communication et démocratie participative » de l’UCA.


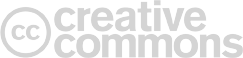
Répondre à cet article
Suivre les commentaires : |
|
