Un article repris du magazine The Conversation, une publication sous licence CC by nd
L’évaluation des élèves par notation a fait l’objet de nombreuses critiques, en particulier de la part du didacticien des mathématiques André Antibi, qui a dénoncé, de façon retentissante, une « constante macabre ». La formule renvoie à la pression sociale qui pousserait les enseignants, pour que les évaluations soient considérées comme crédibles, à mettre un certain pourcentage de mauvaises notes quel que soit le niveau de la classe.
Si cette analyse a rencontré de multiples échos depuis sa première apparition, en 1988, les notes ne semblent pas être descendues depuis de leur piédestal dans le monde scolaire et universitaire. Elles continuent à jouer un rôle essentiel, tant dans les examens, comme le bac, que dans les procédures d’orientation ou d’affectation, telles que Parcoursup, ou Affelnet.
À lire aussi :
Comment les notes ont-elles pris tant d’importance dans le système scolaire ?
Faut-il conclure de cette persistance que la notation serait une nécessité incontournable quand il s’agit de tester les connaissances des élèves et déterminer leurs acquis ? Faut-il y voir un mal nécessaire, faute de pouvoir évaluer mieux ? Ou existe-t-il des alternatives ?
Former ou sélectionner ?
On est redevable à André Antibi, disparu en mai 2022, d’un double apport, aussi instructif qu’utile. En premier lieu, on lui doit la mise en évidence de ce qu’il a désigné, selon la formule citée plus haut, et qui a frappé les esprits, la « constante macabre ». Il la définit comme « le pourcentage à peu près constant d’échec qu’il doit y avoir dans toute évaluation pour qu’elle paraisse crédible ».
Tout se passe comme si les évaluateurs postulaient qu’il doit y avoir, dans une distribution de notes, quel que soit par ailleurs le niveau du groupe, « une sorte de constante : la proportion de mauvaises notes ». D’où une répartition constante des élèves en trois groupes à peu près équilibrés – avec des notes supérieures à celles des autres pour le premier, des résultats dans la moyenne pour le deuxième et inférieures à la moyenne de la classe pour le troisième – contenant chacun environ un tiers des sujets évalués. Ce qui crée artificiellement de l’échec pour les élèves classés dans le dernier tiers, victimes alors d’« une forme de violence ».
Pour Antibi, c’est « la société » qui a « mis en place cette constante », en faisant « jouer aux enseignants un rôle de sélectionneurs malgré eux ». La pression sociale qui s’exerce en faveur d’une « sélection sournoise » contraint les enseignants/évaluateurs à jouer le « rôle désagréable » de sélectionneur social. Le remède serait alors simple : redonner « à l’enseignant son vrai rôle : former (et non pas sélectionner ».
[Plus de 80 000 lecteurs font confiance à la newsletter de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui]
Ainsi se comprend le second apport décisif d’Antibi, dans le sens d’une évaluation qui serait davantage conforme à ce vrai rôle, autrement dit d’une évaluation « formative » : l’Évaluation Par Contrat de Confiance (EPCC). Celle-ci permettrait de commencer à substituer au « contrat implicite » de sélection « dicté par la société », un contrat explicite pour une évaluation mise au service des élèves, contrat dicté par leur besoin principal : apprendre.
L’Évaluation Par Contrat de Confiance repose sur l’idée qu’il ne faut pas chercher à piéger l’élève, mais au contraire à l’encourager. Cela peut se faire au moyen d’une évaluation se développant dans un « climat de confiance », en étant davantage destinée à évaluer les connaissances qu’à classer les élèves : « Le principe est simple : l’élève dispose d’une liste d’exercices traités en classe, et il sait que l’essentiel de son sujet sera constitué d’exercices de cette liste ».
Récompenser le travail
Il faut observer, d’une part, que cette pratique évaluative ne peut concerner que des « contrôles » faits en classe, en cours d’apprentissage. Et, d’autre part, que la critique d’Antibi ne porte que sur un usage contestable de l’évaluation par notation, et non sur le principe de la notation lui-même. Car la « constante macabre », ne représentant qu’un « dysfonctionnement », n’est pas une fatalité. On pourrait très bien imaginer, et juger souhaitable, une distribution ne comportant que de bonnes notes !
En restreignant le champ de l’évaluation à ce qui a été effectivement travaillé et appris, l’EPCC permet de récompenser le travail, et de ne pas transformer chaque contrôle en concours classant les élèves. Mais, si elle semble réunir certaines conditions sociales et pédagogiques d’une meilleure prise en compte des résultats d’apprentissage, elle ne garantit nullement, d’une part, une appréciation pertinente des acquis des élèves ; en soi, elle n’assure pas que les notes attribuées sont objectives et justes.
D’autre part, elle ne remet pas en cause la pertinence de la notation, ne posant pas la question de savoir en quoi une note aurait vraiment la capacité de traduire la réalité d’un apprentissage. N’y a-t-il pas mieux à faire que noter ? S’il faut refuser une notation qui fabrique injustement de mauvais élèves, faut-il accepter la notation comme moyen pertinent d’évaluer ?
Le vrai problème est celui de la production de la note, ou plutôt du jugement appréciatif que la note est censée exprimer, jugement qui pourrait s’exprimer sous d’autres formes. Car le jugement qui, dans l’évaluation, traduit l’appréciation des acquis des élèves, obéit à une double contrainte. Celle de traduire le plus objectivement et exactement possible la réalité d’un état ou niveau de compétence (problème de saisie du réel). Et celle de traduire cette réalité d’une façon claire et opératoire (problème de communication du résultat de la saisie).
À lire aussi :
Orthographe : la dictée ne suffit pas à évaluer le niveau des élèves
Or, la note, par son apparence de résultat de mesure, semble respecter la deuxième contrainte. Mais elle fait oublier la première, que l’on tient pour automatiquement respectée (quoi de plus immédiatement objectif qu’une mesure ?). La difficulté principale est que l’évaluation n’est pas une mesure au sens strict, et que la note donne une fausse impression de rigueur.
Nourrir l’ogre algorithmique
Évaluer signifie formuler un jugement sur l’acceptabilité d’une situation par référence à des attentes. L’évaluateur scolaire est à la recherche d’informations utiles pour étayer un jugement défendable sur le niveau des élèves. On peut alors distinguer deux grands types de situations.
Ou bien il aura besoin d’informations éclairantes sur l’état d’avancement de chaque élève dans ses apprentissages, en vue de l’aider à progresser. À supposer alors qu’il trouve (comme tente de le faire l’EPCC), des modalités et des épreuves d’évaluation pertinentes, respectant la première contrainte, la note, par sa sécheresse, et la faiblesse de son pouvoir d’information, est loin d’être pour lui la meilleure façon d’exprimer son jugement.
Il pourra, par exemple, préférer des outils de communication tels que les grilles d’observation analytiques, fondées sur des descripteurs concrets des activités révélant (ou non !) les connaissances ou compétences visées. Une évaluation « formative », en cours d’apprentissage, n’a guère besoin de notes. Et l’on peut à juste titre demander ici aux enseignants/évaluateurs d’« évaluer sans noter ».
Mais, dans un second grand cas, il pourra avoir besoin d’informations « classantes », c’est-à-dire d’informations permettant de comparer des individus selon leurs « performances » dans des domaines précis, en vue de procéder à des tris, ou à des choix, dans une perspective de certification, ou, plus largement, de sélection.
Il faut bien reconnaître que plus l’on s’approche d’un seuil de certification, comme le bac, ou d’orientation, comme les choix de filières après le collège, ou d’une formation pour l’entrée dans l’enseignement supérieur, et plus les décideurs (jurys, commissions travaillant dans les systèmes d’affectation) ont besoin d’informations « classantes », faciles, sinon à interpréter (que signifie la note de 11,5/20 ?), du moins à manipuler ! Car il faudra bien, in fine, répartir sur une échelle verticale, et classer, ne serait-ce qu’en deux tas : reçus/collés ; acquis/non acquis.
Tant qu’il faudra donc, en quelque sorte, nourrir l’« ogre algorithmique », dans sa fonction d’aide au choix, et à la décision, l’apparente clarté, et l’apparente objectivité, de la note, en font un outil d’information très commode, dont on a (et aura) beaucoup de mal à se passer.
Mais la facilité d’utilisation justifie-t-elle le déni des ambiguïtés et des difficultés ? Peut-on continuer à faire « comme si » la note était une mesure assurée et indiscutable des performances scolaires ? Antibi avait raison sur ce point : c’est la pression que la société exerce en faveur de la sélection qui provoque des « dysfonctionnements » tels que la « constante macabre ».
Mais chaque fois qu’une sélection s’avère nécessaire, la tentation de la notation devient quasi irrésistible. Pourra-t-on, en ce dernier cas, se passer de notes ? Il faudrait pouvoir leur substituer d’autres repères simples et parlants… qui restent à inventer ! À bon inventeur, salut !
![]()
Charles Hadji ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.


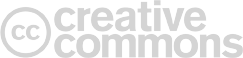
Répondre à cet article
Suivre les commentaires : |
|
