Un article repris du magazine The Conversation, une publication sous licence CC by nd
Au-delà de la seule question des droits d’inscription dans les universités remise sur la table, semble-t-il, malgré lui, par le candidat Emmanuel Macron, la question de l’autonomie des universités constitue l’une des différences en matière d’enseignement supérieur entre les programmes des candidats à l’élection présidentielle.
Là où des candidats comme Jean-Luc Mélenchon se prononcent pour l’abrogation de la loi dite « d’autonomie des universités » mise en place en 2007 par Valérie Pécresse, cette dernière entend a contrario, à l’instar d’Emmanuel Macron, renforcer cette autonomie, ce que les présidents d’universités demandent également.
Pour bien comprendre les termes de ce débat, il importe de revenir avant tout sur l’histoire et la réalité de cette autonomie. La questionner au prisme des enjeux actuels autour de la formation continue permet également de mesurer l’autonomie ne se résume pas à une question managériale mais doit être appréhendée plus globalement, à l’aune d’un contexte organisationnel et social.
Une « longue marche »
La question de l’autonomie a été récurrente dans « La longue marche des universités françaises » décrite par Christine Musselin, à l’image d’un ensemble de questions qui, si elles font toujours débat de nos jours, étaient déjà à l’agenda du ministre Ferry… en 1883 !
Read more :
La recherche à l’épreuve de la mise en concurrence
Plus récemment, c’est en 1968 (article 3 de la loi Faure) que l’autonomie en matière financière a été formellement attribuée aux universités, avant d’être de nouveau évoquée avec la loi Savary dans son article 20, qui la renforce sur le plan pédagogique, scientifique, et administratif. En 1986, c’est avec le projet de loi « Devaquet » que l’enjeu réapparaît, dans le prolongement du discours de politique générale de Jacques Chirac pour qui
« le principe d’autonomie doit être définitivement concrétisé tant à l’entrée – au moment de la sélection des étudiants – qu’à la sortie – au moment de la délivrance des diplômes. L’autonomie doit aller de pair avec un allégement des structures universitaires, un décloisonnement du travail d’enseignement et de recherche, une mobilité accrue des hommes, un essor nouveau donné à l’innovation qui doit s’ouvrir sur le monde extérieur, sur l’industrie bien évidemment, mais aussi sur la coopération scientifique internationale ».
Plus récemment encore, et sans être exhaustif, c’est en particulier la loi LRU (2007) qui a consacré l’autonomie de gestion des universités françaises, en leur transférant la gestion de leur masse salariale, de leurs emplois et pour certaines d’entre elles, de leur patrimoine immobilier, (prolongeant ainsi la logique de la Loi organique relative aux Lois de Finances de 2001).
Enfin, la Loi de Programmation pour la Recherche de 2020 contribue également, à sa façon, à développer l’autonomie des universités, par exemple en rendant possible à titre expérimental, le recrutement de Maîtres de Conférences non qualifiés par le Conseil National des Universités.
Pour autant, la mise en œuvre de la loi a aussi conduit les présidents d’université à pointer certaines décisions qu’ils jugent contraires à cette autonomie. Aussi, cette histoire de l’autonomie de gestion des universités peut être mise en perspective avec les limites qu’elle rencontre, dans sa mise en œuvre.
Des possibilités… contraintes
Si la loi LRU était destinée à conforter la capacité d’action stratégique des universités, elle renvoie aux paradoxes d’un « État Stratège » qui n’en continue pas moins de « gouverner à distance », par exemple dans le cadre d’appel à projets compétitifs comme le plan Campus ou le Programme des Investissements d’Avenir (PIA), qui attribuent des financements à des programmes jugés innovants.
Read more :
Loi de programmation recherche : vers une polarisation du monde universitaire
Quant au transfert de gestion aux établissements, a priori acté par la loi LRU, il convient également de discuter sa portée réelle, notamment sur le plan des ressources humaines, levier essentiel. En effet, le cœur de la réforme que constitue le transfert aux universités de la masse salariale et de plafonds d’emplois (qui limitent la capacité des universités à recruter), ne suffit pas à donner toutes les marges revendiquées par les établissements. La compensation par le Ministère du fameux « Glissement Vieillesse Technicité » (accroissement mécanique des dépenses de personnel lié aux carrières), constitue ainsi un motif récurrent de débat, compte tenu de son poids dans les budgets des établissements.
En outre, les règles de gestion des personnels titulaires sont toujours influencées par des normes et pratiques nationales antérieures, tandis que celles des personnels contractuels s’en inspirent fréquemment, dans un souci d’égalité de traitement quitte à questionner l’attractivité des concours. L’Inspection générale relevait en 2013 la grande frilosité des établissements dans la mobilisation de la possibilité, ouverte par la loi LRU, de recruter des personnels contractuels.
Aussi, le recours limité à ces nouvelles possibilités constitue une forme de « dépendance au sentier » (le fait de persister dans des choix une fois adoptés même si d’autres solutions, meilleures, apparaissent). Cela peut s’analyser au prisme du contexte local (par exemple en tenant compte de l’impact du dialogue social au sein des organisations électives que sont les universités), mais aussi d’une systémique et d’un environnement sociopolitique plus global et national.
Les ressources de la formation continue ?
Dans sa perspective d’État « stratège », le ministère voit dans le développement des ressources propres une des clés de la mise en œuvre concrète de l’autonomie. En particulier, la formation continue universitaire est perçue comme une « machine à cash », d’autant plus quand les ressources publiques viennent à manquer.
Ces dernières années, on assiste pourtant à une grande stabilité sur ce créneau. Sur le marché de la formation professionnelle, les universités engrangent seulement 493 millions d’euros. Ainsi, les établissements publics d’enseignement supérieur comptaient en 2019 pour 3 % des 16,5 milliards d’euros de chiffres d’affaires du secteur hors apprentissage.
Ce chiffre, certes en augmentation, masque un recentrage des établissements publics sur la formation diplômante – la formation courte comptant pour 18 % des inscrits) en formation continue à l’université en 2019 contre 31 % des inscrits en 2009.
Et pour cause, les établissements restent largement cantonnés aux formations longues. La durée moyenne des formations délivrées par les établissements d’enseignement supérieur est de 144 heures, contre 14 heures pour une formation professionnelle hors université, et les établissements parviennent difficilement à positionner leurs diplômes sur le registre spécifique.
On voit certes émerger de nouvelles figures de l’universitaire, qui valorisent l’interdisciplinarité et l’utilité sociale et économique des savoirs académiques, mais la profession académique reste marquée par les principes d’indépendance, de désintéressement et de capacité à s’autoadministrer.
Read more :
Jusqu’où peut-on invoquer la liberté académique ?
Par ailleurs, l’université reste tournée de façon prédominante vers la formation initiale, et ce encore davantage quand la population étudiante augmente fortement tous les ans et que les moyens par étudiant baissent de façon presque continue depuis dix ans.
Ces deux éléments donnent à voir qu’on ne peut penser l’action de l’État qu’en interdépendance avec les universités et la profession académique, à savoir dans sa « configuration universitaire ». L’autonomie ne peut pas se décréter, et la formation tout au long de la vie ne peut en être le moteur financier qu’à cette condition.
Le poids de la formation initiale
Ces questions ne relèvent pas seulement d’une configuration universitaire mais aussi d’un contexte sociétal. A l’étranger, la question de la formation tout au long de la vie se pose différemment. Ainsi en Suède, l’accès aux bourses et aux emprunts pour étudier peut se faire jusqu’à 60 ans, quand les bourses sont disponibles aux seuls moins de 28 ans en France, sans que le financement public des reprises d’études longues soit développé par ailleurs.
L’organisation des parcours importe également. Ainsi, en Angleterre, la plupart des étudiants terminent leur cursus initial en fin de Licence, le Master relevant principalement d’une spécialisation plus tardive dans la vie professionnelle.
En France, on assiste à un mouvement massif vers la masterisation : en 2018, 55 % des sortants de formation initiale avec un diplôme du supérieur ont un diplôme au moins égal au niveau Master contre 41 % en 2010. Résultat : la poursuite d’études longues une fois sur le marché du travail est très peu fréquente en France et seuls 14 % des étudiants y ont plus de 25 ans(contre 54 % en Suède par exemple).
C’est bien là que réside la spécificité française : l’université ne trouve guère sa place sur le marché de la formation professionnelle, car ce marché est construit, en France, pour offrir principalement de la formation courte et en adéquation directe avec les besoins des entreprises. Cette facette de la politique d’autonomie des universités dépend ainsi probablement moins d’une injonction du ministère que d’une révision plus globale de la place de la formation longue dans les parcours professionnels.
Finalement, les cas de la gestion des ressources humaines et de la formation continue constituent deux exemples qui invitent à dépasser une conception de l’autonomie qui ne serait tournée que vers le seul enjeu des libertés et responsabilités des universités, en l’appréhendant également à l’aune de notre société dans son ensemble.
![]()
The authors do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.


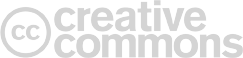
Répondre à cet article
Suivre les commentaires : |
|
