
Cette contribution est tirée de l’article de recherche intitulé « La Fabrique des cadres : étude comparée d’une école de commerce, d’une école d’ingénieurs et d’une université », publié en juillet 2018 et cosigné par Hédia Zannad (Neoma Business School), Francis Guérin (INSA Rouen Normandie) et Jean‑Louis Le Goff (Université de Rouen-Normandie), en partenariat avec l’APEC.
Une enquête menée par trois chercheurs a investigué la manière dont trois établissements d’enseignement supérieur à vocation professionnelle (l’école de commerce Neoma BS, l’école d’ingénieurs INSA et le cursus de sociologie de l’université de Rouen), « fabriquent » des cadres, c’est-à-dire préparent un public étudiant sans expérience aux réalités économiques et, plus spécifiquement, au rôle et à la posture de cadre que leurs diplômé·e·s pourraient occuper après leurs études ou dans leur parcours professionnel.
Elle met en évidence des différences notoires dans la professionnalisation développée dans les institutions étudiées. Elle révèle que, dans l’école de commerce, l’école d’ingénieurs et l’université étudiées, il existe trois archétypes de professionnalisation très différents en nature, en portée et en intention : respectivement « intégrée », « scindée » et « latente ». En lien avec ces types d’approches, l’enquête souligne aussi chez les étudiants trois rapports fort différenciés à eux-mêmes, au temps et à l’espace. En effet, leur degré d’autodétermination, de « disponibilité » et de perméabilité au monde extérieur varie fortement d’une institution à l’autre, renvoyant à trois injonctions implicites : « deviens qui tu es » pour l’école de commerce, « deviens ce que tu veux » pour l’école d’ingénieurs et, enfin, « deviens qui tu peux » pour l’université.
En école de commerce, la formation à un métier devient secondaire
Plus précisément, en école de commerce, la professionnalisation est « intégrée » dans la mesure où l’école intervient, en son nom, sur la totalité de la personne – dans ses dimensions scolaire, affective et sociale comme dans l’intégralité de sa carrière – par le biais d’une cotisation à vie à Neoma Alumni, l’association dans anciens élèves, dans le cas de l’étude. Ce ne sont donc pas tant des contenus pédagogiques qui sont enseignés ici qu’une tournure d’esprit business, un langage approprié à l’entreprise. L’investissement associatif prodigue du savoir-être : capacité à se connaître, à appréhender l’environnement et à s’adapter, à s’exprimer, à gérer et structurer son temps et ses activités, à déterminer ses priorités, à respecter ses engagements, à entreprendre, à initier un projet et le mener à terme.

Il s’agit moins, pour les étudiants d’école de commerce, de se former à un métier que de trouver des « positions » et des « ressources » : diplôme et connaissances dans des disciplines et des domaines combinables de façon variée, mais aussi ouverture sur des réseaux relationnels ou d’entreprises, offrant le maximum de possibilités de saisir des opportunités. Ce faisant, l’école de commerce investit moins dans la professionnalisation managériale que dans la production de ce qu’on pourrait appeler une personnalité organisationnelle, définie par son appartenance à une organisation qui lui accorde sa place et sa position relative.
Pour autant, la « managérialisation » de la personnalité des étudiants ne se fait pas de façon hégémonique et l’emprise de l’école de commerce sur les étudiants ne signifie ni qu’un avenir de manager fasse consensus, ni que la socialisation anticipatrice opère de façon mécanique et totale. On observe ainsi trois profils types :
-
Les managers en herbe, pour qui les propositions de l’école – cours théoriques, témoignages de professionnels, stages, vie associative – font « système » et s’articulent harmonieusement en vue d’une réussite professionnelle, tant objective que subjective. Dès le début de leur formation, ils agissent en « professionnels » et se dirigent rapidement vers ce à quoi ils sont destinés (et qu’ils sont même un peu déjà, du fait de leurs origines sociales) : ils prennent des responsabilités associatives, gèrent de gros budgets, jonglent avec un emploi du temps chargé ;
-
Les coéquipiers, pour qui l’apprentissage principal se fait « en marge » de la salle de classe (c’est-à-dire dans la vie associative) et/ou de l’école (c’est-à-dire dans les stages en entreprise) : il s’opère dès lors chez eux une acculturation aux comportements managériaux attendus, source d’employabilité, mais parfois au prix d’une frustration intellectuelle et/ou d’une perte de sens. Nous distinguerons parmi eux ceux qui s’investissent dans la vie associative et/ou dans leurs stages parce qu’ils veulent faire vivre leur passion (le sport, le théâtre, le développement durable, l’humanitaire, etc.), que nous baptisons les « investis » (dans une cause, un centre d’intérêt, etc.), et ceux qui jouent le jeu associatif par esprit d’équipe, par goût du collectif, par esprit prosocial ;
-
Les réfractaires, qui gardent tout au long de leur scolarité une distance critique à l’égard des valeurs dominantes et du comportement attendu. Ils peuvent adopter des attitudes distinctes qui les classent en deux catégories : les premiers (souvent des premières, d’ailleurs) investissent fortement la sphère scolaire et intellectuelle au détriment de la vie associative et festive. Cela les pousse plus sûrement que les autres étudiants à construire un projet professionnel singulier (parfois à l’étranger, où l’exigence scolaire est plus forte). Ce faisant, ils s’exposent à la marginalisation et, éventuellement, à un ralentissement de carrière. Les seconds désinvestissent la vie d’école – dans son ensemble – avec à la clef une souffrance affective et un fort sentiment d’injustice.
En école d’ingénieur, une « autoproduction » à l’intérieur d’une figure imposée
En école d’ingénieur, la professionnalisation est au contraire scindée en deux. Elle est liée, d’une part à la dimension académique, qui est indispensable et reste une fin en soi car elle renvoie au « technique » et au « scientifique ». Elle s’avère donc de ce fait indissociable de la figure de l’ingénieur, qui se doit de posséder le « fond commun » inhérent à son diplôme, même si les étudiants n’ont pas l’occasion de se demander quel type d’ingénieur ils souhaitent devenir exactement.
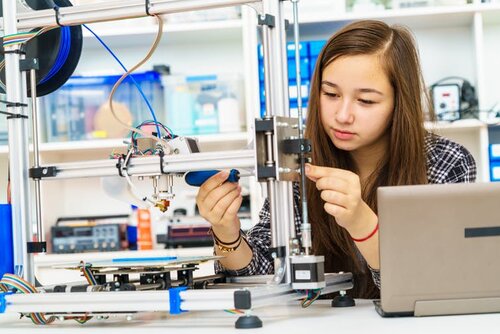
Une large part de responsabilité est dès lors déléguée à l’étudiant quant à la manière dont il va vivre, développer, exploiter et analyser ses expériences hors du strict cadre des enseignements, et la manière dont il va élaborer sa projection personnelle avec les moyens et cadres expérientiels qui sont les siens. L’individu doit donc en quelque sorte s’« autoproduire », être l’entrepreneur de soi, mais à l’intérieur d’une figure imposée, celle de l’ingénieur, qui est le signal valorisant qu’il se doit de renvoyer dans le futur aux entreprises, voire à lui-même.
In fine, tout se passe comme si la « professionnalisation » et le savoir académique étaient deux sphères séparées dans l’esprit de la plupart des étudiants (et dans l’esprit des responsables de l’institut). Les enseignants sont très peu critiqués quant à leurs capacités dans la seconde de ces sphères (la plupart des élèves reconnaissent la valeur scientifique de leur formation, voire s’en disent fiers). Quant aux élèves, ils leur accordent rarement une légitimité dans la seconde, voire les estiment incompétents quand ils cherchent à l’investir.
À l’université, la professionnalisation n’est pas un objectif premier
Enfin, l’université procure une professionnalisation plus « latente » qui, que ce soit par manque de moyens ou par vocation affirmée, s’effectue par défaut. Elle n’est à aucun moment explicitée comme objectif du programme en tant que tel. Le cadre de l’université, peu normatif et contraignant, se double d’une distanciation à soi constituant en même temps sa part de vérité : l’impératif est de rester fidèle à soi-même et de se construire avant tout, voire de faire passer ce soi avant l’idée de carrière (ancrages locaux, par exemple tout en cherchant à s’adapter à son milieu social ou/et professionnel.
D’une certaine manière, l’engagement dans le cursus de sociologie, auquel s’intéresse l’étude, répond à un calcul d’optimisation coûts/bénéfices qui ne peut être formulé qu’en fin de parcours universitaire, et/ou au terme d’une réflexion sur son expérience professionnelle.

L’exercice consistant à passer du monde universitaire à celui du travail s’avère donc délicat et difficile pour les étudiants : il suppose de quitter une posture théorique, ce qui exige de déconstruire les réalités sociales pour échapper à la production de prénotions ou d’opinions de sens commun. Cependant, les plus concentrés sur leur cursus développent des capacités ou qualités qui constituent de vraies compétences visibles lorsqu’ils sont en stage : une curiosité et une rigueur d’analyse dans la façon d’interroger leurs rapports aux autres, que ce soit au plan personnel ou professionnel. Ces qualités rendent compte d’apprentissages distinguant les enseignements dispensés à l’université de ceux qui sont en vigueur dans les écoles professionnelles : « distance, décentration, familiarité avec la recherche, habitude du débat, et du pluralisme, posture réflexive, goût d’apprendre, rapport facile à l’écrit, identité d’intellectuel, mobilité d’esprit et formation suffisamment polyvalente pour ne pas être enfermé dans un avenir tout tracé. » (Philippe Perrenoud, 2005, p. 12)
Encourager les stages longs
Au-delà des différences constatées entre les trois grandes formes d’enseignement supérieur que sont l’école de commerce, l’école d’ingénieurs et l’université, une même logique les nourrit toutes trois : la mise en adéquation entre formation et emploi mais aussi, de façon croissante, entre personne et marché.
Ces mises en adéquation demeurent la fonction manifeste et réelle des dispositifs de préprofessionnalisation mis en place, au premier rang desquels figure le stage long, crucial dans l’acquisition de compétences, la socialisation, la détermination du projet professionnel et la capacité à exercer un recul critique sur le monde professionnel. Mais peuvent s’y ajouter de multiples autres dispositifs (projets, conférences de professionnels, visites d’entreprise, années de césure, etc.) tout aussi intermédiaires et liminaux.
Au-delà de cette recommandation générale – encourager tous types d’étudiants à faire des stages suffisamment longs durant leurs cursus scolaire –, comment tirer concrètement parti de cette étude ?
La réponse n’est ni facile ni univoque car elle relève de problématiques politiques (dans quelle mesure l’accès aux études supérieures est-il aussi méritocratique et égalitaire qu’annoncé ?), sociologiques (peut-on transcender ses origines sociales et, par exemple, devenir un « manager en herbe » alors qu’on ne possède pas l’habitus correspondant ?) et, in fine, de choix individuels – avec toutes les précautions d’usage concernant ce terme puisqu’une partie de ces choix semble prédéterminée par nos origines sociales et, en tout état de cause, inconscients.
Mais, au-delà encore, l’objectif de cette étude est d’inciter les étudiants et leurs familles à ne pas considérer des études dans le supérieur uniquement comme une option de contenu et de curriculum académique, ou comme un choix plus ou moins opportun et performant en vue d’une insertion réussie sur le marché du travail. Il s’agit au contraire d’un choix bien plus signifiant et profond qu’on peut le penser a priori et qui pose inéluctablement la question du rapport à soi-même et de la préservation de son identité, de son rapport à la temporalité et à l’espace. Et bien vivre ses études n’est-il pas aussi une condition non seulement de la réussite, mais tout simplement de l’épanouissement personnel ?
![]()
Hédia Zannad does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.


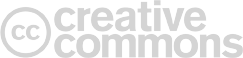
Vos commentaires
# Le 8 décembre 2018 à 17:41, par yves LE DUC En réponse à : Universités, écoles de commerce et d’ingénieurs : trois approches radicalement différentes de la professionnalisation
Après l’obtention de leurs diplômes respectifs, il serait intéressant de voir comment ces 3 voies différentes d’accès à la professionnalisation des étudiants évoluent : formations complémentaires, bifurcations de carrières, spécialisation...
Répondre à cet article
Suivre les commentaires : |
|
