Un article de la revue Activités, une publication sous licence Creative Commons by nc nd
Cet ouvrage est issu d’un séminaire du Groupe de recherche et d’étude sur l’histoire du travail et de l’orientation (GRESHTO), au CNAM. Pendant deux ans, ce séminaire, consacré au thème « Émotions, affects et institutions », a réuni des chercheurs et des chercheuses en histoire (J. Martin, M. Saraceno, & S. Wahnich) et en psychologie (A. Bonnemain, Y. Clot, R. Ouvrier-Bonnaz, B. Prot, & J.-L. Tomás). L’ouvrage publie leurs contributions, qu’il répartit en quatre parties. La première retrace l’histoire du dialogue entre histoire et psychologie en France. La deuxième est consacrée à la place des émotions dans la compréhension des événements, qu’il s’agisse d’événements révolutionnaires ou d’événements dans le cadre du travail en entreprise. Une conceptualisation des émotions y est aussi proposée, à travers la distinction entre affects, sentiments et émotions. La troisième partie suggère de rapprocher la notion de « protagonisme » (en histoire) et celle de « personnalisation » (en psychologie). Ces deux notions s’avèrent pertinentes pour rendre compte de l’expérience des femmes et des hommes engagés dans la révolution. La dernière partie est consacrée à la « psychologie industrielle » d’Hugo Münsterberg, un psychologue prusso-américain (1863-1916), dont la distinction entre « sciences objectivantes » et « sciences subjectivantes », ou entre « sciences des intentions » et « sciences des phénomènes », a inspiré Max Weber.
Ces neuf contributions sont précédées d’une introduction substantielle, dans laquelle les éditeurs de l’ouvrage retracent les débats qui ont accompagné la naissance et l’institutionnalisation de l’histoire, de la psychologie et de la sociologie au tournant des années 1900, et dans les années suivantes. Les auteurs soulignent notamment l’attrait des historiens de la première moitié du 20e siècle pour la psychologie. Cet attrait s’explique en partie par leur rejet des prétentions quelque peu hégémoniques du durkheimisme, qui a détrôné l’esprit et la conscience individuels au profit de la société et de la conscience collective, et fait de celles-ci des instances quasi transcendantes.
On comprend que les psychologues n’aient pas beaucoup apprécié ce genre de mise en cause de leurs principales convictions. Mais on est plus surpris de lire chez les historiens des appels à faire place à la psychologie. Quand Marc Bloch écrit que « toute histoire est psychologique » ou que « les faits historiques sont, par essence, des faits psychologiques », on ouvre de grands yeux. Est-ce l’influence de Durkheim et des durkheimiens ? Ceux-ci avaient en effet déjà dit quelque chose de semblable au sujet des faits sociaux, parce qu’ils considéraient que l’on retrouve dans la vie sociale « les attributs constitutifs de la vie psychique ». Ils en concluaient que la sociologie est finalement une forme de psychologie. Mais de quelle psychologie s’agit-il au juste ? Le volume en présente plusieurs, accordant une place importante à celle de Lev Vygotski et d’Ignace Meyerson. Parmi elles figure aussi celle, peu connue, d’Hugo Münsterberg.
Il semble que pour que le mariage de l’histoire et de la psychologie réussisse il eût fallu qu’émerge une véritable « psychologie historique », comme l’appelait de ses vœux Lucien Febvre. Le projet d’une telle psychologie a existé, mais il a fait long feu. L’ouvrage évoque à plusieurs reprises les publications de Meyerson dans lesquelles un tel projet a été formulé. Mais il semble n’avoir convaincu ni les psychologues, ni les historiens, vraisemblablement parce qu’il les obligeait à remettre en cause leur métaphysique implicite.
En effet Meyerson remettait profondément en cause le cadre conceptuel de la psychologie classique – et notamment sa méconnaissance de l’historicité essentielle de l’homme. Il critiquait également la psychologie expérimentale de ses collègues (qui se croyait bien plus scientifique qu’elle ne l’était en réalité). En un sens, le projet de Meyerson était un projet d’externalisation de l’esprit, incompréhensible pour les tenants de la psychologie classique. Un peu comme Wilhelm Dilthey, Meyerson localisait l’esprit non pas dans la tête de l’individu, mais dans les productions humaines (dans la conduite, le travail, l’expérience), c’est-à-dire dans les « œuvres » individuelles et collectives, dans les opérations intellectuelles engagées dans les comportements et les activités, ainsi que dans les mythes, la magie, les religions, le droit, les institutions, les sciences, etc. Il considérait le monde humain comme « un monde d’œuvres » : « C’est ce monde des œuvres qui est la matière véritable d’une exploration objective de la nature des hommes, il doit être pour la psychologie humaine ce que le monde des phénomènes de la nature est pour la physique » (Meyerson). C’est pourquoi « l’examen des œuvres, loin d’être dévolu à l’historien seulement, doit constituer la matière principale de la recherche du psychologue » (Ibid.). C’est à travers cet examen, à l’aide de la méthode comparative et de la méthode historique, que l’on peut atteindre le « fonctionnement mental » des êtres humains.
Ce projet de psychologie historique rejoignait sous certains aspects celui de certains des héritiers de Durkheim, que Meyerson considérait in fine comme des psychologues. Mais il était trop hétérodoxe pour les psychologues : « Le travail de Meyerson soulevait des difficultés importantes (…) ; surtout, il mettait d’une certaine manière en question le cadre conceptuel et méthodologique sur lequel la discipline était fondée. À contre-courant d’une psychologie qui s’apprêtait à naturaliser les vieilles facultés de l’esprit et restait, malgré tout, fidèle à son héritage métaphysique, l’approche de Meyerson apparaissait comme une véritable généalogie de l’esprit. (…) Ce programme, aussi riche que complexe et difficile, n’a pas été discuté publiquement » (Pizarroso, 2008, p. 434). Il est possible aussi qu’il n’ait pas suffisamment élucidé la condition d’une psychologie authentiquement historique : à savoir que soit développée une critique radicale de la philosophie de l’esprit et de la métaphysique qui servent de base à la psychologie moderne, et même à la sociologie durkheimienne.
Paradoxalement, Durkheim et les psychologues classiques (et sans doute les historiens) partageaient un même cadre de pensée. Après tout, l’invention de la psychologie et de la sociologie à l’époque moderne est avant tout une tentative d’application des méthodes de l’enquête scientifique à des problèmes définis dans le cadre d’une philosophie déterminée de l’esprit, que l’on peut qualifier, à la suite de Vincent Descombes (1995), de « mentale ». Il vaut la peine de s’interroger sur l’avènement, à l’époque moderne, d’une telle philosophie, et sur la métaphysique qu’elle incarne [1].
Cette philosophie propose une théorie « médiationnelle » de l’esprit : le sujet n’est pas en contact direct avec les choses, mais en relation avec des représentations internes des choses, en l’occurrence des idées dans son esprit (Dreyfus & Taylor, 2015). Elle se caractérise par une substantialisation de l’esprit et par la position d’un ordre d’existence séparé, le psychique. Elle identifie l’esprit à la conscience et fait des états et des processus psychiques la propriété d’un soi individuel. Ce soi dispose en effet d’un monde intérieur fait d’états conscients, auxquels il a un accès immédiat « en première personne ». L’esprit est aussi considéré comme l’agent exclusif de la connaissance. Cette philosophie mentale est en fait obnubilée par des questions de théorie de la connaissance et par le problème de la vérité. C’est sans doute cette hypnotisation par les mystères de la connaissance qui l’a conduite à faire de l’esprit individuel, et des états et processus qui y sont supposés logés, le siège de la connaissance et, plus largement, de la vie mentale.
Quant à la métaphysique qui sous-tend cette philosophie mentale, on peut la caractériser comme une « métaphysique des états d’esprit » (Descombes, 1995). Cette métaphysique est une manière de concevoir l’esprit ou le mental « calquée sur la philosophie naturelle des procès physiques et des choses qui sont dans tel ou tel état » (Ibid., p. 273). La psychologie et la philosophie mentales modernes ont ainsi été enclines à considérer les verbes psychologiques (croire, penser, vouloir, projeter, avoir l’intention de, sentir, et les verbes d’émotions) comme des « verbes d’état », c’est-à-dire comme attribuant à un sujet un état déterminé, et plus précisément un état actuel, isolable de par sa structure et son rôle. Mais « les états psychiques ne deviennent des états internes qu’à la condition de traiter le psychisme comme un système clos » (Ibid., p. 286).
Un second geste de la métaphysique des états d’esprit consiste à occulter la différence entre les attributions psychologiques et les attributions physiques : « L’attribution physique passe par la détermination d’un état, ce qui veut dire d’un état actuel (déterminable à tel instant) » (Ibid., p. 282). Mais s’agissant du psychisme, il ne consiste pas en états déterminables à chaque instant, sauf s’il est identifié au cerveau. À la source de cette différence entre les deux types d’attribution, il y a le fait que le langage ne s’applique pas à nos états mentaux « de la même manière qu’aux états de choses du monde qui nous entoure » (Rosat, 2006, pp. 223-224). C’est un point sur lequel a insisté Ludwig Wittgenstein. La psychologie mentale est encline à appliquer à son domaine d’objet les modes de description et d’explication pratiqués dans les sciences de la nature.
Enfin la « métaphysique des états d’esprit » se double souvent aussi d’un « mythe des processus mentaux » (Wittgenstein), qui consiste à considérer qu’aux phénomènes mentaux correspondent des processus internes, des processus à découvrir, car ils n’apparaissent pas en surface, bref, des processus semblables à ceux qu’étudient les sciences physiques. Certains phénomènes mentaux sont incontestablement des processus, mais à tous les concepts psychologiques ne correspondent pas nécessairement des processus internes. En outre, en parlant de processus on détermine implicitement les questions qu’il est pertinent de poser à partir de ce terme, et on fait comme si on savait déjà ce qu’il désigne, ou comme si on s’était déjà accordé sur la façon d’en révéler la nature. Or cette modalité est souvent biaisée.
La philosophie mentale et la métaphysique des états d’esprit ont profondément marqué la compréhension que les individus modernes ont d’eux-mêmes, de leurs comportements et de leurs affects. Ils conçoivent leur Moi comme une intériorité psychique, comme le lieu de leurs pensées, de leurs sentiments et de leurs émotions. Cette internalisation, qui donne une nouvelle signification à la dualité intérieur/extérieur, est allée de pair avec une délimitation nette du Soi (qui cesse d’être « poreux » à des forces externes – esprits maléfiques ou bénéfiques, forces cosmiques, etc.).
Notre conception moderne de l’intériorité et de l’extériorité paraîtrait étrange à une autre culture et à une autre époque. Pourtant c’est à partir d’une telle conception que nous faisons l’expérience de nos pensées, sentiments et émotions. Cela a désormais du sens pour nous de les localiser en nous et pas ailleurs :
« Ainsi nous en venons naturellement à croire que nous avons un moi comme nous avons une tête ou des bras, que nous avons des profondeurs intérieures comme nous avons un cœur ou un foie, comme si c’était un fait brut, indépendant de toute interprétation. Des distinctions de localisation, comme intérieur et extérieur, semblent des faits que nous découvrons sur nous-mêmes plutôt que des façons particulières, parmi d’autres, de nous interpréter nous-mêmes (…). Qui d’entre nous peut croire que notre pensée se situe ailleurs qu’au-dedans, “dans l’esprit” ? Quelque chose dans la nature de notre expérience de nous-mêmes semble rendre presque irrésistible, incontestable, une telle localisation » (Taylor, 1998, p. 152).
Résultent de cette localisation « l’avènement de l’identité isolée », avec ses espaces et ses profondeurs intérieurs, une conception monologique de la conscience et l’émergence de nouvelles disciplines de maîtrise de soi, étayées par « une éthique de l’indépendance, de la maîtrise de soi, de la responsabilité de soi, d’un désengagement qui confère de la maîtrise ; une position qui requiert du courage, le refus de la soumission confortable à l’autorité, des consolations du monde enchanté, de l’abandon aux sollicitations des sens » (Taylor, 2011, p. 951). En résultent aussi une « réflexivité radicale », consistant à se concentrer sur soi-même comme agent d’expérience et à prendre cette expérience comme objet, ainsi qu’une conception subjectiviste de la rationalité et de la compréhension morale.
Quelqu’un comme Durkheim n’a jamais remis en cause les tenants et aboutissants de cette philosophie mentale. Sa métaphysique est un mélange de cartésianisme et de néo-kantisme. La présence de cet héritage se voit notamment dans l’importance qu’il accordait au concept de représentation, allant jusqu’à dire que « tout ce qui est social consiste en représentations, par conséquent est un produit de représentations » (Durkheim, 1896/97). Les représentations étant des phénomènes psychiques, la société est elle-même une réalité psychique, plus précisément « un règne intellectuel » surplombant les consciences privées et formant une conscience collective. Les affects eux-mêmes sont des représentations, en l’occurrence des « représentations sensibles ».
Est-ce la reconduction de cette philosophie mentale et de sa métaphysique qui a provoqué les réticences de certains historiens vis-à-vis du durkheimisme ? Je ne suis pas sûr qu’ils aient fait l’investissement nécessaire pour se donner un cadre conceptuel vraiment différent, malgré les innovations dont témoigne l’adoption d’un nouveau vocabulaire : « mentalités » (Febvre) (attitudes, comportements, gestes) ; « matériel mental » (Febvre) ; « outillage mental » (Le Goff). Sous « outillage mental », Jacques Le Goff mettait des choses aussi hétérogènes que le vocabulaire, la syntaxe, les lieux communs, les conceptions de l’espace et du temps, les cadres logiques.
Pour ce qui est des psychologues, ils n’ont pas tous cédé aux mirages de la philosophie mentale de l’esprit, comme l’atteste le cas Meyerson. Jérôme Martin rappelle aussi, dans sa riche contribution, la critique adressée par Henri Piéron, au nom d’une conception expérimentale de la psychologie, à la « psychologie subjectiviste » d’Henri Bergson : « En somme, il n’y a qu’une psychologie, qui n’est pas du tout l’étude des faits de conscience (…), mais qui est la science du comportement des êtres vivants, science qui peut utiliser plusieurs méthodes, dont la méthode introspective n’est certes pas la plus satisfaisante. C’est une science biologique qui étudie la manière dont un être vivant reçoit les influences du milieu et élabore ses réactions » (Piéron, 1916).
Mais est-ce en faisant de la psychologie une science biologique que l’on sort de la philosophie mentale et de sa métaphysique implicite ? Les neurosciences contemporaines montrent que ça n’est pas le cas. Il faut aussi en faire une science historique et sociale. Car le propre des processus biologiques impliqués dans les phénomènes considérés comme psychiques est d’être façonnés par un contexte social-historique et culturel. Il faut donc désencastrer l’esprit et le replonger dans un milieu social et culturel, lui redonner un « état civil » (Descombes).
C’est chez les pragmatistes américains (pour lesquels Durkheim éprouvait autant d’attraits que de répulsions) que l’on trouve la conscience la plus vive de cette imbrication du biologique et du culturel :
« Tout ce qui peut être appelé spécifiquement psychologique (…) est une transformation des organes et des processus physiologiques effectuée par et dans des conditions socio-culturelles » (Dewey, 2012, pp. 316‑17).
« Il n’y a pas un ordre d’existence séparé qui constituerait l’objet de la psychologie en raison d’une nature mentaliste ou psychique qui lui serait inhérente. (…) Les phénomènes psychologiques sont des phénomènes biologiques qui ont été si intimement colorés, ou mieux teintés, par des conditions socio-culturelles qu’ils ont revêtu les propriétés qui spécifient le comportement et l’expérience des humains ; ceux-ci se trouvent ainsi si profondément qualifiés qu’ils constituent les distinctions et les relations devenues familières dans la littérature psychologique » (Ibid., pp. 320‑21).
« L’homme est social en un autre sens que l’abeille ou la fourmi, puisque ses activités sont comprises dans un environnement qui est transmis culturellement, de sorte que ce que l’homme fait et la façon dont il agit, est déterminé non par la seule structure organique et la seule hérédité physique, mais par l’influence de l’hérédité culturelle, enfouie dans les traditions, les institutions, les coutumes et les intentions et croyances que les unes et les autres à la fois véhiculent et inspirent. Même les structures neuromusculaires des individus sont modifiées sous l’influence qu’exerce l’environnement culturel sur ces activités. L’acquisition et la compréhension du langage, avec l’habileté dans les arts (…), représentent l’incorporation dans la structure des êtres humains des effets des conditions culturelles, interpénétration si profonde que les activités qui en résultent sont directement et apparemment aussi “naturelles” que le sont les premières réactions d’un bébé. Parler, lire, exercer un art – art industriel, beaux-arts, art politique – sont des exemples de modifications pratiquées au cœur de l’organisme biologique par l’environnement culturel » (Dewey, 1993, p. 102).
On peut ajouter deux autres conditions à satisfaire pour que la psychologie devienne véritablement une science sociale et historique. La première est qu’elle abandonne la division d’un monde extérieur et d’un monde intérieur, et cesse d’identifier intériorité psychologique et subjectivité. La seconde est qu’elle devienne écologique, qu’elle prenne en compte les interactivités, qui ont lieu dans les activités vitales, entre ce qui est organique et ce qui est socio-culturel, et qu’elle raisonne en termes d’intériorité mutuelle de l’organisme et de l’environnement : « La psychologie est une science sociale, une science d’une conduite qui doit être apprise, et qui le sera conformément aux mœurs et aux habitudes d’un groupe. (…) La psychologie des fonctions intellectuelles doit se poser le problème des institutions proprement intellectuelles, du style culturel des pensées, des techniques de réflexion et de médiation. Elle sera une psychologie historique » (Descombes, 1995, pp. 215‑216). Mais la critique de Descombes oublie l’ancrage biologique de la pensée, de la réflexion et plus largement de la conduite. De ce point de vue, l’œuvre de Vygotski, largement évoquée dans l’ouvrage, ne commet pas cette erreur.
Meyerson aurait-il dédouané les historiens des émotions des biais méthodologiques et métaphysiques qu’il attribue à ses collègues psychologues ? Rien n’est moins sûr. La vitalité récente de l’histoire des émotions retient l’attention dans plusieurs textes du volume. C’est Lucien Febvre qui, dans les années 1930, a recommandé aux historiens de s’intéresser à la « sensibilité », c’est-à-dire à la « vie affective et ses manifestations ». Comme l’explique Régis Ouvrier-Bonnaz, aux yeux de Febvre, « l’étude des émotions comme mode d’accès aux sentiments permet de revenir aux déterminations premières des sociétés et donc de l’Homme en société ». Ouvrier-Bonnaz rappelle aussi la recommandation d’Henri Wallon de distinguer affect et émotion. Mais l’affect semble être considéré comme un état interne, rendu visible et observable par l’émotion, dont l’expression est soumise à un contrôle social. Mais est-ce là autre chose qu’une formulation de la psychologie ordinaire des émotions ?
Force est de constater que la conceptualisation de l’affectivité et de l’émotion par les historiens de la première moitié du 20e siècle est restée à un niveau assez sommaire ; leurs références sont surtout franco-françaises ; ils semblent peu prendre en ligne de compte les théories des émotions proposées par les psychologues et les philosophes depuis au moins la fin du 19e siècle (pour ne pas mentionner les classiques – Descartes, Hume, Spinoza, Smith, etc.). La lecture de la psychologie des foules de le Bon et Tarde, ou celle de Durkheim, semble à l’arrière-plan de l’essentiel de leurs considérations. Ainsi, la caractérisation des émotions par Lucien Febvre en 1941 paraît-elle un mélange de Le Bon, de Tarde et de Durkheim. Le schème explicatif est le même : incitations réciproques ; propagation par contagion et imitation ; hystérie, etc. Ainsi, la principale caractéristique des émotions est, écrit Febvre, d’être « contagieuses » ; il s’agit d’une « contagion mimétique » traduisant une fusion de « sensibilités diverses ». Et comme Durkheim, Febvre souligne le fait qu’un partage d’émotions non seulement soude un groupe, mais il lui confère aussi « une plus grande sécurité, ou une plus grande puissance ».
La référence à la philosophie de Baruch Spinoza est un trait majeur des réflexions contemporaines en matière de théorie des émotions (y compris en neurosciences – cf. les livres d’Antonio Damasio). Spinoza avait-il vraiment raison ? Oui, incontestablement sur certains points ; sur d’autres c’est beaucoup moins évident. Il avait sans doute raison sur deux points. Le premier concerne le lien de l’émotion à l’activité, fortement souligné, de façon heureuse, par Yves Clot dans sa contribution : l’affect est une « propriété de l’activité ». En un sens, pour être ému il faut agir. Et c’est parce que surgissent des tensions, des discordances, des perturbations et des conflits dans l’accomplissement continu des activités, nécessitant de les réajuster et de les rediriger en partie, que les émotions émergent. En effet les interruptions, les chocs, les contrariétés, les ruptures d’équilibre et d’intégration dans le continuum des activités donnent le plus souvent lieu à des réponses de type émotionnel : « L’émotion est le signe conscient d’une rupture effective ou imminente » (Dewey, 2005, p. 34).
Le second point concerne, d’une part, l’analyse des « passions tristes » comme diminuant la « puissance d’agir », d’autre part, l’impuissance de la raison à canaliser ou ordonner les émotions (« Un affect pour lequel nous pâtissons ne peut être réduit ni ôté sinon par un affect plus fort que lui et contraire à lui, c’est-à-dire par l’idée d’un affect du corps plus fort que celui dont nous pâtissons et contraire à lui » (Spinoza). Antonio Damasio a pu voir en Spinoza un « immunologiste de l’esprit, développant un vaccin capable de créer des anticorps contre les passions [tristes] ». William James et John Dewey ont proposé un point de vue similaire : pour contrer une impulsion ou une habitude émotionnelle indésirable, il faut la force d’une autre, plutôt que le concours de la seule raison, qui n’a pas de force motivante suffisante. Ils ont cependant fait un pas de plus par rapport à Spinoza en donnant un contenu pragmatique au concept abstrait de raison. La raison devient alors une affaire de coordination d’une multitude d’impulsions et de dispositions dans la réalisation d’actes et la production de comportements.
Mais la théorie des émotions de Spinoza reconduit aussi une bonne partie des dualismes cartésiens, dont celui du corps et de l’esprit, du corporel et de l’idéel, du somatique et du psychique (que l’affect permettrait d’unifier), et, par-dessus tout, de l’interne et de l’externe (avec la conception de l’expression des émotions qui va de pair avec cette dualité). Ainsi l’affect est-il conçu comme un état interne, un état corporel doublé d’une idée de cet état (on retrouvera quelque chose de similaire plus tard chez William James). C’est à mes yeux la théorie des émotions, d’inspiration darwinienne, de John Dewey qui permet de libérer la psychologie, la philosophie et l’histoire des émotions de ces vieux dualismes (cf. Quéré, 2021). Par ailleurs, il est peu courant aujourd’hui de distinguer, comme le fait Yves Clot, affect, sentiment et émotion. On considère plutôt que sentiments et émotions composent l’espace affectif avec un troisième terme, les humeurs, les trois ayant nécessairement un ancrage biologique, caractérisable par une téléologie et pas seulement par une causalité efficiente (cf. Quéré, à paraître).
Bibliographie
Des DOI sont automatiquement ajoutés aux références par Bilbo, l’outil d’annotation bibliographique d’OpenEdition.
Les utilisateurs des institutions qui sont abonnées à un des programmes freemium d’OpenEdition peuvent télécharger les références bibliographiques pour lequelles Bilbo a trouvé un DOI.
Descombes, V. (1995). La denrée mentale. Paris : Minuit.
Dewey, J. (1993). Logique. Théorie de l’enquête. Paris : PUF [1938].
Dewey, J. (2005). L’art comme expérience. Pau : Publications de l’Université de Pau/Éditions Farrago [1934].
Dewey, J. (2012). Unmodern Philosophy and Modern Philosophy. Carbondale and Edwardsville : Southern Illinois University Press.
Dreyfus, H., & Taylor, C. (2015). Retrieving Realism. Cambridge (MA) : Harvard University Press.
DOI : 10.4159/9780674287136
Durkheim, E. (1896-97). Le problème de l’inceste et ses origines. L’Année sociologique, 1, 1‑70.
Piéron, H. (1916). L’objectivisme psychologique et la doctrine dualiste. Revue philosophique, LXXXI, 61‑71.
Pizarroso, N. (2008). La psychologie historique vue par la psychologie expérimentale. Analyse d’une rencontre manquée. Revue d’histoire des sciences, 61(2), 399‑434.
Quéré, L. (2021). La fabrique des émotions. Paris : PUF.
Quéré, L. (à paraître 2023). Il n’y a pas de cerveau des émotions. Paris : PUF.
Rosat, J.-J. (2006). Exprimer ou décrire ? In S. Laugier & C. Chauviré (Eds.), Lire les Recherches philosophiques de Wittgenstein (p. 225‑235). Paris : Vrin.
Taylor, C. (1998). Les sources du moi. Paris : Seuil.
Taylor, C. (2011). L’âge séculier. Paris : Seuil.


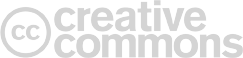
Répondre à cet article
Suivre les commentaires : |
|
